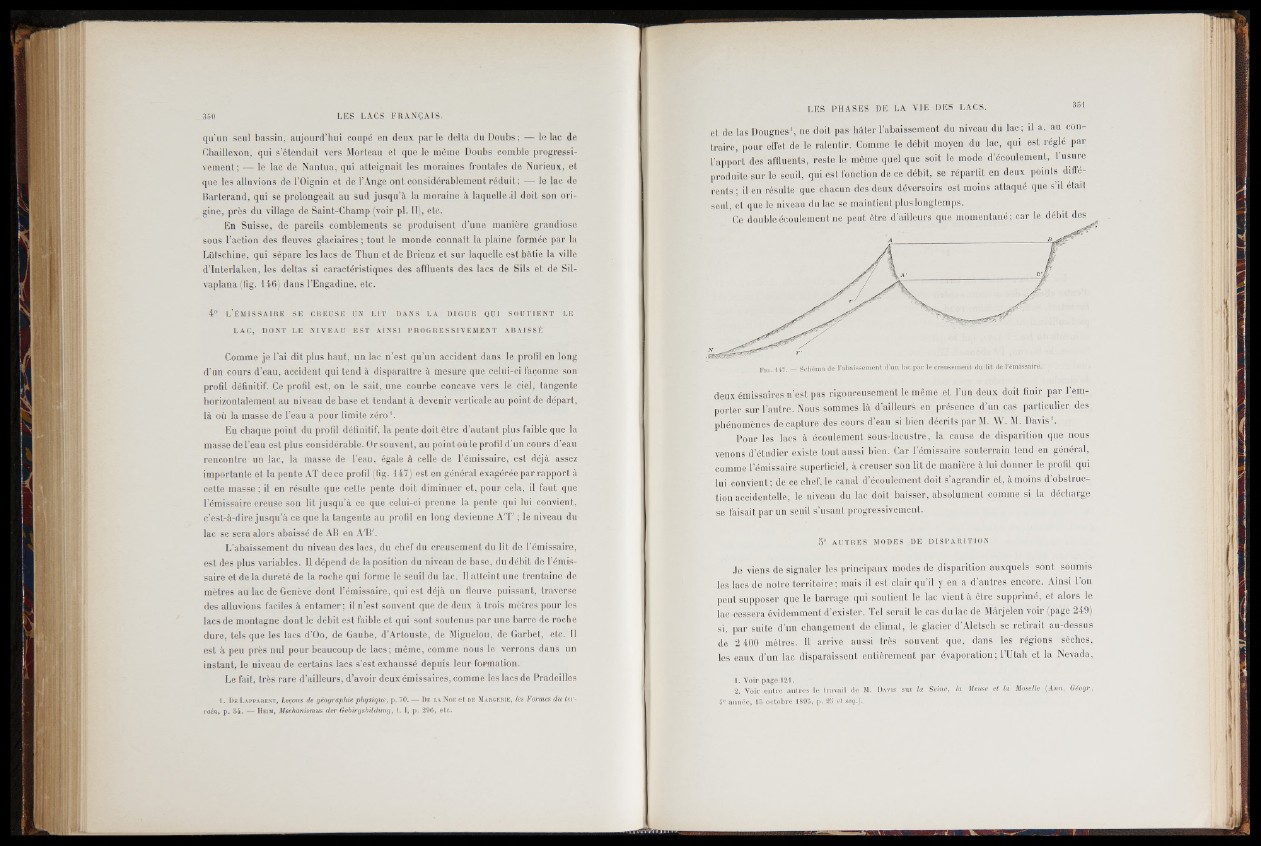
qu’an seul bassin, aujourd’hui coupé en deux parle delta duDoubs; — le lac de
Ghaillexon, qui s’étendait vers Morteau et que le même Doubs comble progressivement;
A- le lac de Nantua, qui atteignait les moraines frontales de Nurieux, et
que les alluvions de l’Oignin et de l’Ange ont considérablement réduit ; — le lac de
Barterand, qui se prolongeait au sud jusqu’à la moraine à laquelle.il doit son origine,
près du village de Saint-Champ (voir pl. II), etc.
En Suisse, de pareils comblements se produisent d’une manière grandiose
sous l’action des fleuves glaciaires ; tout le monde connaît la plaine formée par la
Ltttschine, qui sépare les lacs de Thun et de Brienz et sur laquelle est bâtie la ville
d’Interlaken, les deltas si caractéristiques des affluents des lacs de Sils et de Sil-
vaplana (fig. 146) dans l’Engadine, etc.
4° l ’é m i s s a i r e s e c r e u s e u n l i t o a n s l a d i g u e q u i s o u t i e n t l e
L A C , D O N T L E N IV E A U E S T A IN S I P R O G R E S S IV E M E N T A R A IS S É
Comme je l’ai dit plus haut, un lac n’est qu’un accident dans le profil en long
d’un cours d’eau, accident qui tend à disparaître à mesure que celui-ci façonne son
profil définitif. Ce profil est, on le sait, une courbe concave vers le ciel, tangente
horizontalement au niveau de base et tendant à devenir verticale au point de départ,
là où la masse de l’eau a pour limite zéro '.
En chaque point du profil définitif, la pente doit être d'autant plus faible que la
masse de l’eau est plus considérable. Or souvent, au point où le profil d’un cours d’eau
rencontre un lac, la masse de l’eau, égale à celle de l’émissaire, est déjà assez
importante et la pente AT de ce profil (fig. 147) est en général exagérée par rapport à
cette masse ; il en résulte que cette pente doit diminuer et, pour cela, il faut que
l’émissaire creuse son lit jusqu’à ce que celui-ci prenne la pente qui lui convient,
c’est-à-dire jusqu'à ce que la tangente au profil en long devienne A'T' ; le niveau du
lac se sera alors abaissé de AB en A'B'.
L’abaissement du niveau des lacs, du chef du creusement du lit de l’émissaire,
est des plus variables. Il dépend de la position du niveau de base, du débit de l’émissaire
et de la dureté de la roche qui forme le seuil du lac. Il atteint une trentaine de
mètres au lac de Genève dont l’émissaire, qui est déjà un fleuve puissant, traverse
des alluvions faciles à entamer; il n’est souvent que de deux à trois mètres pour les
lacs de montagne dont le débit est faible et qui sont soutenus par une barre de roche
dure, tels que les lacs d’Oo, de Gaube, d’Artouste, de Miguelou, de Garbet, etc. II
est à peu près nul pour beaucoup de lacs; même, comme nous le verrons dans un
instant, le niveau de certains lacs s’est exhaussé depuis leur formation.
Le fait, très rare d’ailleurs, d’avoir deux émissaires, comme les lacs de Pradeilles
1 . D e L a p p a b e n t , Leçons de géographie p h y siq u e , p . 7 0 . — D e l a Noë e t d e M a r g e r i e , les Formes d u terra
in , p . 54. — He jm, Mechanismus d e r Gebirgsbildung, t. I, p . 296, etc.
et de las Dougnes1, ne doit pas hâter l’abaissement du niveau du lac; il a, au contraire,
pour effet de le ralentir. Comme le débit moyen du lac, qui est réglé par
l’apport des affluents, reste le même quel que soit le mode d’écoulement, l’usure
produite sur le seuil, qui est fonction de ce débit, se répartit en deux points différents
; il en résulte que chacun des deux déversoirs est moins attaqué que s’il étail
seul, et que le niveau du lac se maintient plus longtemps.
deux émissaires n’est pas rigoureusement le même et l’un deux doit finir par l ’emporter
sur l ’autre. Nous sommes là d’ailleurs en présence d’un cas particulier des
phénomènes de capture des cours d’eau si bien décrits par M. W. M. Davis5.
Pour les lacs à écoulement sous-lacustre, la cause de disparition que nous
venons d’étudier existe tout aussi bien. Car l’émissaire souterrain tend en général,
comme l’émissaire superficiel, à creuser son lit de manière à lui donner le profil qui
lui convient ; de ce chef, le canal d’écoulement doit S’agrandir et, à moins d’obstruction
accidentelle, le niveau du lac doit baisser, absolument comme si la décharge
se faisait par un seuil s’usant progressivement.
5 ° A U T R E S M O D E S D E D I S P A R IT IO N
Je viens de signaler les principaux modes de disparition auxquels sont soumis
les lacs de notre territoire ; mais il est clair qu’il y en a d’autres encore. Ainsi l ’on
peut supposer que le barrage qui soutient le lac vient à être supprimé, et alors le
lac-cessera évidemment d’exister. Tel serait le cas du lac de Marjelen voir (page 249)
si, par suite d’un changement de climat, le glacier d Aletsch se retirait au-dessus
de 2 400 mètres. Il arrive aussi très souvent que, dans les régions sèches,
les eaux d’un lac disparaissent entièrement par évaporation; l’Utah et la Nevada,
1. Voir p age 121.
2 . Voir en tr e a u tr e s le travail d e M. D a v is sur la Seine, la Meuse e t la Moselle (Ann. Géogr.
5e a n n é e , 15 octobr e 1895, p. 25 e t seq.).