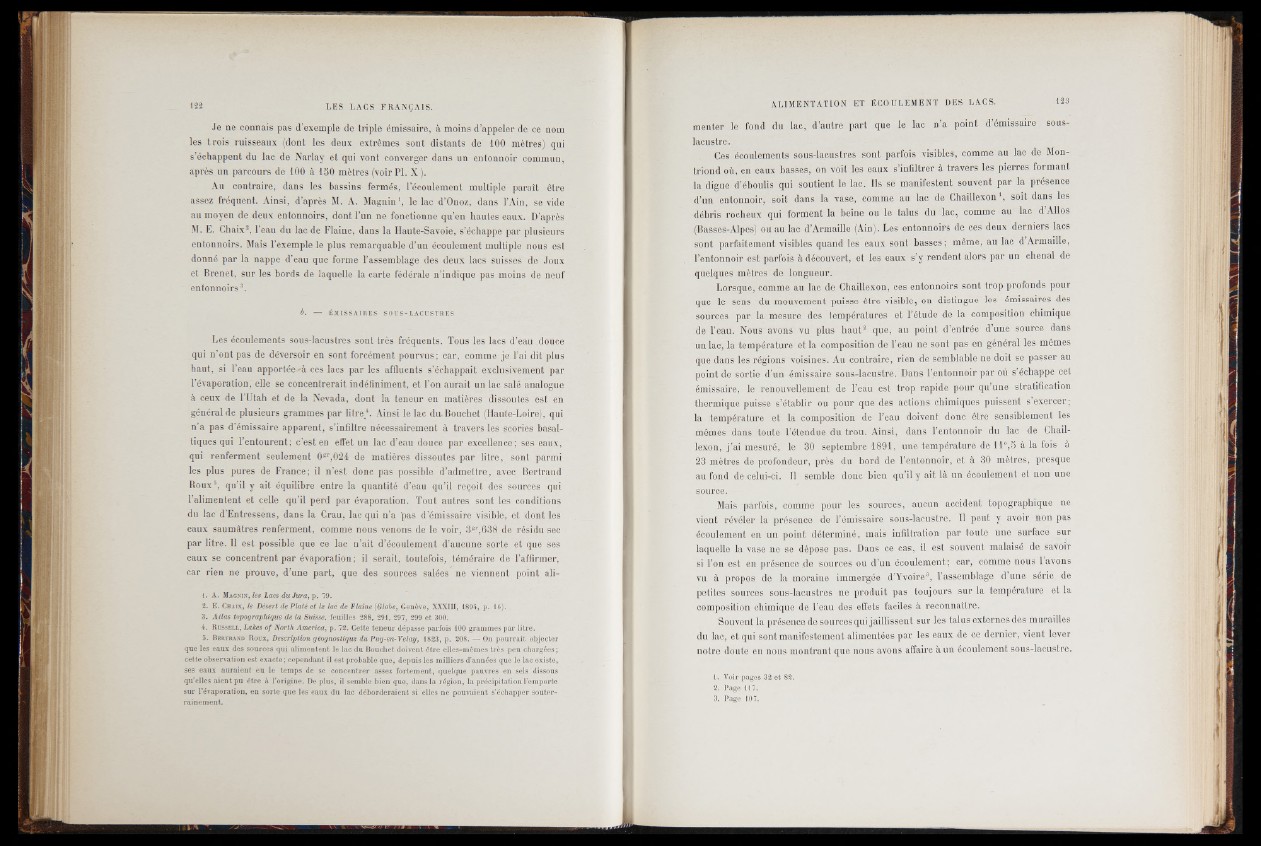
Je ne connais pas d’exemple de triple émissaire, à moins d’appeler de ce nom
les trois ruisseaux (dont les deux extrêmes sont distants de 100 mètres) qui
s’échappent du lac de Narlay et qui vont converger dans un entonnoir commun,
après un parcours de 100 à 150 mètres (voir Pl. X ).
Au contraire, dans les bassins fermés, l’écoulement multiple parait être
assez fréquent. Ainsi, d’après M. A. Magnin1, le lac d’Onoz, dans l’Ain, se vide
au moyen de deux entonnoirs, dont l’un ne fonctionne qu’en hautes eaux. D’après
M. E. Chaixs, l’eau du lac de Flaine, dans la Haute-Savoie, s’échappe par plusieurs
entonnoirs. Mais l’exemple le plus remarquable d’un écoulement multiple nous est
donné par la nappe d’eau que forme l’assemblage des deux lacs suisses de Joux
et Brenet, sur les bords de laquelle la carte fédérale n’indique pas moins de neuf
entonnoirs3.
b . 9 ÉM IS SA IR E S SOUS-LACUSTRES
Les écoulements sous-lacustres sont très fréquents. Tous les lacs d’eau douce
qui n’ont pas de déversoir en sont forcément pourvus; car, comme je l’ai dit plus
haut, si l’eau apportée >à ces lacs par les affluents s’échappait exclusivement par
l’évaporation, elle se concentrerait indéfiniment, et l’on aurait un lac salé analogue
à ceux de l’Utah et de la Nevada, dont la teneur en matières dissoutes est en
général de plusieurs grammes par litre *. Ainsi le lac du. Bouchot (Haute-Loire), qui
n’a pas d’émissaire apparent, s’infiltre nécessairement à travers les scories basaltiques
qui l’entourent; c’est en effet un lac d’eau douce par excellence; ses eaux,
qui renferment seulement 0^,024 de matières dissoutes par litre, sont parmi
les plus pures de France; il n’est donc pas possible d’admettre, avec Bertrand
Roux5, qu’il y ait équilibre entre la quantité d’eau qu’il reçoit des sources qui
l’alimentent et celle qu’il perd par évaporation. Tout autres sont les conditions
du lac d'Entressens, dans la Crau, lac qui n’a pas d’émissaire visible, et dont les
eaux saumâtres renferment, comme nous venons de le voir, 3Br,638 de résidu sec
par litre. 11 est possible que ce lac n’ait d’écoulement d’aucune sorte et que ses
eaux se concentrent par évaporation ; il serait, toutefois, téméraire de l’affirmer,
car rien ne prouve, d’une part, que des sources salées ne viennent point ali-
1. A. Magnin, les Lacs d u Jura, p . 79.
2 . E. Chaix, le Désert d e P la té e t le lac d e Flaine [Globe, Genève, XXXIII, 1894, p. 16).
3 . A lla s topographique d e la Suisse, fe u ille s 288, 291, 297, 299 e t 300.
4 . R u s s e l l , Lakes o f No rth Ame rica , p . 72. Cette ten eu r d ép a sse parfois 100 g ram m e s p ar litr e .
5. Bertrand R oux, Description géognostique du P u y -en -V e la y , 1823, p . 208. — On p our ra it o b jec ter
q u e le s ea u x d e s so u r c e s q u i a lim en te n t le la c du B ouche t d o iv en t ê tr e e lle s -m êm e s tr è s p eu ch a rg é e s ;
c e tte ob serv a tion e s t e x a c te ; c ep en d an t il e s t p rob able q u e , d ep u is l e s m illie r s d’an n é e s q u e le la c e x iste ,
s e s e a u x au ra ien t eu l e tem p s d e s e c o n c en tr e r a sse z fo r tem en t, q u e lq u e p auvr es en s e ls d issous
qu’e lle s a ien t p u ê tr e à l ’o r ig in e . De p lu s, il sem b le b ie n q ue , dans la r é g io n , la p r é c ip ita tio n l ’em po r te
su r l’év ap o ra tion , e n so r te q u e le s ea u x du la c d éb o rd e ra ien t s i e lle s n e p o u v a ien t s ’échap p er so u te r -
r a in em en t.
menter le fond du lac, d’autre part que le lac n’a point d’émissaire sous-
lacustre.
Ces écoulements sous-lacustres sont parfois visibles, comme au lac de Mon-
triond où, en eaux basses, on voit les eaux s’infiltrer à travers les pierres formant
la digue d’éboulis qui soutient le lac. Ils se manifestent souvent par la présence
d’un entonnoir, soit dans la vase, comme au lac de Chaillexon \ soit dans les
débris rocheux qui forment la beine ou le talus du lac, comme au lac d Allos
(Basses-Alpes) ou au lac d’Armaille (Ain). Les entonnoirs de ces deux derniers lacs
sont parfaitement visibles quand les eaux sont basses; même, au lac d Armaille,
l’entonnoir est parfois à découvert, et les eaux s’y rendent alors par un chenal de
quelques mètres de longueur.
Lorsque, comme au lac de Chaillexon, ces entonnoirs sont trop profonds pour
que le sens du mouvement puisse être visible, on distingue les émissaires des
sources par la mesure des températures et l’étude de la composition chimique
de l’eau. Noua avons vu plus haut2 que, au point d’entrée d’une source dans
un lac, la température et la composition de l’eau ne sont pas en général les mêmes
que dans les régions voisines. Au contraire, rien de semblable ne doit se passer au
point de sortie d’un émissaire sous-lacustre. Dans l’entonnoir par où s’échappe cet
émissaire, le renouvellement de l’eau est trop rapide pour qu’une stratification
thermique puisse s’établir ou pour que des actions chimiques puissent s’exercer;
la température et la composition de l’eau doivent donc être sensiblement les
mêmes dans toute l’étendue du trou. Ainsi, dans l’entonnoir du lac de Chaillexon,
j’ai mesuré, le 30 septembre 1891, une température de 11°,5 à la fois à
23 mètres de profondeur, près du bord de l’entonnoir, et à 30 mètres, presque
au fond de celui-ci. Il semble donc bien qu’il y ait là un écoulement et non une
source. —
Mais parfois, comme pour les sources, aucun accident topographique ne
vient révéler la présence de l’émissaire sous-lacustre. Il peut y avoir non pas
écoulement en un point déterminé, mais infiltration par toute une surface sur
laquelle la vase ne se dépose pas. Dans ce cas, il est souvent malaisé de savoir
si l’on est en présence .de sources ou d’un écoulement; car, comme nous lavons
vu à propos de la moraine immergée d’Yvoire3, l’assemblage d’une série de
petites sources sous-lacustres ne produit pas toujours sur la température et la
composition chimique de l’eau des effets faciles à reconnaître.
Souvent la présence de sources qui jaillissent sur les talus externes des murailles
du lac, et qui sont manifestement alimentées par les eaux de ce dernier, vient lever
notre doute en nous montrant que nous avons affaire à un écoulement sous-lacustre.
d. Voir p ages 32 e t 82.
2. P a g e 117.
3. P a g e 107.