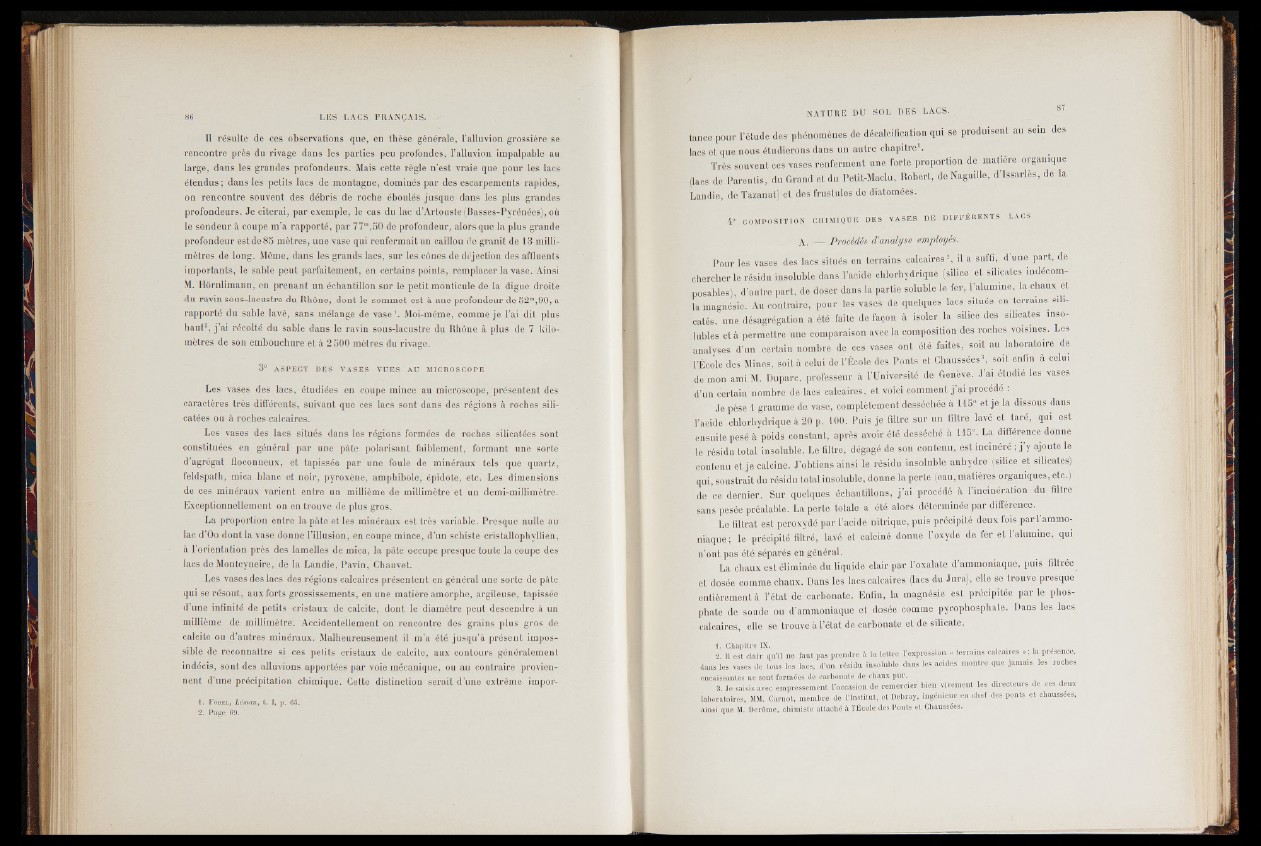
Il résulte de ces observations que, en thèse générale, l’alluvion grossière se
rencontre près du rivage dans les parties peu profondes, l’alluvion impalpable au
large, dans les grandes profondeurs. Mais cette règle n’est vraie que pour les lacs
étendus; dans les petits lacs de montagne, dominés par des escarpements rapides,
on rencontre souvent des débris de roche éboulés jusque dans les plus grandes
profondeurs. Je citerai, par exemple, le cas du lac d’Artouste (Basses-Pyrénées), où
le sondeur à coupe m’a rapporté, par 77“,50 de profondeur, alors que la plus grande
profondeur estde85 mètres, une vase qui renfermait un caillou do granit de 13 millimètres
de long. Même, dans les grands lacs, sur les cônes de déjection des affluents
importants, le sable peut parfaitement, en certains points, remplacer la vase.-Ainsi
M. Hôrnlimann, en prenant un échantillon sur le petit monticule de la digue droite
du ravin sous-lacustre du Rhône, dont le sommet est à une profondeur de 52“,90, a
rapporté du sable lavé, sans mélange de vase1. Moi-même, comme je l’ai dit plus
haut®, j ’ai récolté du sable dans le ravin sous-lacustre du Rhône à plus de 7 kilomètres
de son embouchure et à 2 500 mètres du rivage.
3° A S P E C T D E S V A S E S V U E S A U M IC RO SCO PE
Les vases des lacs, étudiées en coupe mince au microscope, présentent des
caractères très différents, suivant que ces lacs sont dans des régions à roches sili-
catées ou à roches calcaires.
Les vases des lacs situés dans les régions formées de roches silicatées sont
constituées en général par une pâte polarisant faiblement, formant une sorte
d’agrégat floconneux, et tapissée par une foule de minéraux tels que quartz,
feldspath, mica blanc, et noir, pyroxène, amphibole, épidote, etc. Les dimensions
de ces minéraux varient entre un millième de millimètre et un demi-millimètre.
Exceptionnellement on en trouve de plus gros.
La proportion entre la pâte et les minéraux est très variable. Presque nulle au
lac d’Oo dont la vase donne l’illusion, en coupe mince, d’un schiste cristallophyllien,
à l’orientation près des lamelles de mica, la pâte occupe presque toute la coupe des
lacs de Montcyneire, de la Landie, Pavin, Chauvet.
Les vases des lacs des régions calcaires présentent en général une sorte de pâte
qui se résout, aux forts grossissements, en une matière amorphe, argileuse, tapissée
d’une infinité de petits cristaux de calcite, dont le diamètre peut descendre à un
millième de millimètre. Accidentellement on rencontre des grains plus gros de
calcite ou d’autres minéraux. Malheureusement il m’a été jusqu’à présent impossible
de reconnaître si ces pelits cristaux de calcite, aux contours généralement
indécis, sont des alluvions apportées par voie mécanique, ou au contraire proviennent
d’une précipitation chimique. Cette distinction serait d’une extrême impor-
1. F o r e l, Léman, t. I, p . 65.
2. P a g e 69.
N A T U R E DU SO L DE S LACS . . 87
tance pour l’étude des phénomènes de décalcification qui se produisent au sein des
lacs et que nous étudierons dans un autre chapitre .
Très souvent ces vases renferment une forte proportion de matière organique
-(lacs de Parentis, du Grand et du Petit-Maclu, Robert, deNaguille, d’Issarlès, de la
Landie, de Tazanat) et des frustules de diatomées.
4° C O M PO S IT IO N C H IM IQ U E D E S V A S E S DE D IF F É R E N T S LACS
A.r-À^ Procédés d'analyse employés.
Pour les vases des lacs situés en terrains calcaires2, il a suffi, d’une part, de
chercher le résidu insoluble dans l’acide c h l o r h y d r i q u e (silièe et silicates indécom-
posables), d’autre part, de doser dans la partie soluble le fer, l’alumine, la chaux et
la magnésie. Au contraire, pour les vases de quelques lacs situés en terrains sili-
catés, une désagrégation a été faite de façon à isoler la silice des silicates insolubles
et à permettre une comparaison avec la composition des roches voisines. Les
analyses d’un certain nombre de ces vases ont été faites, soit au laboratoire de
l’École des Mines, soit à celui de l’École des Ponts et Chaussées3, soit enfin à celui
de mon ami M. Duparc, professeur à l’Université de Genève. J’ai étudie les vases
d’un certain nombre de lacs calcaires, et voici comment j’ai procédé :
Je pèse 1 gramme de vase, complètement desséchée à 115° et je la dissous dans
l’acide chlorhydrique à 20 p. 100. Puis je filtre sur un filtre lavé et taré, qui çst
ensuite pesé à poids constant, après avoir été desséché à 115“. La différence donne
le résidu total insoluble. Le filtre, dégagé de son contenu, est incinéré ; j ’y ajoute le
contenu et je calcine. J’obtiens ainsi le résidu insoluble anhydre (silice et silicates)
qui, soustrait du résidu total insoluble, donne la perte (eau, matières organiques, etc.)
de ce dernier. Sur quelques échantillons, j ’ai procédé à l’incinération du filtre
sans pesée préalable. La perte totale a été alors déterminée par différence. ^
Le filtrat est peroxydé par l’acide nitrique, puis précipité deux fois pari ammoniaque;
le précipité filtré, lavé et calciné donne l’oxyde de fer et l’alumine, qui
n’ont pas été séparés en général.
La chaux est éliminée du liquide clair par l’oxalate d’ammoniaque, puis filtrée
et dosée comme chaux. Dans les lacs calcaires (lacs du Jura), elle se trouve presque
entièrement à l’état de carbonate. Enfin, la magnésie est précipitée parle phosphate
de soude ou d’ammoniaque et dosée comme pyrophosphate. Dans les lacs
calcaires, elle se trouve à l’état de carbonate et de silicate.
1. Chapitre IX. - ,
•2. Il e s t c la ir q u'il n e fa u t p a s p r en d re à la le tt r e l'e x p r e s s io n « te r r a in s ca lc a ir e s » ; la p r e s e n c e ,
dans le s va ses d e to u s le s la c s , d’u n r é s id u in so lu b le dans l e s a c id e s m o n tr e q u e jam a is le s r o ch e s
en ca issa n te s n e so n t fo rm é e s de carbon ate d e ch a u x pur.
3. Je sa is is a v e c em p r e ssem en t l'o c c a sio n de remer cier ' b ie n v iv em en t les: d ir e c teu r s d e c e s d eu x
la b o r a to ir e s, MM. Carnot, m em b r e d e l'In stitu t, e t Debray, in g é n ie u r en c h e f d e s p'onts e t ch a u ssé e s,
ainsi que M. D e rôm e , ch im is te atta ch é à l’É co le d es P on ts e t Chaussées.