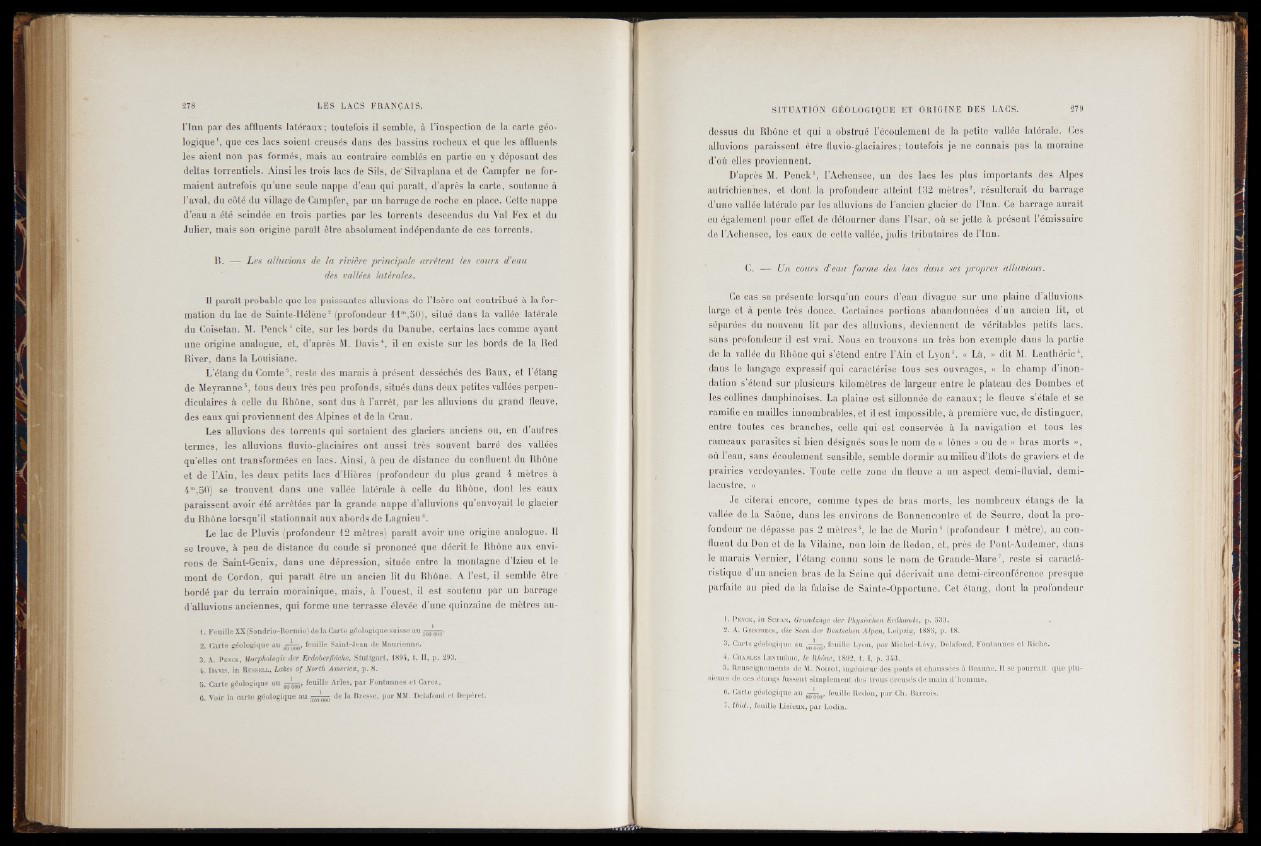
l’Inn par des affluents latéraux; toutefois il semble, à l’inspection de la carte géologique1,
que ces lacs soient creusés dans des bassins rocheux et que les affluents
les aient non pas formés, mais au contraire comblés en partie en y déposant des
deltas torrentiels. Ainsi les trois lacs de Sils, de' Silvaplana et de Campfer ne formaient
autrefois qu’une seule nappe d’eau qui paraît, d’après la carte, soutenue à
l’aval, du côté du village de Campfer, par un barrage de roche en place. Cette nappe
d’eau a été scindée en trois parties par les torrents descendus du Val Fex et du
Julier, mais son origine parait être absolument indépendante de ces torrents.
B. — Les allumons de la rivière principale arrêtent les cours d’eau
des vallées latérales.
11 parait probable que les puissantes alluvions de l’Isère ont contribué à la formation
du lac de Sainte-Hélène2 (profondeur 11”,50), situé dans la vallée latérale
du Coisetan. M. Penck3 cite, sur les bords du Danube, certains lacs comme ayant
une origine analogue, et, d’après M. Davis*, il en existe sur les bords de la Red
River, dans la Louisiane.
L’étang du Comte5, reste des marais à présent desséchés des Baux, et l’étang
de Meyranne5, tous deux très peu profonds, situés dans deux petites vallées perpendiculaires
à celle du Rhône, sont dus à l’arrêt, par les alluvions du grand fleuve,
des eaux qui proviennent des Alpines et de la Crau.
Les alluvions des torrents qui sortaient des glaciers anciens ou, en d’autres
termes, les alluvions fluvio-glaciaires ont aussi très souvent barré des vallées
qu’elles ont transformées en lacs. Ainsi, à peu de distance du confluent du Rhône
et de l’Ain, les deux petits lacs d’Hières (profondeur du plus grand 4 mètres à
4",50) se trouvent dans une vallée latérale à celle du Rhône, dont les eaux
paraissent avoir été arrêtées par la grande nappe d’alluvions qu’envoyait le glacier
du Rhône lorsqu’il stationnait aux abords de Lagnieu5.
Le lac de Pluvis (profondeur 42 mètres) parait avoir une origine analogue. Il
se trouve, à peu de distance du coude si prononcé que décrit le Rhône aux environs
de Saint-Genix, dans une dépression, située entre la montagne d’Izieu et le
mont de Cordon, qui parait être un ancien lit du Rhône. A l’est, il semble être
bordé par du terrain morainique, mais, à l’ouest, il est soutenu par un barrage
d’alluvions anciennes, qui forme une terrasse élevée d’une quinzaine de mètres au-
1. F e u ille XX (S on dr io-Bormio) d e la Carte g éo lo g iq u e su isse au 100‘Qti0-
2. Carte g éo lo g iq u e a u ¿ ¿ g , fe u ille Sa in t-J ean de Maurienne.
3 . A. P enck Morphologie d e r Erdoberfläche, S tu ttg a r t, 1894, t. II, p . 293.
4 . D a v is , in R u s s e l l , Lakes o f North Ame rica, p . 8.
5 . Carte g é o lo g iq u e au ¿ ¿ 5, fe u ille A r le s, p a r Fon tan ne s e t Carez.
6 . Voir la car te g é o lo g iq u e a u d e la B r e sse> Pa r MM- De lafond e t Depéret.
dessus du Rhône et qui a obstrué l’écoulement de la petite vallée latérale. Ces
alluvions paraissent être fluvio-glaciaires; toutefois je ne connais pas la moraine
d’où elles proviennent.
D’après M. Penck1, l’Achensee, un des lacs les plus importants des Alpes
autrichiennes, et dont la profondeur atteint 132 mètres2, résulterait du barrage
d’une vallée latérale par les alluvions de l ’ancien glacier de l’Inn. Ce barrage aurait
eu également pour effet de détourner dans l’Isar, où se jette à présent l’émissaire
de l’Achensee, les eaux de cette vallée, jadis tributaires de l’Inn.
C. —: Un cours d'eau forme des lacs dans ses propres alluvions.
Ce cas se présente lorsqu’un cours d’eau divague sur une plaine d’alluvions
large et à pente très douce. Certaines portions abandonnées d’un ancien lit, et
séparées du nouveau lit par des alluvions, deviennent de véritables petits lacs,
sans profondeur il est vrai. Nous en trouvons un très bon exemple dans la partie
de la vallée du Rhône qui s'étend entre l’Ain et Lyon3. « Là, » dit M. Lenthéric*,
dans le langage expressif qui caractérise tous ses ouvrages, « le champ d’inondation
s’étend sur plusieurs kilomètres de largeur entre le plateau des Dombes et
les collines dauphinoises. La plaine est sillonnée de canaux; le fleuve s’étale et se
ramifie en mailles innombrables, et il est impossible, à première vue, de distinguer,
entre toutes ces branches, celle qui est conservée à la navigation et tous les
rameaux parasites si bien désignés sous le nom de « lônes » ou de « bras morts »,
où l’eau, sans écoulement sensible, semble dormir au milieu d’ilots de graviers et de
prairies verdoyantes. Toute cette zone du fleuve a un aspect demi-fluvial, demi-
lacustre. »
Je citerai encore, comme types de bras morts, les nombreux étangs de la
vallée de la Saône, dans les environs de Bonnencontre et de Seurre, dont la profondeur
ne dépasse pas 2 mètres5, le lac de Murin6 (profondeur 1 mètre), au confluent
du Don et de la Vilaine, non loin de Redon, et, près de Pont-Audemer, dans
le marais Vernier, l’étang connu sous le nom de Grande-Mare7, reste si caractéristique
d’un ancien bras de la Seine qui décrivait une demi-circonférence presque
parfaite au pied de la falaise de Sainte-Opportune. Cet étang, dont la profondeur
1. P enck, in S upan, Grundzàge d e r Physischen Erdkunde, p . 533.
2 . A. Geistbeck, d ie Seen d e r Deutschen A lp en , Leipz ig, 1885, p. 18.
3. Carte g éo lo g iq u e au feu ille Lyon, par Miche l-Lévy, De la fond , F o n ta n n e s e t Rich e.
4. Charles L enthéric, le Rhône, 1892, t. I, p . 343.
5. R ense ign em en ts de M. Noirot, in g én ieu r d e s ponts e t ch a u ssé e s à B eau ne . Il se p our ra it q u e plu sieu
r s de c e s étang s fu ssen t s im p lem en t d e s trous c r eu sé s d e m a in d ’h om m e^
6. Carte g éo lo g iq u e a u feu ille Redon, p a r Ch. Barrois.
7. Ib id .f feu ille L isieux , p a r Lodin.