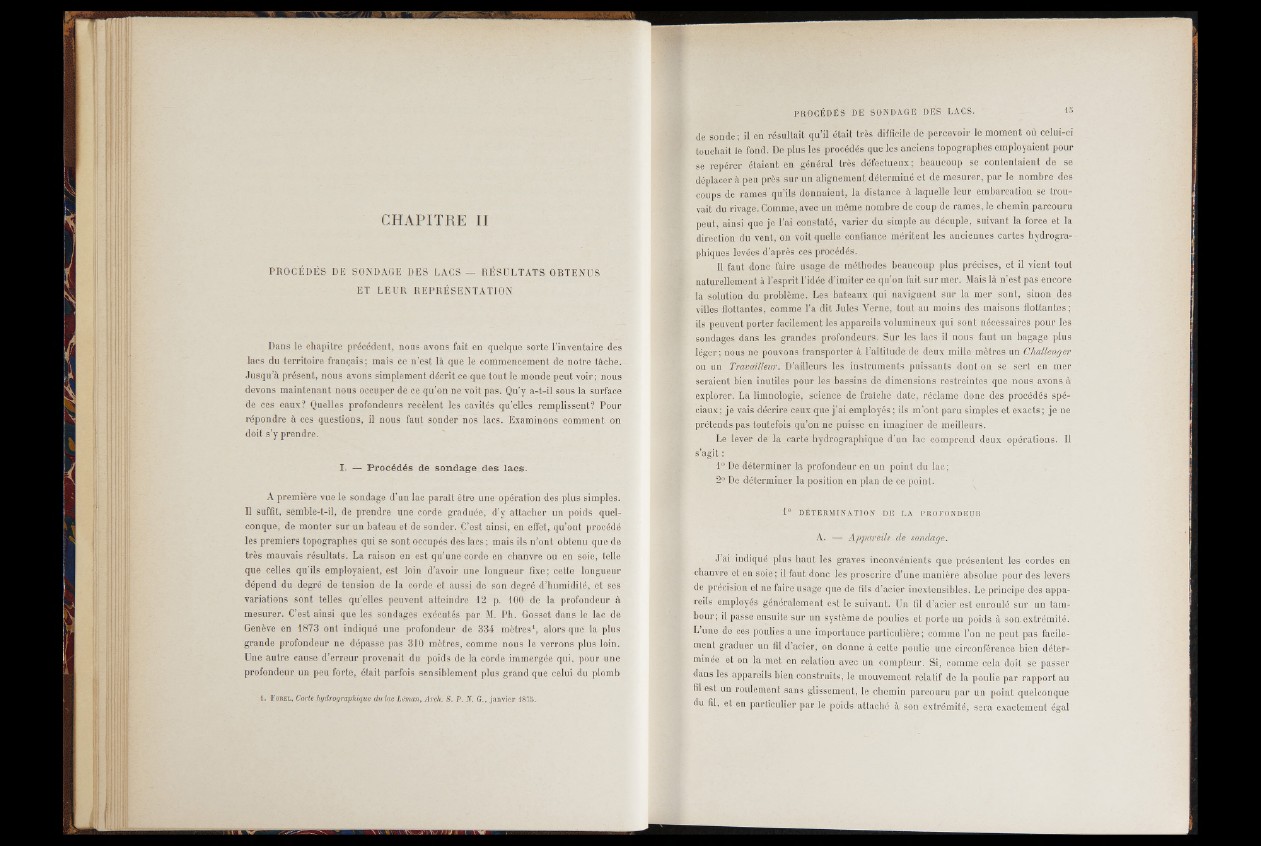
CHAPITRE II
PROCÉDÉS DE SONDAGE DES LACS — RÉSULTATS OBTENUS
ET LEUR REPRÉSENTATION
Dans le chapitre précédent, nous avons fait en quelque sorte l’inventaire des
lacs du territoire français; mais ce n’est là que le commencement de notre tâche..
Jusqu’à présent, nous avons simplement décrit ce que tout le monde peut voir; nous
devons maintenant nous occuper de ce qu’on ne voit pas. Qu’y a-t-il sous la surface
de ces eaux? Quelles profondeurs recèlent les cavités qu’elles remplissent? Pour
répondre à ces questions, il nous faut sonder nos lacs. Examinons comment on
doit s’y prendre.
I. ÿg Procédés de sondage des la cs.
A première vue le sondage d’un lac paraît être une opération des plus simples.
Il suffit, semble-t-il, de prendre une corde graduée, d’y attacher un poids quelconque,
de monter sur un bateau et de sonder. C’est ainsi, en effet, qu’ont procédé
les premiers topographes qui se sont occupés des lacs ; mais ils n’ont obtenu que de
très mauvais résultats. La raison en est qu’une corde en chanvre ou en soie, telle
que celles qu’ils employaient, est loin d’avoir une longueur fixe; cette longueur
dépend du degré de tension de la corde et aussi de son degré d’humidité, et ses
variations sont telles qu’elles peuvent atteindre 12 p. 100 de la profondeur à
mesurer. C’est ainsi que les sondages exécutés par M. Ph. Gosset dans le lac de
Genève en 1873 ont indiqué une profondeur de 334 mètres1, alors que la plus
grande profondeur ne dépasse pas 310 mètres, comme nous le verrons plus loin.
Une autre cause d’erreur provenait du poids de la corde immergée qui, pour une
profondeur un peu forte, était parfois sensiblement plus grand que celui du plomb
1. F o r e l, Carte h yd ro g ra phiqu e d u lac Léman, Arch. S . P. N. G., ja n v ie r 1875.
P R O C É D É S D E S O N D A G E D É S L A C S . ; — 15
de sonde; il en résultait qu’il était très difficile de percevoir lë moment où celui-ci
touchait le fond. De plus les procédés que les anciens topographes employaient pour
se repérer étaient en général très défectueux; beaucoup se contentaient de se
déplacer'à peu près sur un alignement déterminé et de mesurer, par le nombre des
coups de rames qu’ils donnaient, la distance à laquelle leur embarcation se trouvait
du rivage. Comme,avec un même nombre de coup de rames, le chemin parcouru
peut, ainsi que je l’ai constaté, varier du simple au décuple, suivant la force et la
direction du vent, on voit quelle confiance méritent les anciennes cartes hydrographiques
levées d’après ces procédés.
Il faut donc faire usage de méthodes beaucoup plus précises, et il vient tout
naturellement à l’esprit l ’idée d’imiter ce qu’on fait sur mer. Mais là n’est pas encore
la solution du problème. Les bateaux qui naviguent sur la mer sont, sinon des
villes flottantes, comme l’a dit Jules Verne, tout au moins des maisons flottantes ;
ils peuvent porter facilement les appareils volumineux qui sont nécessaires pour les
sondages dans les grandes profondeurs. Sur les lacs il nous faut un bagage plus
léger; nous ne pouvons transporter à l’altitude de deux mille-mètres un Challenger
ou un Travailleur. D’ailleurs les instruments puissants dont on se sert en mer
seraient bien inutiles pour les bassins de dimensions restreintes que nous avons à
explorer. La limnologie, science de fraîche date, réclame donc des procédés spéciaux;
je vais décrire ceux que j ’ai employés; ils m’ont paru simples et exacts;; je ne
prétends pas toutefois qu’on ne puisse en imaginer de meilleurs.
Le lever de la carte hydrographique d’un lac comprend deux opérations. Il
s’agit :
1° De déterminer la profondeur en un point du lac;
2° De déterminer la position en plan de ce point.
1° D É T E R M IN A T IO N D E L A PR O FO N D E U R
A. 9 Appareils de sondage.
J ai indiqué plus haut les graves inconvénients que présentent les cordes en
chanvre et en soie ; il faut donc les proscrire d’une manière absolue pour des levers
de précision et ne faire usage que de fils d’acier inextensibles. Le principe des appareils
employés généralement est le suivant. Un fil d’acier est enroulé sur un tambour;
il passe ensuite sur un système de poulies et porte un poids à son. extrémité.
L une de ces poulies a une importance particulière ; comme l’on ne peut pas facilement
graduer un fil d’acier, on donne à cette poulie une circonférence bien déterminée
et on la met en relation avec un compteur. Si, comme cela doit se passer
dans les appareils bien construits, le mouvement relatif de la poulie par rapport au
fil est un roulement sans glissement, le chemin parcouru par un point quelconque
du fil, et en particulier par le poids attaché à son extrémité, sera exactement égal