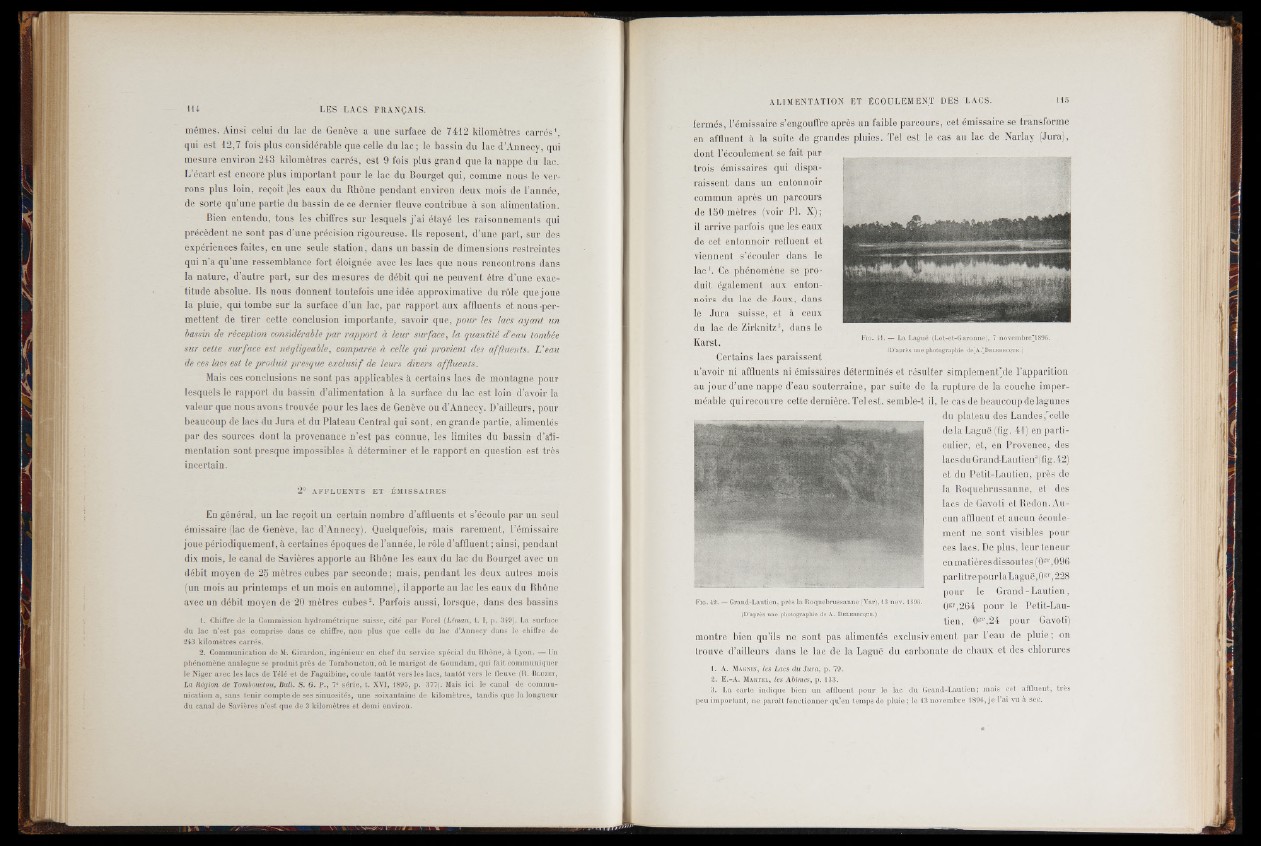
mêmes. Ainsi celui du lac de Genève a une surface de 7412 kilomètres carrés1,
qui est 12,7 fois plus considérable que celle du lac; le bassin du lac d’Annecy, qui
mesure environ 243 kilomètres carrés, est 9 fois plus grand que la nappe du lac.
L’écart est encore plus important pour le lac du Bourget qui, comme nous le verrons
plus loin, reçoit (les eaux du Rhône pendant environ deux mois de l’année,
de sorte qu’une partie du bassin de ce dernier fleuve contribue à son alimentation.
Bien entendu, tous les chiffres sur lesquels j’ai étayé les raisonnements qui
précèdent ne sont pas d’une précision rigoureuse. Ils reposent, d’une part, sur des
expériences faites, en une seule station, dans un bassin de dimensions restreintes
qui n’a qu’une ressemblance fort éloignée avec les lacs que nous rencontrons dans
la nature, d’autre part, sur des mesures de débit qui ne peuvent être d’une exactitude
absolue. Ils nous donnent toutefois une idée approximative du rôle que joue
la pluie, qui tombe sur la surface d’un lac, par rapport aux affluents et nous -permettent
de tirer cette conclusion importante, savoir que, pour les lacs ayant un
bassin de réception considérable par rapport à leur surface, la quantité d'eau tombée
sur cette surface est négligeable, comparée à celle qui provient des affluents. L'eau
de ces lacs est le produit presque exclusif de leurs divers affluents.
Mais ces conclusions ne sont pas applicables à certains lacs de montagne pour
lesquels le rapport du bassin d’alimentation à la surface du lac est loin d’avoir la
valeur que nous avons trouvée pour les lacs de Genève ou d’Annecy. D’ailleurs, pour
beaucoup de lacs du Jura et du Plateau Central qui sont, en grande partie, alimentés
par des sources dont la provenance n’est pas connue, les limites du bassin d’alimentation
sont presque impossibles à déterminer et le rapport en question est très
incertain.
2° A F F L U E N T S E T É M I S S A IR E S
En général, un lac reçoit un certain nombre d’affluents et s’écoule par un seul
émissaire (lac de Genève, lac d’Annecy). Quelquefois,- mais rarement, l’émissaire
joue périodiquement, à. certaines époques de l’année, le rôle d’affluent ; ainsi, pendant
dix mois, le canal de Savières apporte au Rhône les eaux du lac du Bourget avec un
débit moyen de 25 mètres cubes par seconde ; mais, pendant les deux autres mois
(un mois au printemps et un mois en automne), il apporte au lac les eaux du Rhône
avec un débit moyen de 20 mètres cubes*. Parfois aussi, lorsque, dans des bassins
1. Chiffre d e la Com mission h yd r om é tr iq u e su isse , c ité p a r Fore t {Léman, t. I, p. 349). La su rfa c e
du la c n 'e s t pas com pr ise dans c e ch iffr e, n o n p lu s q u e c e lle du la c d’An ne cy dans le chiffre de
243 k ilom è tr e s car ré s.
2 . C om m un ica tion d e M. Girardon, in g é n ie u r en ch e f du s e r v ic e sp é c ia l du R h ôn e , à Lyon. — Un
p h én om èn e an a lo gu e s e p rod uit p rès d e T om b ouc tou , où l e m a r ig o t d e Goundam, q ui fa it com m u n iq u e r
le N ig e r a v e c le s la c s d e Télé e t de F a g u ih in e , c o u le tan tô t v e r s le s la c s, ta n tô t ver s l e fleu v e {R. Bluzgt,
L a Région de Tombouctou, Bull. S. G. P ., I e s é r ie , t. XVI, 1895, p. 377). Mais ic i. le can a l d e com mu n
ic a tio n a , sa n s ten ir com p te de se s s in u o s ité s , u n e so ix a n ta in e d e k ilom è tr e s , tau d is que la lon gu eu r
du can a l d e S a v iè re s n ’e s t q u e de 3 k ilom è tr e s e t d em i en v iron .
fermés, l’émissaire s’engouffre après un faible parcours, cet émissaire se transforme
en affluent à la suite de grandes pliiies. Tel est le cas au lac de Narlay (Jura),
dont l’écoulement se fait par
trois émissaires qui disparaissent
dans un entonnoir
commun après un parcours
de 150 mètres (voir Pl. X) ;
il arrive parfois que les eaux
de cet entonnoir refluent et
viennent s’écouler dans le
lac1. Ce phénomène se produit
également aux entonnoirs
du lac de Joux, dans
le Jura suisse, et à ceux
du lac de Zirknitz*, dans le
Karst.
Certains lacs paraissent
n’avoir ni affluents ni émissaires déterminés et résulter simplemenCde l’apparition
au jour d’une nappe d’eau souterraine, par suite de la rupture de la couche imperméable
qui recouvre cette dernière. Tel est, semble-t il, le cas de beaucoup delagunes
du plateau des Landes,rcelle
delà Laguë (fig. 41) en particulier,
et, en Provence, des
lacsduGrand-Lautien8(fig.42)
et du Petit-Lautien, près de
Ja Roquebrussanne, et des
lacs de Gavoti et Redon. Aucun
affluent et aucun écoulement
ne sont visibles pour
ces lacs. De plus, leur teneur
en matières dissoutes (0gr, 096
parlitrepourlaLaguë,0gr,228
pour le Grand - Lautien,
0er,264 pour le Petit-Lau-
tien, 0sr,24 pour Gavoti)
Fig. 42. — Grand-Lautien, près la Roquebrussanne (Var), 13 nov. 1896.
(D’après une photographie de A. Delkbecqok.)
montre bien qu’ils ne sont pas alimentés exclusivement par l’eau de pluie; on
trouve d’ailleurs dans le lac de la Laguë du carbonate de chaux et des chlorures
1. A. Magnin, les Lacs du Jura, p . 79.
2. E .-A . Martel, les Abîmes, p . 133.
3. La carte in d iq u e b ie n u n a fflu en t p o u r l e la c du Gran d-Lau tien ; ma is c e t a fflu en t, tr ès
p eu imp o rtan t, n e p araît fo n c tio n n e r qu’en tem p s de p lu ie ; l e 13 n o v em b r e 1896, j e l ’ai v u à se c .