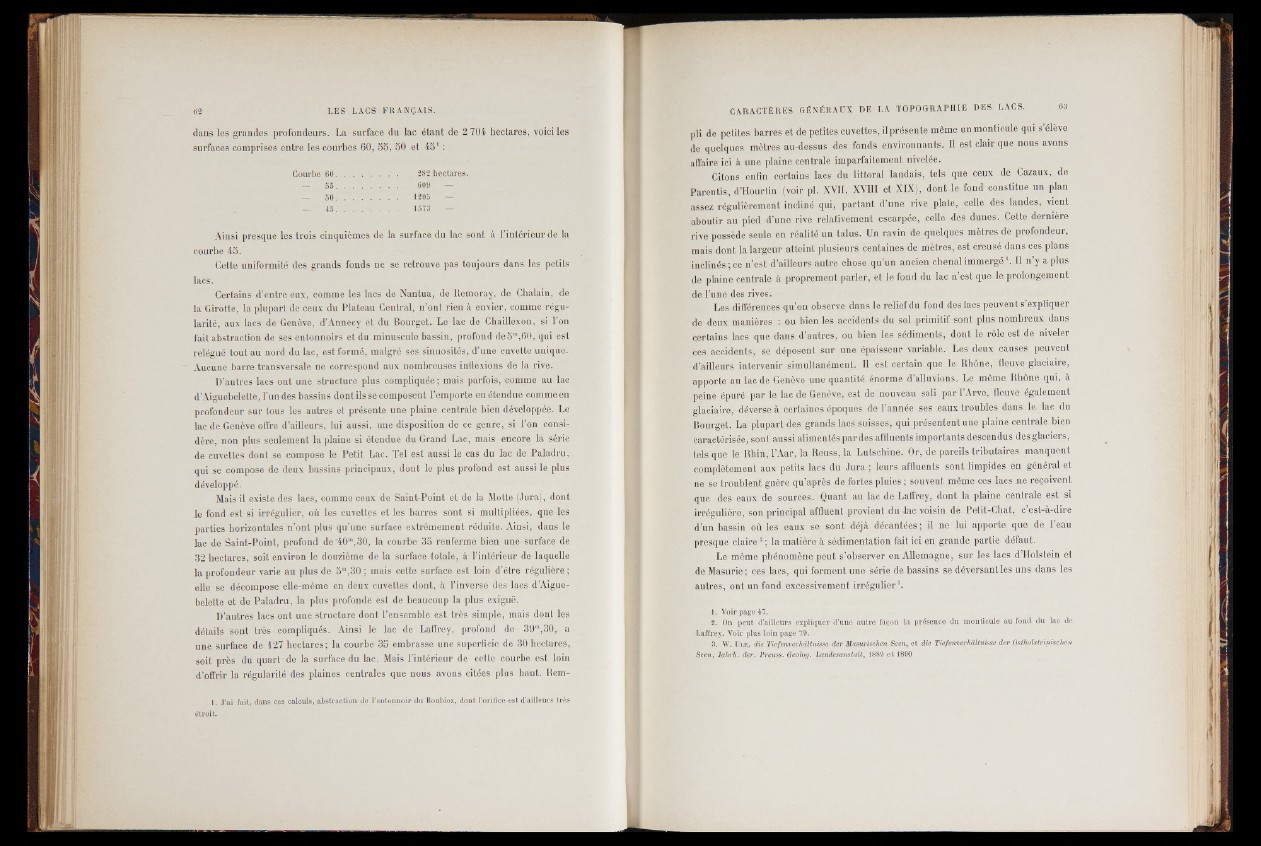
dans les grandes profondeurs. La surface du lac étant de 2 704 hectares, voici les
surfaces comprises entre les courbes 60, 5b, 50 et 45* :
C o u rb e 6 0 . . . jj . . . . 2 8 2 h e c t a r e s .
— 5 5 ............................................. 6 0 9 —
5 0 ........................................... 1 2 0 5
4 8 .......................................... 1 5 7 3 ÿ i f î ' à
Ainsi presque les trois cinquièmes de la surface du lac sont à l’intérieur de la
Courbe 45.
Cette uniformité des grands fonds ne se retrouve pas toujours dans les petits
lacs.
Certains d’entre eux, comme les lacs de Nantua, de Remoray, de Chalain, de
la Girotte, la plupart de ceux du Plateau Central, n’ont rien à envier, comme régularité,
aux lacs de Genève, d’Annecy et du Bourget. Le lac de Chaillexon, si l’on
fait abstraction de ses entonnoirs et du minuscule bassin, profond de5m,60, qui est
relégué tout au nord du lac, est formé, malgré ses sinuosités, d’une cuvette unique.
Aucune barre transversale ne correspond aux nombreuses inflexions de la rive.
D’autres lacs ont une structure plus compliquée ; mais parfois, comme au lac
d’Aiguebelette, l’un des bassins dont ils se composent l’emporte en étendue commeen
profondeur sur tous les autres et présente une plaine centrale bien développée. Le
lac de Genève offre d’ailleurs, lui aussi, une disposition de ce genre, si l’on considère,
non plus seulement la plaine si étendue du Grand Lac, mais encore la série
de cuvettes dont se compose le Petit Lac. Tel est aussi le cas du lac de Paladru,
qui se compose de deux bassins principaux, dont le plus profond est aussi le plus
développé.
Mais il existe des lacs, comme ceux de Saint-Point et de la Motte (Jura), dont
le fond est si irrégulier, où les cuvettes et les barres sont si multipliées, que les
parties horizontales n’ont plus qu’une surface extrêmement réduite. Ainsi, dans le
lac de Saint-Point, profond de •40“,30, la courbe 35 renferme bien une surface de
32 hectares, soit environ le douzième de la surface totale, à l’intérieur de laquelle
la profondeur varie au plus de 5™,30 ; mais cette surface est loin d’être régulière ;
elle se décompose elle-même en deux cuvettes dont, à l’inverse des lacs d’Aiguebelette
et de Paladru, la plus profonde est de beaucoup la plus exiguë.
D’autres lacs ont une structure dont l’ensemble est très simple, mais dont les
détails sont très-compliqués. Ainsi le lac de Laffrey, profond de 39“,30, a
une surface de 127 hectares; la courbe 35 embrasse une superficie de 30 hectares,
soit près du quart de la surface du lac. Mais l’intérieur de cette courbe est loin
d’offrir la régularité des plaines centrales que nous avons citées plus haut. Rem-
\ . J’a i fa it, d ans c e s c a lcu ls , a b stra c tion d e l’en to n n o ir du Boubioz, d ont l’o rific e e s t d’a illeu r s très
é tro it.
pli de petites barres et de petites cuvettes, il présente même un monticule qui s élève
de quelques mètres au-dessus des fonds environnants. Il est clair que nous avons
affaire ici à une plaine centrale imparfaitement nivelée.
Citons enfin certains lacs du littoral landais, tels que ceux de Cazaux, de
Parentis, d’Hourtin (voir pl. XVII, XVIII et XIX), dont le fond constitue un plan
assez régulièrement incliné qui, partant d’une rive plate, celle des landes, vient
aboutir au pied d’une rive relativement escarpée, celle des dunes. Cette dernière
rive possède seule en réalité un talus. Un ravin de quelques mètres de profondeur,
mais dont la largeur atteint plusieurs centaines de mètres, est creusé dans ces plans
inclinés; ce n’est d’ailleurs autre chose qu’un ancien chenal immergé *. Il n’y a plus
de plaine centrale à proprement parler, et le fond du lac n’est que le prolongement
de l’une des rives.
Les différences qu’on observe dans le relief du fond des lacs peuvent s’expliquer
de deux manières : ou bien les accidents du sol primitif sont plus nombreux dans
certains lacs que dans d’autres, ou bien les sédiments, dont le rôle est de niveler
ces accidents, se déposent sur une épaisseur variable. Les deux causes peuvent
d’ailleurs intervenir simultanément. Il est certain que le Rhône, fleuve glaciaire,
apporte au lac de Genève une quantité énorme d’alluvions. Le même Rhône qui, à
peine épuré par le lac de Genève, est de nouveau sali par l’Arve, fleuve également
glaciaire, déverse à certaines époques de l’année ses eaux troubles dans le lac du
Bourget. La plupart des grands lacs suisses, qui présentent une plaine centrale bien
caractérisée, sont aussi alimentés par des affluents im portants descendus des glaciers,
tels que le Rhin, l’Aar, la Reuss, la Lutschine. Or, de pareils tributaires manquent
complètement aux petits lacs du Jura ; leurs affluents sont limpides en général et
ne se troublent guère qu’après de fortes pluies ; souvent même ces lacs ne reçoivent
que des eaux de sources. Quant au lac de Laffrey, dont la plaine centrale est si
irrégulière, son principal affluent provient du lac voisin de Petit-Chat, c est-a-dire
d’un bassin où les eaux se sont déjà décantées; il ne lui apporte que de l’eau
presque claire* ; la matière à sédimentation fait ici en grande partie défaut.
Le même phénomène peut s’observer en Allemagne, sur les lacs d’Holstein et
de Masurie; ces lacs, qui forment une série de bassins se déversant les uns dans les
autres, ont un fond excessivement irrégulier3.
1. Voir pa g e 47.
2. On p eu t d’a ille u r s e x p liq u e r d’u n e au tr e fa ç o n la p r é sen c e du m o n ticu le a u fond du la c de
Laffr ey. Voir p lu s lo in p a g e 79.
3. W. U le , d ie Tiefenverhàltnisse d e r Masurischen Seen, e t d ie Tiefenverhàltnisse d e r Ostholsteinischen
Seen, Jahrb. d e r. Preuss. Geolog. L an desan stalt, 1889 e t 1890