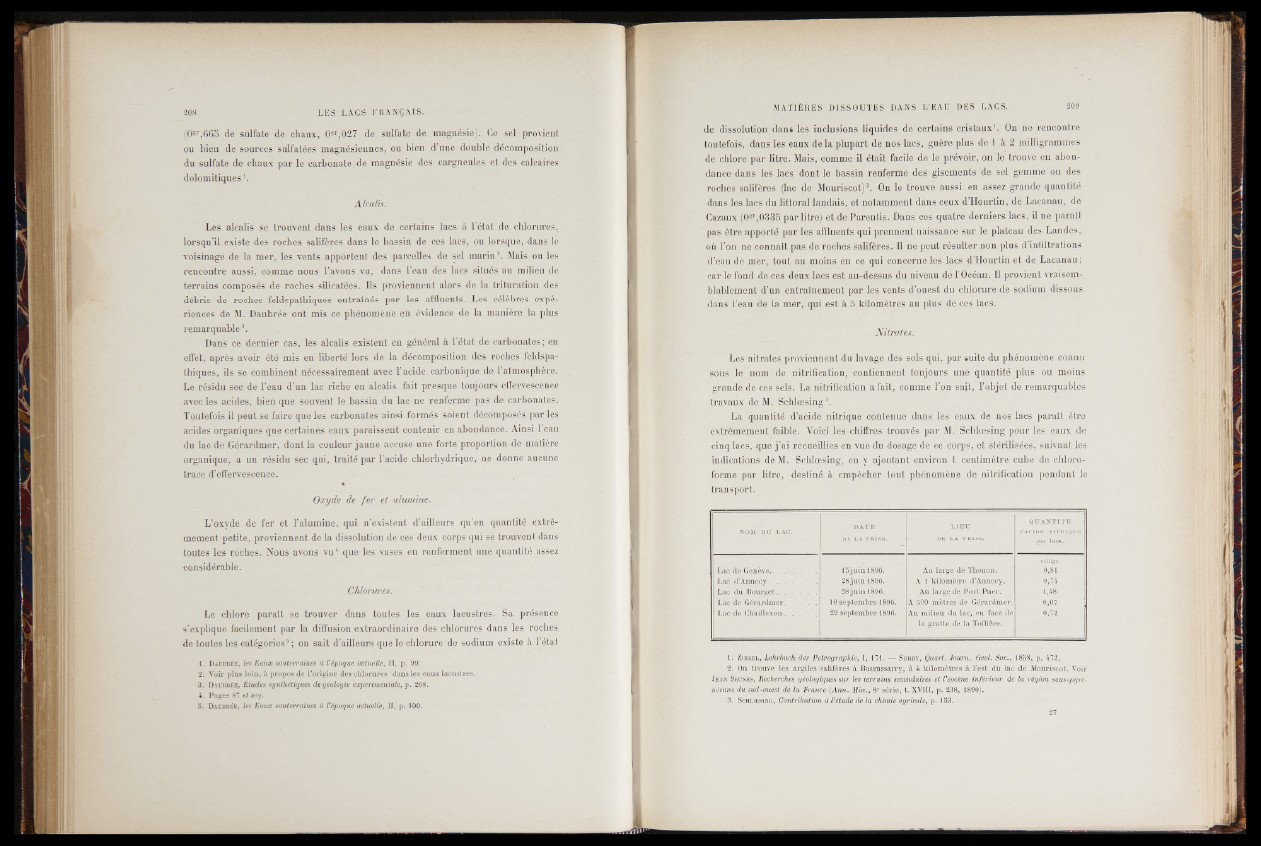
(0sr,665 de sulfate de chaux, 08r,027 de sulfate de magnésie). Ce sel provient
ou bien de sources sulfatées magnésiennes, ou bien d’une double décomposition
du sulfate de chaux par le carbonate de magnésie des cargneules et des calcaires
dolomitiquesl.
Alcalis.
Les alcalis se trouvent dans les eaux de certains lacs à l’état de chlorures,
lorsqu’il existe des roches salifères dans le bassin de ces lacs, ou lorsque, dans le
voisinage de la mer, les vents apportent des parcelles de sel marin8. Mais on les
rencontre aussi, comme nous l’avons vu, dans l’eau des lacs situés au milieu de
terrains composés de roches silicatées. Ils proviennent alors de la trituration des
débris de roches feldspathiques entraînés par les affluents. Les célèbres expériences
de M. Daubrée ont mis ce phénomène en évidence de la manière la plus
remarquable3.
Dans ce dernier cas, les alcalis existent en général à l’état de carbonates; en
effet, après avoir été mis en liberté lors de la décomposition des roches feldspathiques,
ils se combinent nécessairement avec l’acide carbonique de l’atmosphère.
Le résidu sec de l’eau d’un lac riche en alcalis fait presque toujours effervescence
avec les acides, bien que souvent le bassin du lac ne renferme pas de carbonates.
Toutefois il peut se faire que les carbonates ainsi formés soient décomposés par les
acides organiques que certaines eaux paraissent contenir en abondance. Ainsi l’eau
du lac de Gérardmer, dont la couleur jaune accuse une forte proportion de matière
organique, a un résidu sec qui, traité par l’acide chlorhydrique, ne donne aucune
trace d’effervescence.
%
Oxyde de fer et alumine.
L’oxyde de fer et l’alumine, qui n’existent d’ailleurs qu’en quantité extrêmement
petite, proviènnent de la dissolution de ces deux corps qui se trouvent dans
toutes les roches. Nous avons vu* que les vases en renferment une quantité assez
considérable.
Chlorures.
Le chlore parait se trouver dans toutes les eaux lacustres. Sa présence
s ’explique facilement par la diffusion extraordinaire des chlorures dans les roches
de toutes les catégories5 ; on sait d’ailleurs que le chlorure de sodium existe à l’état
1 . D a u b r é e , les Eaux souterraines à l'époque a ctuelle, II, p . 99'
2 . Voir p lu s lo in , à prop o s d e l ’o r ig in e des ch lo ru re s dans le s ea u x la cu str e s.
3 . D a ubrée, É tudes synthé tiques de géologie expé rimentale, p . 2 6 8 .
4 . P a g e s 87 e t seq.
5 . Daubrée, les Eaux sou te rraines à l’époque actuelle, II, p . 1 0 0 .
de dissolution dans les inclusions liquides de certains cristaux1. On ne-rencontre
toutefois, dans les eaux de la plupart de nos lacs, guère plus de 1 à 2 milligrammes
de chlore par litre. Mais, comme il était facile de le prévoir, on le trouve en abondance
dans les lacs dont le bassin renferme des gisements de sel gemme ou des
roches salifères (lac de Mouriscot)!. On le trouve aussi en assez grande quantité
dans les lacs du littoral landais, et notamment dans ceux d’Hourtin, de Lacanau, de
Cazaux (0et,0335 par litre) et de Parentis. Dans ces quatre derniers lacs, il ne parait
pas être apporté par les affluents qui prennent naissance sur le plateau des Landes,
où l’on ne connaît pas de roches salifères. Il ne peut résulter non plus d’infiltrations
d’eau de mer, tout au moins en ce qui concerne les lacs d’Hourtin et de Lacanau ;
car le fond de ces deux lacs est au-dessus du niveau de l’Océan. Il provient vraisemblablement
d’un entrainement par les vents d’ouest du chlorure de sodium dissous
dans l’eau de la mer, qui est à 5 kilomètres au plus de ces lacs.
Nitrates.
Les nitrates proviennent du lavage des sols qui, par suite du phénomène connu
sous le nom de nitrification, contiennent toujours une quantité plus ou moins
grande de ces sels. La nitrification a fait, comme l’on sait,*l'objet de remarquables
travaux de M. Schloesing3.
La quantité d’acide nitrique contenue dans les eaux de nos lacs parait être
extrêmement faible. Yoici les chiffres trouvés par M. Schloesing pour les eaux de
cinq lacs, que j ’ai recueillies en vue du dosage de ce corps, et stérilisées, suivant les
indications de M. Schloesing, en y ajoutant environ i centimètre cube de chloroforme
par litre, destiné à empêcher tout phénomène de nitrification pendant le
transport.
NOM DU LAC.
DATE L IEU
DE LA PRISE .
QUA NT IT É
d’a c i d e n i t r i q u e
par litre.
milligr.
Lac d e Genève. . .................... 15 ju in 1896. Au la rg e d e Thonôn. 0,81
Lac d’A n n e c y ............................. 2 8 j u in 1896. A 1 k ilom è tr e d’Anne cy. 0,74
Lac du B o u r g e t........................ 28 ju in 1896. Au la r g e d e P o r t P u er. 1,48
Lac d e Gérardmer................... 10 sep tem b r e 1896. A 500 m è tr e s de Gérardmer. 0,07
Lac de C h a ille x o n . . . . . 29 sep tem b r e 1896. Au m ilie u du lac,' en fa c e de
la g ro tte d e la Toffière.
0 ,7 2
1. Zirk e l , Lehrbuch d e r P etro g ra ph ie , I, 171. — S orby, Quart. Journ. Geol. S oc., 1858, p. 472.
2. On trouve le s a rg ile s sa lifè r e s à Bassussarry, à 4 k ilom è tr e s à l’e s t du la c d e Mouriscot. Voir
J ean S eun e s , Recherches géologiques su r les te r ra in s secondaires e t l ’éocène in fé rieu r de la région so u s-p y ré néenne
d u sud-ouest de la France (A n n. M in., 8® s é r ie , t. XVIII, p . 2 3 8 , 1890).
3. Sch loe s in g , Contribution à l’étude de la chimie agricole, p . 153.