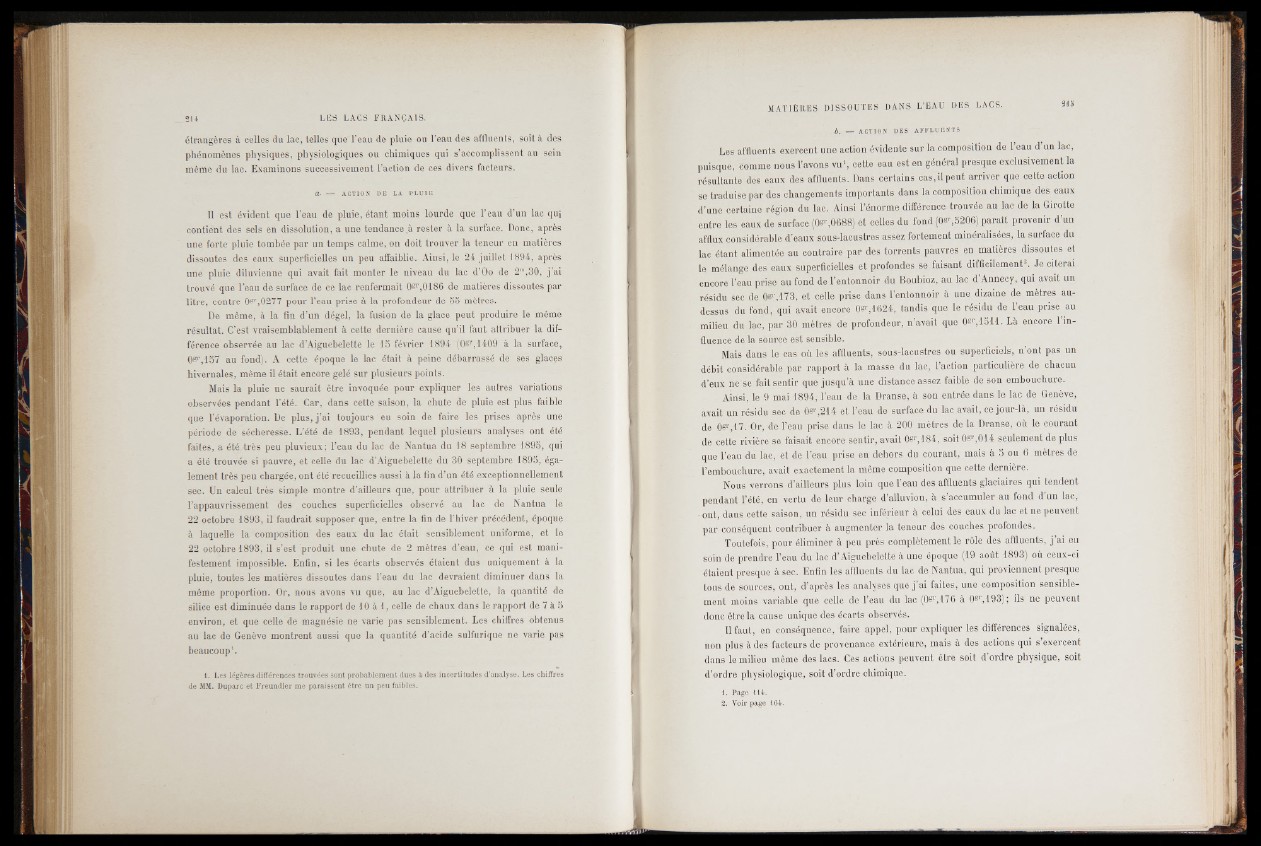
étrangères à celles du lac, telles que l’eau de pluie ou l’eau des affluents, soit à des
phénomènes physiques, physiologiques ou chimiques qui s’accomplissent au sein
même du lac. Examinons successivement l’action de ces divers facteurs.
a. — ACTION DE LA PLUIE
Il est évident que l’eau de pluie, étant moins lourde que l’eau d’un lac qui
contient des sels en dissolution, a une tendance .à rester à la surface. Donc, après
une forte pluie tombée par un temps calme, on doit trouver la teneur en matières
dissoutes des eaux superficielles un peu affaiblie. Ainsi, le 24 juillet 1894, après
une pluie diluvienne qui avait fait monter le niveau du lac d’Oo de 2“,30, j'ai
trouvé que l ’eau de surface de ce lac renfermait 0sr,01S6 de matières dissoutes par
litre, contre 0^,0277 pour l’eau prise à la profondeur de 55 mètres.
De même, à la fin d’un dégel, la fusion de la glace peut produire le même
résultat. C’est vraisemblablement à celte dernière cause qu’il faut attribuer la différence
observée au lac d’Aiguebelette le 15 février 1894 (Os1', 1409 à la surface,
Ûsvigî au fond). A cette époque le lac était à peine débarrassé de ses glaces
hivernales, même il était encore gelé sur plusieurs points.
Mais la pluie ne saurait être invoquée pour expliquer les autres variations
observées pendant l’été. Car, dans cette saison, la chute de pluie est plus faible
que l’évaporation. De plus, j’ai toujours eu soin de faire les prises après une
période de sécheresse. L’été de 1893, pendant lequel plusieurs analyses ont été
faites, a été,très peu pluvieux; l’eau du lac de Nantua du 18 septembre 1895, qui
a été trouvée si pauvre, et celle du lac d’Aiguebelette du 30 septembre 1895, également
très peu chargée, ont été recueillies aussi à la fin d’un été exceptionnellement
sec. Un calcul très simple montre d’ailleurs que, pour attribuer à la pluie seule
l’appauvrissement des couches superficielles observé au lac de Nantua le
22 octobre 1893, il faudrait supposer que, entre la fin de l’hiver précédent, époque
à laquelle la composition des eaux du lac était sensiblement uniforme, et le
22 octobre 1893, il s’est produit une chute de 2 mètres d’eau, ce qui est manifestement
impossible. Enfin, si les écarts observés étaient dus uniquement à la
pluie, toutes les matières dissoutes dans l’eau du lac devraient diminuer dans la
même proportion. Or, nous avons vu que, au lac d’Aiguebelette, la quantité de
silice est diminuée dans le rapport de 10 à 1, celle de chaux dans le rapport de 7 à 5
environ, et que celle de magnésie ne varie pas sensiblement. Les chiffres obtenus
au lac de Genève montrent aussi que la quantité d’acide sulfurique ne varie pas
beaucoup1.
1. Les lé g è r e s d iffé r en c e s tr ouv é e s son t p ro b a b lem en t d u e s à d e s in c e r titu d e s d’an a ly se . Les chiffr es
d e MM. Duparc e t Fr eu n d le r m e p a ra issen t être u n p eu fa ib le s.
b, — ACTION DES AFFLUENTS
Les affluents exercent une action évidente sur la composition de l’eau d’un lac,
puisque, comme nous l’avons vu1, cette eau est en général presque exclusivement la
résultante des eaux des affluents. Dans certains cas, il peut arriver que cette action
se traduise par des changements importants dans la composition chimique des eaux
d’une certaine région du lac. Ainsi l’énorme différence trouvée au lac de la Girotte
entre les eaux de surface (0s-',0688) et celles du fond (08r,5206) paraît provenir d’un
afflux considérable d’eaux sous-lacustres assez fortement minéralisées, la surface du
lac étant alimentée au contraire par des torrents pauvres en matières dissoutes et
le mélange des eaux superficielles et profondes se faisant difficilement8. Je citerai
encore l’eau prise au fond de l ’entonnoir du Boubioz, au lac d Annecy, qui avait un
résidu sec de 0«r,t73, et celle prise dans l’entonnoir à une dizaine de mètres au-
dessus du fond, qui avait encore 0^,1624, tandis que le résidu de l’eau prise au
milieu du lac, par 30 mètres de profondeur, n’avait que 08r,1511. Là encore l ’influence
de la source est sensible.
Mais dans le cas où les affluents, sous-lacustres ou superficiels, n’ont pas un
débit considérable par rapport à la masse du lac, l’action particulière de chacun
d’eux ne'se fait sentir que jusqu’à une distance assez faible de son embouchure.
Ainsi, le 9 mai 1894, l’eau de la Dranse, à son entrée dans le lac de Genève,
avait un résidu sec de Oe^lA et l’eau de surface du lac avait, ce jour-là, un résidu
de 0sr,17. Or, de l’eau prise dans le lac à 200 mètres de la Dranse, où le courant
de cette rivière se faisait encore sentir, avait 0sr,184, soit 0sr,014 seulement de plus
que l’eau du lac, et de l’eau prise en dehors du courant, mais à 5 ou 6 mètres de
l’embouchure, avait exactement la même composition que cette dernière.
Nous verrons d’ailleurs plus loin que l’eau des affluents glaciaires qui tendent
pendant l’été, en vertu de leur charge d’alluvion, à s’accumuler au fond d’un lac,
ont, dans cette saison, un résidu sec inférieur à celui des eaux du lac et ne peuvent
par conséquent contribuer à augmenter la teneur des couches profondes.
Toutefois, pour éliminer à peu près complètement le rôle des affluents, j ’ai eu
soin de prendre l’eau du lac d’Aiguebelette à une époque (19 août 1893) où ceux-ci
étaient presque à sec. Enfin les affluents du lac de Nantua, qui proviennent presque
tous de sources, ont, d’après les analyses que j’ai faites, une composition sensiblement
moins variable que celle de l’eau du lac (0sr,176 à Os1-, 193) ; ils ne peuvent
donc être la cause unique des écarts observés.
Il faut, en conséquence, faire appel, pour expliquer les différences signalées,
non plus à des facteurs de provenance extérieure, mais à des actions qui s’exercent
dans le milieu même des lacs. Ces actions peuvent être soit d’ordre physique, soit
d’ordre physiologique, soit d’ordre chimique.
1. P a g e 114.
2. Voir pa g e 164.