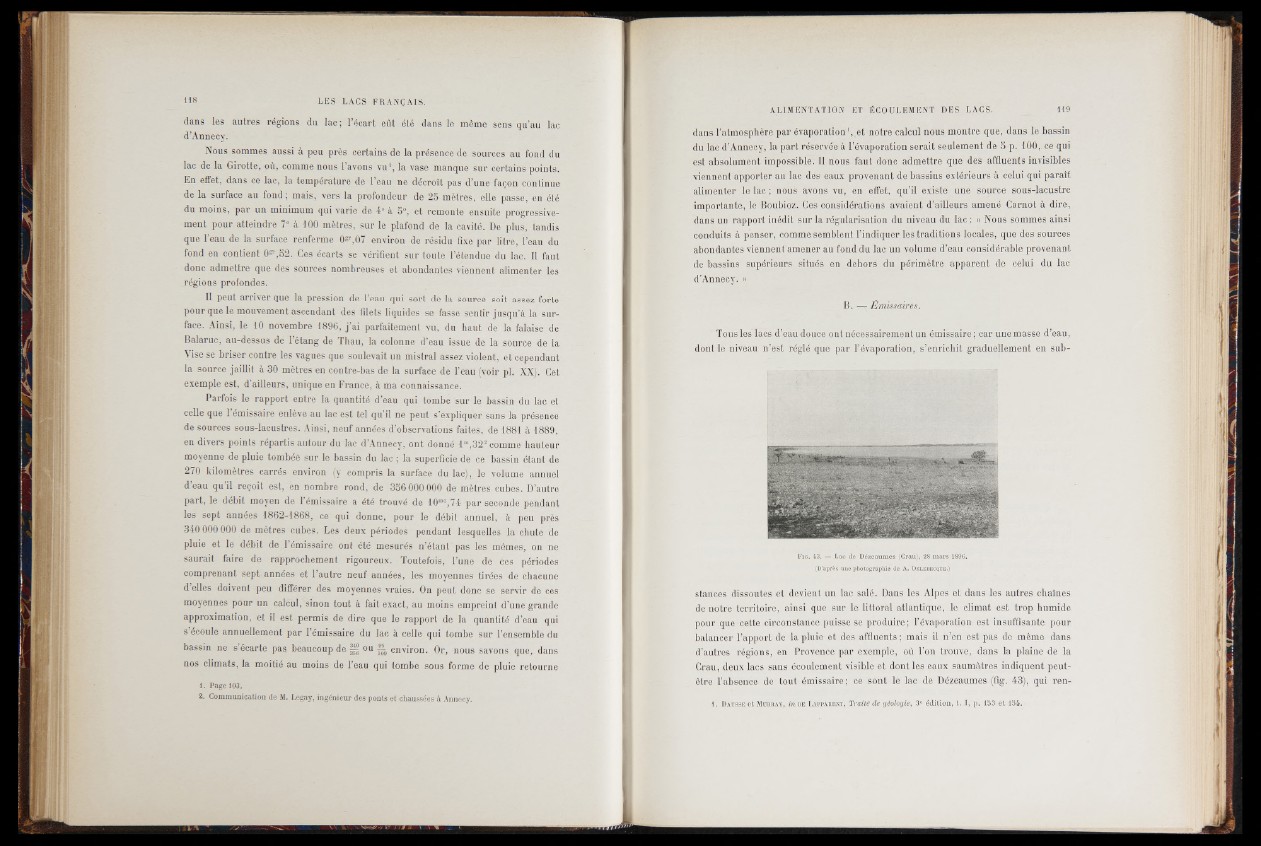
dans les autres régions du lac; l’écart eût été dans le même sens qu’au lac
d’Annecy.
Nous sommes aussi à peu près certains de la présence de sources au fond du
lac de la Girotte, où, comme nous l’avons vu1, la vase manque sur certains points.
En effet, dans ce lac, la température de l’eau ne décroît pas d’une façon continue
de la surface au fond ; mais, vers la profondeur de 25 mètres, elle passe, en été
du moins, par un minimum qui varie de 4° à 5°, et remonte ensuite progressivement
pour atteindre 7° à 100 mètres, sur le plafond de la cavité. De plus, tandis
que l’eau de la surface renferme 0sr,07 environ de résidu fixe par litre, l’eau du
fond en contient 0^,52. Ces écarts se vérifient sur toute l ’étendue du lac. Il faut
donc admettre que des sources nombreuses et abondantes viennent alimenter les
régions profondes.
Il peut arriver que la pression de l’eau qui sort de la source soit assez forte
pour que le mouvement ascendant des filets liquides se fasse sentir jusqu’à la surface.
Ainsi, le 10 novembre 1896, j ’ai parfaitement vu, du haut de la falaise de
Balaruc, au-dessus de l’étang de Thau, la colonne d’eau issue de la source de la
Vise se briser contre les vagues que soulevait un mistral assez violent, et cependant
la source jaillit à 30 mètres en contre-bas de la surface de l’eau (voir pl. XX), Cet
exemple est, d’ailleurs, unique en France, à ma connaissance.
Parfois le rapport entre la quantité d’eau qui tombe sur le bassin du lac et
celle que 1 émissaire enlève au lac est tel qu’il ne peut s’expliquer sans la présence
de sources sous-lacustres. Ainsi, neuf années d’observations faites, de 1881 à 1889,
en divers points répartis autour du lac d’Annecy, ont donné l m,322 comme hauteur
moyenne de pluie tombée sur le bassin du lac ; la superficie de ce bassin étant de
270 kilomètres carrés environ (y compris la surface du lac), le volume annuel
d’eau qu’il reçoit est, en nombre rond, de 356000 000 de mètres cubes. D’autre
part, le débit moyen de l’émissaire a été trouvé de 10“',74 par seconde pendant
les sept années 1862-1868, ce qui donne, pour le débit annuel, à peu près
340000000 de mètres cubes. Les deux périodes pendant lesquelles la chute de
pluie et le débit de l’émissaire ont été mesurés n’étant pas les mêmes, on ne
saurait faire de rapprochement rigoureux. Toutefois, l’une de ces périodes
comprenant sept années et l ’autre neuf années, les moyennes tirées de chacune
d elles doivent peu différer des moyennes vraies. On peut donc se servir de ces
moyennes pour un calcul, sinon tout à fait exact, au moins empreint d’une grande
approximation, et il est permis de dire que le rapport de la quantité d’eau qui
s’écoule annuellement par l’émissaire du lac à celle qui tombe sur l’ensemble du
bassin ne s écarte pas beaucoup de gjj ou i environ. Or, nous savons que, dans
nos climats, la moitié au moins de l’eau qui tombe sous forme de pluie retourne
1. P a g e 103.
2 . C om m un ica tion d e M. Legay, in g é n ie u r d e s p o n ts e t ch a u ssé e s à An ne cy.
dans l’atmosphère par évaporation*,,et notre calcul nous montre que, dans le bassin
du lac d’Annecy, la part réservée à l’évaporation serait seulement de 5 p. 100,. ce qui
est absolument impossible. Il nous faut donc admettre que des affluents invisibles
viennent apporter au lac des eaux provenant de bassins extérieurs à celui qui paraît
alimenter le lac ; nous avons vu, en effet, qu’il existe une source sous-lacustre
importante, le Boubioz. Ces considérations avaient d’ailleurs amené Carnot à dire,
dans un rapport inédit sur la régularisation du niveau du lac : « Nous sommes ainsi
conduits à penser, comme semblent l’indiquer les traditions locales, que des sources
abondantes viennent amener au fond du lac un volume d’eau considérable provenant
de bassins supérieurs situés en dehors du périmètre apparent de celui du lac
d’Annecy. ». ;
B. — Émissaires.
Tous les lacs d’eau douce ont nécessairement un émissaire ; car une masse d’eau,
dont le niveau n’est réglé que par l’évaporation, s’enrichit graduellement en sub-
Fie. 43. — Lac de Dézeaumes (Grau), 28 mars 1896.
(D'après une photographie de A. D e leb e c q u e .)
stances dissoutes et devient un lac salé. Dans les Alpes et dans les autres chaînes
de notre territoire, ainsi que sur le littoral atlantique, le climat est trop humide
pour que cette circonstance puisse sè produire; l’évaporation est insuffisante pour
balancer l’apport de la pluie et des affluents ; mais il n’en est pas de même dans
d’autres régions, en Provence par exemple, où l’on trouve, dans la plaine de la
Crau, deux lacs sans écoulement visible et dont les eaux saumâtres indiquent peut-
être l’absence de tout émissaire; ce sont le lac de Dézeaumes (fig. 43), qui ren-
\. D a u s sg e t M u r r a y , m, d e L à p p à r en t, T ra ité d e géologie, 3° é d i t io n , t . I, p . 1 5 3 e t 1 5 4 .