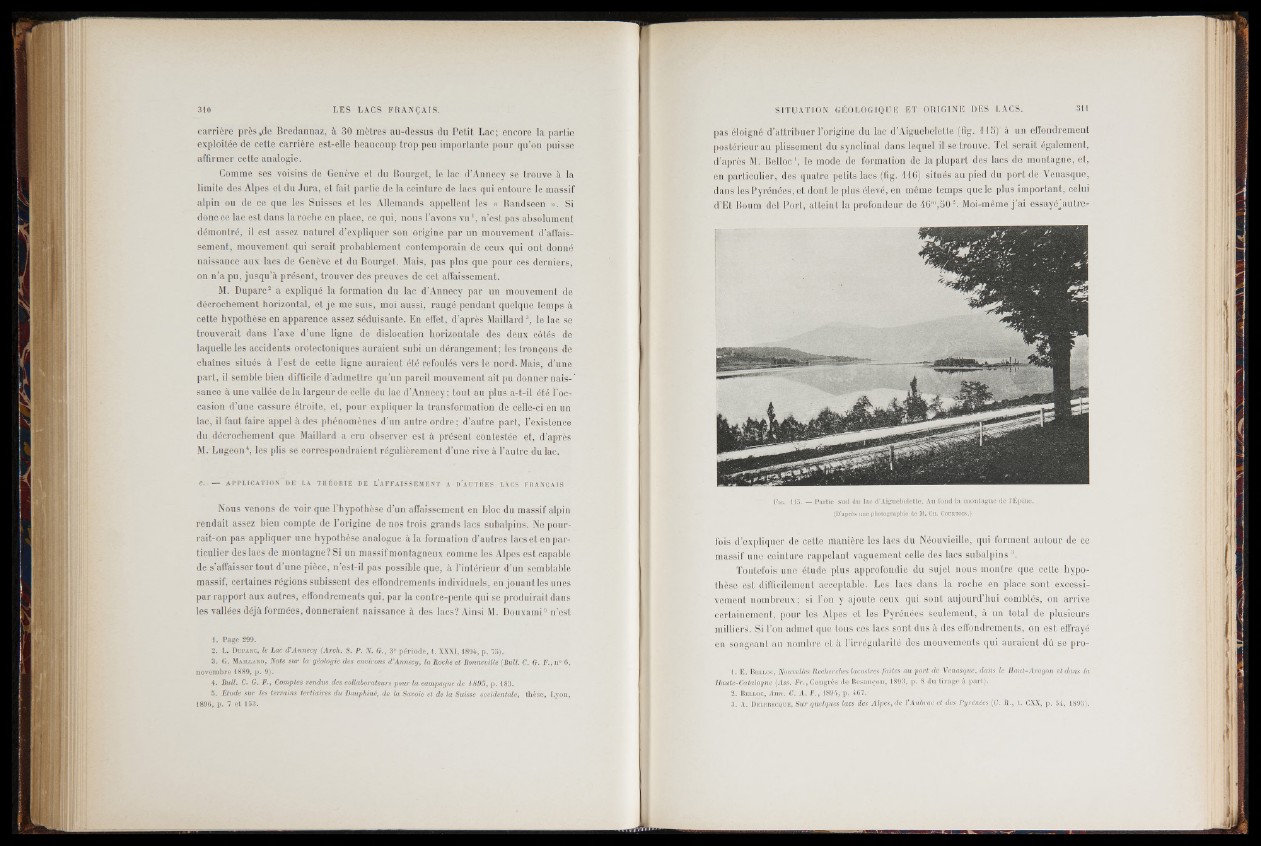
carrière près,de Bredannaz, à 30 mètres au-dessus du Petit Lac; encore la partie
exploitée de cette carrière est-elle Beaucoup trop peu importante pour qu’on puisse
affirmer cette analogie.
Comme ses voisins de Genève et du Bourget, le lac d’Annecy se trouve à la
limite des Alpes et du Jura, et fait partie de la ceinture de lacs qui entoure le massif
alpin ou de ce que les Suisses et les Allemands appellent les « Randseen ». Si
donc ce lac est dans la roche en place, ce qui, nous l’avons vu1, n’est pas absolument
démontré, il est assez naturel d’expliquer son origine par un mouvement d’affaissement,
mouvement qui serait probablement contemporain de ceux qui ont donné
naissance aux lacs de Genève et du Bourget. Mais, pas plus que pour ces derniers,
on n’a pu, jusqu’à présent, trouver des preuves de cet affaissement.
M. Duparc2 a expliqué la formation du lac d’Annecy par un mouvement de
décrochement horizontal, et je me suis, moi aussi, rangé pendant quelque temps à
cette hypothèse en apparence assez séduisante. En effet, d’après Maillard3, le lac se
trouverait dans l’axe d’une ligne de dislocation horizontale des deux côtés de
laquelle les accidents orotectoniques auraient subi un dérangement; les tronçons de
chaînes situés à l’est de cette ligne auraient été refoulés vers le nord. Mais, d’une
part, il semble bien difficile d’admettre qu’un pareil mouvement ait pu donner nais-’
sance à une vallée de la largeur de celle du lac d’Annecy; tout au plus a-t-il été l’occasion
d’une cassure étroite, et, pour expliquer la transformation de celle-ci en un
lac, il faut faire appel à des phénomènes d’un autre ordre; d’autre part, l’existence
du décrochement que Maillard a cru observer est à présent contestée et, d’après
M. Lugeon4, les plis se correspondraient régulièrement d’une rive à l’autre du lac.
e. — A P P L IC A T IO N D E LA T H É O R IE D E L’A F F A IS S ÈM E N T A D’A U T R E S LAC S F R A N Ç A IS
Nous venons de voir que l’hypothèse d’un affaissement en bloc du massif alpin
rendait assez bien compte de l’origine de nos trois grands lacs subalpins. Ne pour-
rait-on pas appliquer une hypothèse analogue à la formation d’autres lacs et en particulier
des lacs de montagne? Si un massif montagneux comme les Alpes est capable
de s’affaisser tout d’une pièce, n’est-il pas possible que, à l’intérieur d’un semblable
massif, certaines régions subissent des effondrements individuels, en jouant les unes
par rapport aux autres, effondrements qui, par la contre-pente qui se produirait dans
les vallées déjà formées, donneraient naissance à des lacs? Ainsi M. Douxami5 n’est
1. P a g e 299.
2 . L. D u pa r c, le Lac d'An n ecy (A rch . S . P . N. G., 3e p é r io d e , t. XXXI, 1894, p. 73).
3 . G. Ma il la rd , Note su r la -g éo lo g ie des environs d ’Annecy, la Poche e t Bonneville [Bull. C. G. F .,n ° 6,
n o v em b r e 1889, p . 9).
4. Bull. C. G. 4 2 Comptes ren du s des collaborateurs pour la campagne d e 1 8 9 5 , p . 183.
5. É tu d e su r les terra ins tertia ire s du Dauphiné, d e la Savoie e t de la Suisse occidentale, th è se , Lyon,
1896, p . 7 e t 133.
pas éloigné d’attribuer l’origine clu lac d’Àiguebelette (fig. 115)' à un effondrement
postérieur au plissement du synclinal dans lequel il se trouve. Tel serait également,
d’après M. Belloc1, le mode de formation de la plupart des lacs de montagne, et,
en particulier, des quatre petits lacs (fig. 116) situés au pied du port de Yenasque,
dans les Pyrénées, et dont le plus élevé, en même temps que le plus important, celui
d’Et Boum del Port, atteint la profondeur de 46m,5 0 2. Moi-même j’ai essayé^autre-
F ig . 113. — P a r t ie sud d u lac d’Aiguebelette. Au .fond là m o n tag n e de l’Épine.
(D'après une p h o to g rap hie d e M. Ch. C o u r to is .)
fois d’expliquer de cette manière les lacs du Néouvieille, qui forment autour de ce
massif une ceinture rappelant vaguement celle des lacs subalpins 3.
Toutefois une étude plus approfondie du sujet nous montre que cette hypothèse
est difficilement acceptable. Les lacs dans la roche en place sont excessivement
nombreux; si l’on y ajoute ceux qui sont aujourd’hui comblés, on arrive
certainement, pour les Alpes et les Pyrénées seulement, à un total de plusieurs
milliers. Si l’on admet que tous ces lacs sont dus à des effondrements, on est effrayé
en songeant au nombre et à l’irrégularité des mouvements qui auraient dû se pro-
■I. E . B e l l o c , Nouvelles Recherches lacustres fa ite s au p o rt de Venasque, d am le Üau t-A ra g on e t dans la
Haute-Catalogne (Ass. ÎY., Congrès de Besan çon , 1893, p . S du tira g e a pari).
2 . B e llo c , Ann. C. A . F ., 1894, p . 467.
3. A. D e l e b k c q u e , S ur quelques lacs des A lp e s, d e l’Aubrac et des Pyrénées (C. R ., t . GXX, p . 34, 1893).