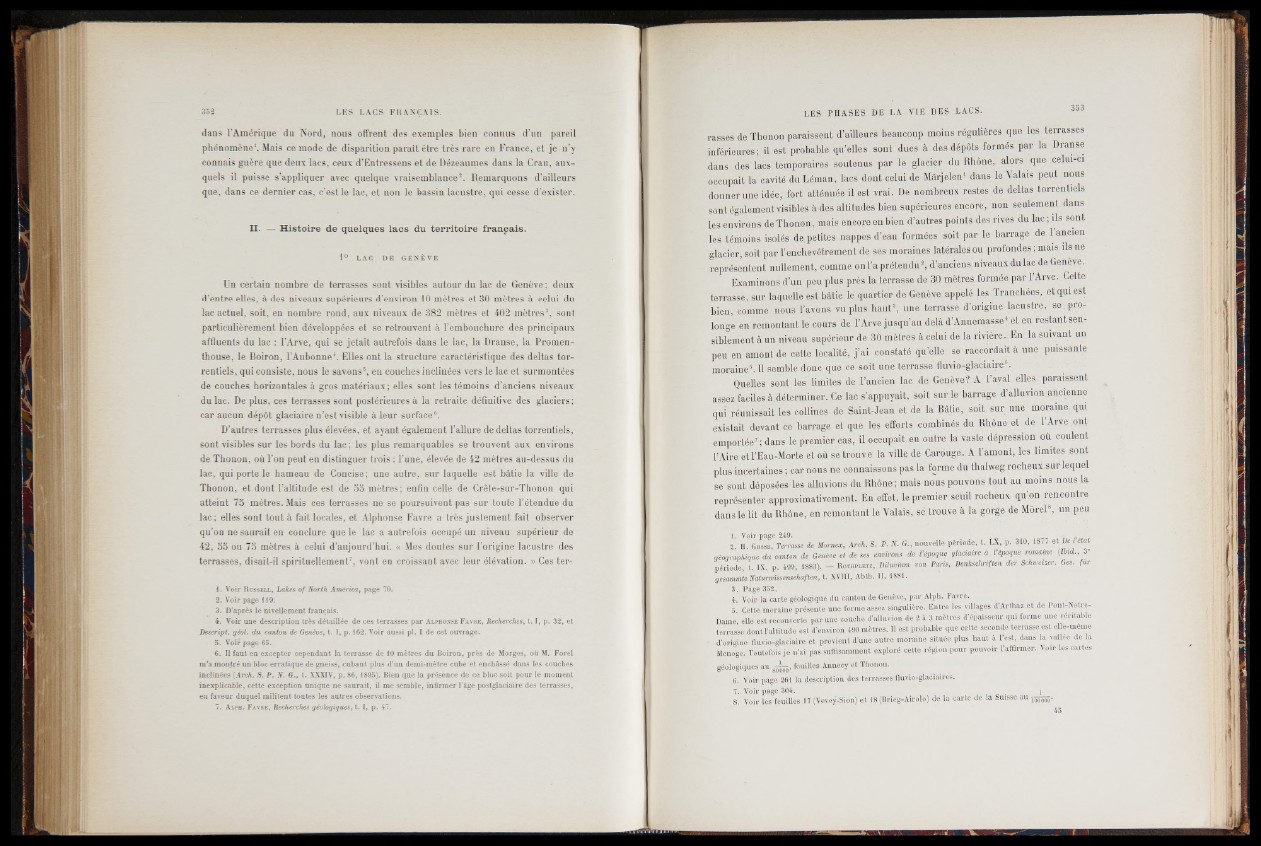
dans l’Amérique du Nord, nous offrent des exemples bien connus d’un pareil
phénomène1. Mais ce mode de disparition parait être très rare en France, et je n’y
connais guère que deux lacs, ceux d’Entressens et de Dézeaumes dans la Crau, auxquels
il puisse s’appliquer avec quelque vraisemblance*. Remarquons d’ailleurs
que, dans ce dernier cas, c’est le lac, et non le bassin lacustre, qui cesse d’exister.
n . - 9 Histoire de quelques la c s du territoire français.
i ° LA C D E G E N È V E
Un certain nombre de terrasses sont visibles autour du lac de Genève ; deux
d’entre elles, à des niveaux supérieurs d’environ 10 mètres et 30 mètres à celui du
lac actuel, soit, en nombre rond, aux niveaux de 382 mètres et 402 mètres3, sont
particulièrement bien développées et se retrouvent à l’embouchure des principaux
affluents du lac : l’Arve, qui se jetait autrefois dans le lac, la Dranse, la Promen-
thouse, le Boiron, l’Aubonne*. Elles ont la structure caractéristique des deltas torrentiels,
qui consiste, nous le savons5, en couches inclinées vers le lac et surmontées
de couches horizontales à gros matériaux ; elles sont les témoins d’anciens niveaux
du lac. De plus, ces terrasses sont postérieures à la retraite définitive des glaciers ;
car aucun dépôt glaciaire n’est visible à leur surface'.
D’autres terrasses plus élevées, et ayant également l’allure de deltas torrentiels,
sont visibles sur les bords du lac; les plus remarquables se trouvent aux environs
de Thonon, où l'on peut en distinguer trois : l’une, élevée de 42 mètres au-dessus du
lac, qui porte le hameau de Concise; une autre, sur laquelle est bâtie la ville de
Thonon, et dont l’altitude est de 55 mètres; enfin celle de Crête-sur-Thonon qui
atteint 75 mètres. Mais ces terrasses ne se poursuivent pas sur toute l’étendue du
lac; elles sont tout à fait locales, et Alphonse Favre a très justement fait observer
qu’on ne saurait en conclure que le lac a autrefois occupé un niveau supérieur de
42, 55 ou 75 mètres à celui d’aujourd’hui. « Mes doutes sur l’origine lacustre des
terrasses, disait-il spirituellement7, vont en croissant avec leur élévation. » Ces ter1
. Voir R d s s e l l , Lakes o f R o rth Ame rica, pa g e 70.
2 . Voir pa g e f 1 9.
3 . D’a p rès l e n iv e llem en t français.
4 . Voir u n e d e sc r ip tio n tr è s d é ta illé e d e c e s te r ra sse s p a r A lp h o n s e F a v r e , Recherches, t .1 , p . 3 2 , e t
De script. géol. d u canton d e Genève, t. I, p . 462. Voir au ssi pl. I d e c e t ouvrage.
3 . Voir pa g e 63.
6. I l fa u t en e x c ep te r c ep en d an t la te r ra sse de 10 m è tr e s d u B o ir on , p r è s d e Morges, où M. Fore l
m ’a m on tr é u n b lo c e r ra tiq u e d e g n e is s , cu b a n t p lu s d’u n d em i-m è tr e cube e t en ch â ssé dans le s cou ch es
in c lin é e s (A rch . S. P . N. G., t . XXXIV, p . 86, 1895). Bien que la p r é sen c e de ce b lo c so it pour le mom en t
in e x p lic a b le , c e tte e x c ep tio n u n iq u e n e sa u ra it, il m e s em b le , infirm e r l’âge p o stg la cia ire des te r ra sse s,
en faveur d uq ue l m iliten t tou te s le s au tre s observ a tion s.
7. A l p h. F a v r e, Recherches géologiques, t. I, p . 47.
rasses de Thonon paraissent d’ailleurs beaucoup moins régulières que les terrasses
inférieures; il est probable qu’elles sont dues à des dépôts formés par la Dranse
dans des lacs temporaires soutenus par le glacier du Rhône, alors que celui-ci
occupait la cavité du Léman, lacs dont celui de Mârjelen1 dans le Valais peut nous
donner une idée, fort atténuée i l est vrai. De nombreux restes de deltas torrentiels
sont également visibles à des altitudes bien supérieures encore, non seulement dans
les environs de Thonon, mais encore en bien d’autres points des rives du lac ; ils sont
les témoins isolés de petites nappes d’eau formées soit par le barrage de l’ancien
glacier, soit par l’enchevêtrement de ses moraines latérales ou profondes ; mais ils ne
représentent nullement, comme onl’aprétendu*, d’anciens niveaux du lac de Geneve.
Examinons d’un peu plus près la terrasse de 30 mètres formée par l’Arve. Celte
terrasse, sur laquelle est bâtie le quartier de Genève appelé les Tranchées, et qui est
bien, comme nous l’avons vu plus haut3, une terrasse d’origine lacustre, : se pro7
longe en remontant le cours de l’Arve jusqu’au delà d Annemasse* ét en restant sensiblement
à un niveau supérieur de 30 mètres à celui de la rivière. En la suivant un
peu en amont de cette localité, j’ai constaté qu’elle se raccordait à une puissante
moraine5. Il semble donc que ce soit une terrasse fluvio-glaciaire8.
Quelles sont les limites de l’ancien lac de Genève? A l ’aval elles paraissent
assez faciles à déterminer. Ce lac s’appuyait, soit sur le barrage d’alluvion ancienne
qui réunissait les collines de Saint-Jean et de la Bâtie, soit sur une moraine qui
existait devant cé barrage et que les efforts combinés du Rhône et de 1 Arve ont
emportée7; dans le premier cas, il occupait en outre la vaste dépression où coulent
l’Aire et l’Eau-Morte et où se trouve la ville de Carôuge. A l’amont, les limites sont
plus incertaines ; car nous ne connaissons pas la forme du thalweg rocheux sur lequel
se sont déposées les alluvions du Rhône; mais nous pouvons tout au moins nous la
représenter approximativement. En effet, le premier seuil rocheux qu’on rencontre
dans le lit du Rhône, en remontant le Valais, së trouve à la gorge de Môrel8, un peu
1. Voir page 249. • ffH I
2 . H. Gosse, Terrasse d e Mornex, A rch . S . P. N. I i„ n o u v e lle p é r io d e , t. LX, p . 310, 1877 e t De l ê t a t
géographique du canton d e Genève e t de ses environs d e l'époque g laciaire à l'époque romaine ( t t i d . , 3»
p é r io d e , t. IX, p . 499, 1883). - R o tiii-le tz , Düumum von P a n s , Denkschriflen d e r Schweizer. S e s. fu r
gesammte Nalunuissenschaften, t. XVIII, Abth. II, 1881.
3 . P a g e 332.
4. Voir la car te g éo lo g iq u e d u ca n to n d e Genève, p ar Alph. Favre .
5 Cette m o r a in e p r é sen te u n e fo rme assez s in g u liè r e . E ntre l e s v illa g e s d’Arthaz e t d e P o n t-N o tr e - |
D am e, e lle e s t r e cou v er te p ar u n e c o u ch e d'allu viou de 2 à 3 m è tr e s d 'ép a isseu r q u i fo rm e u n e vér itable
te r ra sse dont l’a ltitu de e s t d’en v iron 490 m è tr e s . Il e st p rob able q u e c e tte se c o n d e te r ra sse e s t e lle -m êm e
- d’o r ig in e flu v io -g la c ia ir e e t p r o v ien t d’u n e au tr e m o r a in e s itu é e p lu s h aut à l ’e s t , dans la v a lle e d e la
Menoge. Toutefois j e n ’a i pas su ffisam m ent exp lo r é c e tte r é g io n p o u r p ou v o ir l ’a ffirmer . Voir le s car tes
g éo lo g iq u e s a u ¿jL j , fe u ille s An ne cy e t Thonon.
6. Voir page 261 la d e sc r ip tion des te r ra sse s flu v io -g la c ia ir e s.
7. Voir p age 304. ; i
8. Voir le s feu ille s 17 (Vevey:Sion) e t 18 (B rieg-Airolo) de la ca r te d e la S u isse a u ïôôôôô