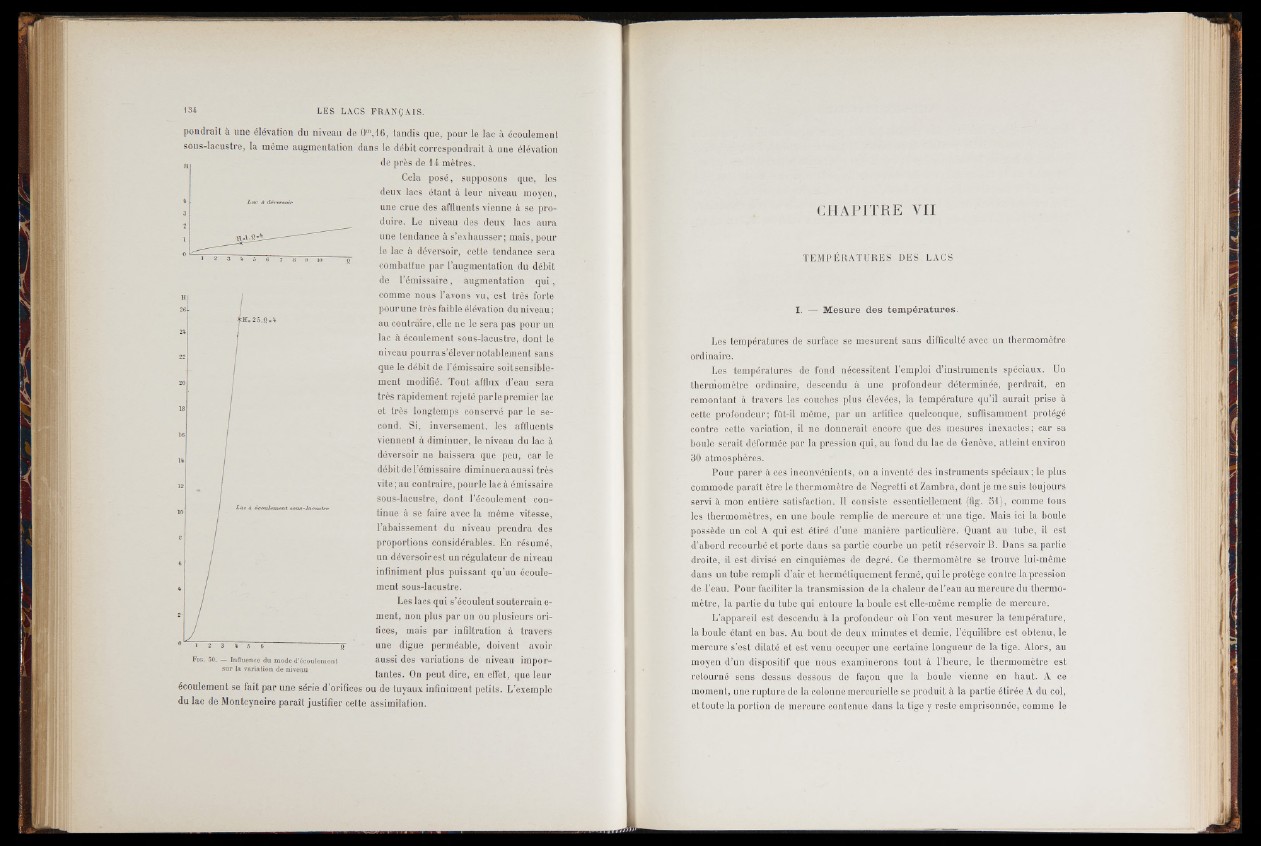
pondrait à une élévation du niveau de 0"',16, tandis que, pour le lac à écoulement
sous-lacustre, la même augmentation dans le débit correspondrait à une élévation
de près de 14 mètres.
Cela posé, supposons que, les
deux lacs étant à leur niveau moyen,
une crue des affluents vienne à se produire.
Le niveau des deux lacs aura
une tendance à s’exhausser; mais, pour
le lac à déversoir, cette tendance sera
combattue par l’augmentation du débit
de l’émissaire, augmentation qui,
comme nous l’avons vu, est très forte
pour une très faible élévation du niveau ;
au contraire, elle ne le sera pas pour un
lac à écoulement sous-lacustre, dont le
niveau pourras’élevernotablement sans
que le débit de l’émissaire soit sensiblement
modifié. Tout afflux d’eau sera
très rapidement rejeté parle premier lac
et très longtemps conservé par le second.
Si, inversement, les affluents
viennent à diminuer, le niveau du lac à
déversoir ne baissera que peu, car le
débit de l’émissaire diminuera aussi très
vite ; au contraire, pourle lac à émissaire
sous-lacustre, dont l’écoulement continue
à se faire avec la même vitesse,
l’abaissement du niveau prendra des
proportions considérables. En résumé,
un déversoir est un régulateur de niveau
infiniment plus puissant qu’un écoulement
sous-lacustre.
Les lacs qui s’écoulent souterrain e-
ment, non plus par un ou plusieurs orifices,
mais par infiltration à travers
une digue perméable, doivent avoir
aussi des variations de niveau importantes.
On peut dire, en effet, que leur
Fig. 50. — Influence du mode d’écoulement
sur la variation de niveau
écoulement se fait par une série d’orifices ou de tuyaux infiniment petits. L’exemple
du lac de Montcyneire parait justifier cette assimilation.
CHAPITRE YII
TEMPÉRATURES DES LACS
I. — Mesure des températures.
Les températures de surface se mesurent sans difficulté avec un thermomètre
ordinaire.
Les températures de fond nécessitent l’emploi d’instruments spéciaux. Un
thermomètre ordinaire, descendu à une profondeur déterminée, perdrait, en
remontant à travers les couches plus élevées, la température qu’il aurait prise à
cette profondeur; fût-il même, par un artifice quelconque, suffisamment protégé
contre cette variation, il ne donnerait encore que des mesures inexactes; car sa
boule-serait déformée par la pression qui, au fond du lac de Genève, atteint environ
30 atmosphères.
Pour parer à ces inconvénients, on a inventé des instruments spéciaux; le plus
commode parait être le thermomètre de Negretti et Zamhra, dont je me suis toujours
servi à mon entière satisfaction. Il consiste essentiellement (fig. .SI)/ comme fous
les thermomètres, en une boule remplie de mercure et une tige. Mais ici la boule
possède un col A qui est étiré d’une manière particulière. Quant au tube, il est
d’abord recourbé et porte dans sa partie courbe un petit réservoir B. Dans sa partie-
droite, il est divisé en cinquièmes de degré. Ce thermomètre se trouve lui-même
dans un tube rempli d’air et hermétiquement fermé, qui le protège contre la pression
de -l’eau. Pour faciliter la transmission de la chaleur de l’eau au mercure du thermomètre,
la partie du tube qui entoure la boule est elle-même remplie de mercure.
L’appareil est descendu à la profondeur où l’on veut mesurer la température,
la boule étant en bas. Au bout de deux minutes et demie, l’équilibre est obtenu, le
mercure s’est dilaté et est venu occuper une certaine longueur de la tige. Alors, au
moyen d’un dispositif que nous examinerons tout à l’heure, le thermomètre est
retourné sens dessus dessous de façon que la boule vienne en haut. A ce
moment, une rupture de la colonne mercurielle se produit à la partie étirée A du col,
et toute la portion de mercure contenue dans la lige y reste emprisonnée, comme le