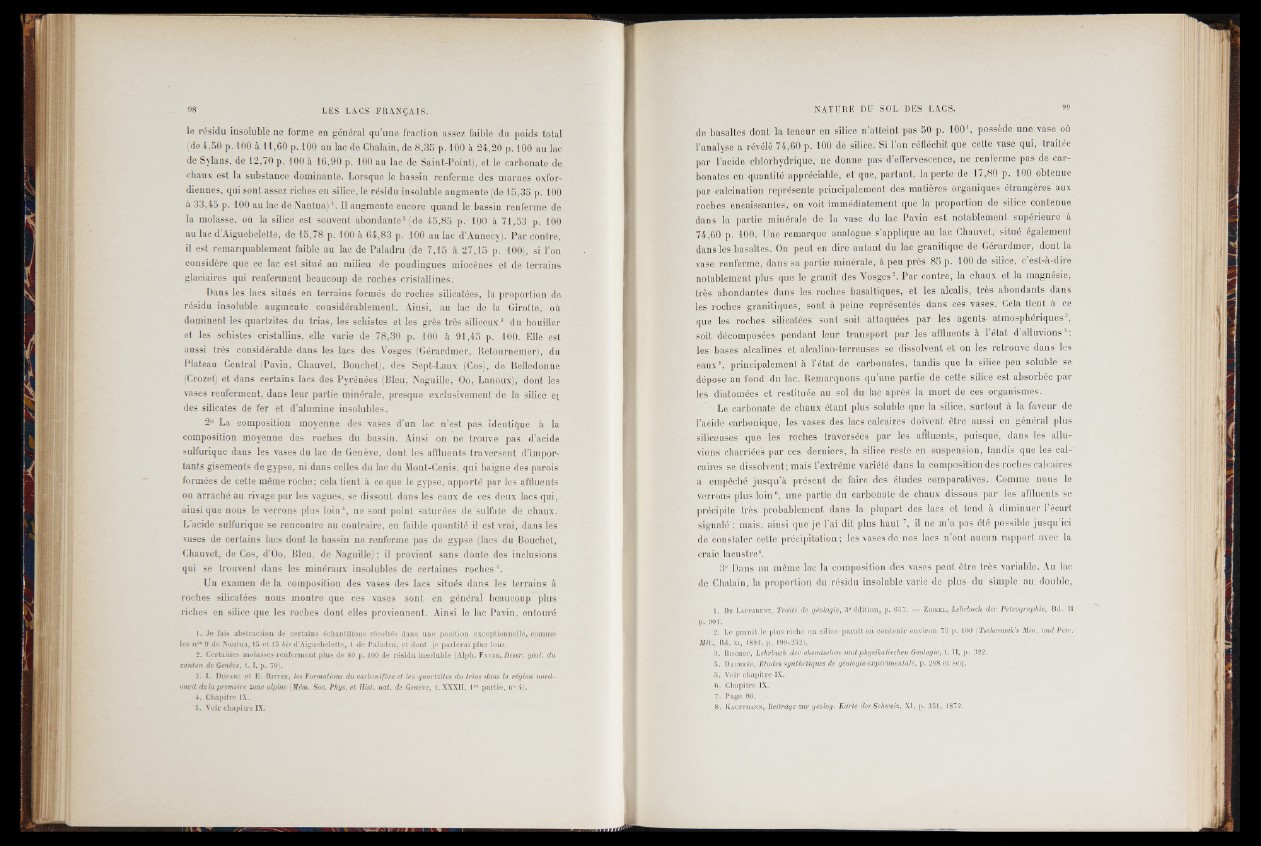
le résidu insoluble ne forme en général qu’une fraction assez faible du poids total
(de4,50 p. 100 à 11,60 p. 100 au lac de Chalain, de 8,35 p. 100 à 24,20 p. 100 au lac
de Sylans, de 12,70 p. 100 à 16,90 p. 100 au lac de Saint-Point), et le carbonate de
cbaux est la substance dominante. Lorsque le bassin renferme des marnes oxfor-
diennes, qui sont assez riches en silice, le résidu insoluble augmente (de 15,35 p. 100
à 33,45 p. 100 au lac de Nantua) 1 Il augmente encore quand le bassin renferme de
la molasse, où la silice est souvent abondante5 (de 45,85 p. 100 à 71,53 p. 100
au lac d Aiguebeîette, de 15,78 p. 100 à 64,83 p. 100 au lac d’Annecy). Par contre,
il est remarquablement faible au lac de Paladru (de 7,15 à 27,15 p. 100), si l’on
considère que ce lac est situé au milieu de poudingues miocènes et de terrains
glaciaires qui renferment beaucoup de roches cristallines.
Dans les lacs situés en terrains formés de roches silicatées, la proportion de
résidu insoluble augmente considérablement. Ainsi, au lac de la Girolte, où
dominent les quarlzites du trias, les schistes et les grès très siliceux3 du houiller
et les schistes cristallins, elle varie de 78,30 p. 100 à 91,45 p. 100. Elle est
aussi très considérable dans les lacs des Vosges (Gérardmer, Retournemer), du
Plateau Central (Pavin, Chauvet, Bouchet), des Sept-Laux (Cos), de Belledonne
(Crozet) et dans certains lacs des Pyrénées (Bleu, Naguille, Oo, Lanoux), dont les
vases renferment, dans leur partie minérale, presque exclusivement de la silice et
des silicates de fer et d’alumine insolubles.
2° La composition moyenne des vases d’un lac n’est pas identique à la
composition moyenne des roches du bassin. Ainsi on ne trouve pas d’acide
sulfurique dans les vases du lac de Genève, dont les affluents traversent d’importants
gisements de gypse, ni dans celles du lac du Mont-Cenis, qui baigne des parois
formées de cette même roche; cela tient à ce que le gypse, apporté par les affluents
ou arraché au rivage par les vagues, se dissout dans les eaux de ces deux lacs qui,
ainsi que nous le verrons plus loin*, ne sont point saturées de sulfate de chaux.
L’acide sulfurique se rencontre au contraire, en faible quantité il est vrai, dans les
vases de certains lacs dont le bassin ne renferme pas de gypse (lacs du Bouchet,
Chauvet, de Cos, d’Oo, Bleu, de Naguille) ; il provient sans doute des inclusions
qui se trouvent dans les minéraux insolubles de certaines roches
Un examen de la composition des vases des lacs situés dans les terrains à
roches silicatées nous montre que ces vases sont en général beaucoup plus
riches en silice que les roches dont elles proviennent. Ainsi le lac Pavin, entouré
1. Je fais ab stra c tion d e c e r ta in s é ch a n tillo n s r é c o lté s dans u n e p o s itio n e x c ep tio n n e lle , comme
l e s n°* 9 de Nantua, 15 e t 45 bis d’A ig u eb e le tte , 1 de P a ladru, e t d ont j e p a r le r a i p lu s lo in .
2 . Ce rtaines m o la sse s r en fe rm en t p lu s de 8 0 p . 1 0 0 d e r é s id u in so lu b le (Alph. Favre, Descr. géol. du
canton d e Genève, t. I, p . 79).
3. L. Duparc e t E. R itte r , les Formations du carbonifère e t le s q u a r tz ite s du tria s dans la région n o rd -
ouest d e la'première zone alpine (Mém. Soc. Phys. e t E ist. n a t. d e Genève, t. XXXII, l re p a r tie , n° 4).
4 . Chapitre IX ..
5 . Voir ch a p itr e IX.
de basaltes dont la teneur en silice n’atteint pas 50 p. 100', possède une vase où
l’analyse a révélé 74,60 p. 400 de silice. Si 1 on réfléchit que cette vase qui, traitée
par l’acide chlorhydrique, ne donne pas d’effervescence, ne renferme pas de carbonates
en quantité appréciable, et que, partant, la perte de 17,80 p. 100 obtenue
par calcination représente principalement des matières organiques étrangères aux
roches encaissantes, on voit immédiatement que la proportion de silice contenue
dans la partie minérale de la vase du lac Pavin est notablement supérieure à
74,60 p. 100. Une remarque analogue s’applique au lac Chauvet, situé également
dans les basaltes. On peut en dire autant du lac granitique de Gérardmer, dont la
vase renferme, dans sa partie minérale, à peu près 85 p. 100 de silice, c’est-à-dire
notablement plus que le granit des Vosges5. Par contre, la chaux et la magnésie,
très abondantes dans les roches basaltiques, et les alcalis, très abondants dans
les roches granitiques, sont à peine représentés dans ces vases. Cela tient à ce
que les roches silicatées sont soit attaquées par les agents- atmosphériques3,
soit décomposées pendant leur transport par les affluents à l’état d’alluvions *;
les bases alcalines et alcalino-terreuses se dissolvent et on les retrouve dans les
eaux3, principalement à l’état de carbonates, tandis que la silice peu soluble se
dépose au fond du lac. Remarquons qu’une partie de cette silice est absorbée par
les diatomées et restituée au sol du lac après la mort de ces organismes.
Le carbonate de chaux étant plus soluble que la silice, surtout à la faveur de
l’acide carbonique, les vases des lacs calcaires doivent être aussi en général plus
siliceuses que les roches traversées par les affluents, puisque', dans les allu-
vions charriées par ces derniers, la silice reste en suspension, tandis que les calcaires
se dissolvent; mais l’extrême variété dans la composition des-roches calcaires
a empêché jusqu’à présent de faire des études comparatives. Comme nous le
verrons plus loin 6, une partie du carbonate de cbaux dissous par les affluents se
précipite très probablement dans la plupart des lacs et tend à diminuer l’écart
signalé ; mais, ainsi que je l’ai dit plus haut7, il ne m’a pas été possible jusqu’ici
de constater cette précipitation; les vases de nos lacs n’ont aucun rapport avec la
craie lacustre8.
3° Dans un même lac la composition des vases peut être très variable. Au lac
de Chalain, la proportion du résidu insoluble varie de plus du simple au double,
1. De L apparent, T ra ité d e géologie, 3° éd itio n , p. 657. — Zirkel, Lehrbuch d e r Petro g ra ph ie , Bd. II
p . 901.
2. Le g ran it le p lu s r ich e e n s ilic e p araît en co n ten ir en v iro n 75 p . 100 (Tschermak’s Min. und Petr.
M it., Bd. x i, 1891, p . 199-252).
3. Bischof, Lehrbuch d e r chemischen u nd p h ysik a lischen Geologie, t. II, p . 322.
4. Daubrée, Étu d es synthé tiques de géologie expérimentale, p. 268 e t seq.
5. Voir chap itre IX.
6. Chapitre IX.
7. P a g e 86.
8. Kauffmann, Beiträge zu r geolog. K a rte der Schweiz, XI, p . 351, 1872.