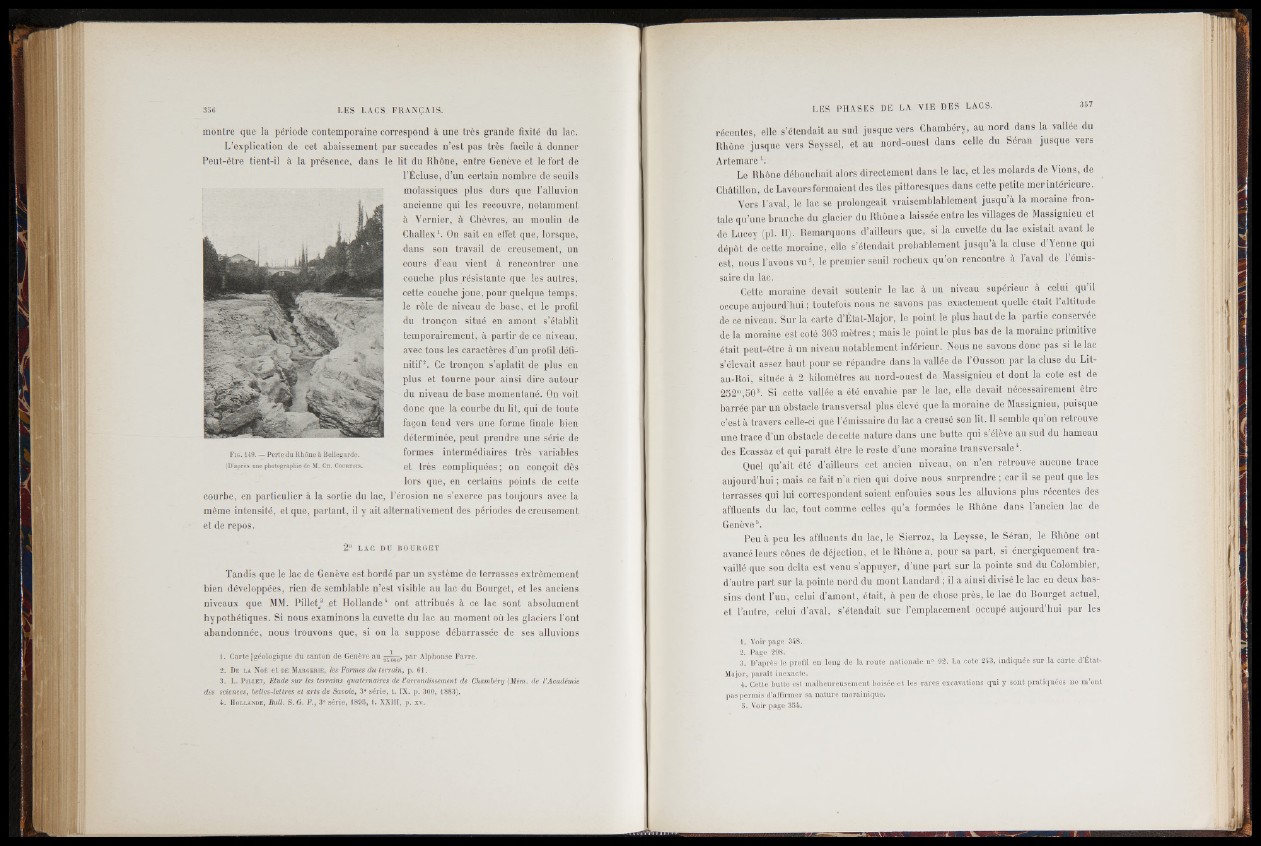
montre que la période contemporaine correspond à une très grande fixité du lac.
L’explication de cet abaissement par saccades n’est pas très facile à donner
Peut-être tient-il à la présence, dans le lit du Rhône, entre Genève et le fort de
l’Écluse, d’un certain nombre de seuils
molassiques plus durs que l’alluvion
ancienne qui les recouvre, notamment
à Yernier, à Chèvres, au moulin de
Challex}. On sait en effet que, lorsque,
dans son travail de creusement, un
cours d’eau vient à rencontrer une
couche plus résistante que les autres,
cette couche joue, pour quelque temps,
le rôle de niveau de base, et le profil
du tronçon situé en amont s’établit
temporairement, à partir de ce niveau,
avec tous les caractères d’un profil définitif2.
Ce tronçon s’aplatit de plus en
plus et tourne pour ainsi dire autour
du niveau de base momentané. On voit
donc que la courbe du lit, qui de toute
façon tend vers une forme finale bien
déterminée, peut prendre une série de
formes intermédiaires très variables
et très compliquées ; on conçoit dès
lors que, en certains points de cette
Fio. 149. — Perte du Rhône à Bellegarde.
(D’ap rè s une photographie de M. C h . C o u r to is -
courbe, en particulier à la sortie du lac, l’érosion ne s’exerce pas toujours avec la
même intensité, et que, partant, il y ait alternativement des périodes de creusement
et de repos.
2° LAC D U BO D R G E T
Tandis que le lac de Genève est bordé par un système de terrasses extrêmement
bien développées, rien de semblable n’est visible au lac du Bourget, et les anciens
niveaux que MM. Pillet/ et Hollande4 ont attribués à ce lac sont absolument
hypothétiques. Si nous examinons la cuvette du lac au moment où les glaciers l’ont
abandonnée, nous trouvons que, si on la suppose débarrassée de ses alluvions
1. Carte ¡g é o lo g iq u e du can ton d e Genève au ¿50ÛQ, par Alp hon se Favre.
2 . D e la N oé e t de Mahgkeie, les Formes du te rra in, p . 6 1 .
3. L. P il l e t , Étu de su r les terrains quaternaires de l*arrondissement de Chambéry (Mém. de l1Académie
des sciences, b e lle s-le ttre s e t a r ts de S avoie, 3 e s é r ie , t. IX. p. 300, 1883).
4 . H ollande, Bull. S . G. F ., 3° s é r ie , 1 8 9 5 , t . XXIII, p , x v ..
récentes, elle s’étendait au sud jusque vers Chambéry, au nord dans la vallée du
Rhône jusque vers Seyssel, et au nord-ouest dans celle du Séran jusque vers
Artemare h
Le Rhône débouchait alors directement dans le lac, et les molards de Yions, de
Châtillon, de Lavours formaient des îles pittoresques dans cette petite mer intérieure.
Vers l ’aval, le lac se prolongeait vraisemblablement jusqu’à la moraine frontale
qu’une branche du glacier du Rhône a laissée entre les villages de Massignieu et
de Lucey (pl. II). Remarquons d’ailleurs que, si la cuvette du lac existait avant le
dépôt de cette moraine, elle s’étendait probablement jusqu’à la cluse d’Yenne qui
est, nous l’avons vu2, le premier seuil rocheux qu’on rencontre à l’aval de l’émissaire
du lac.
Cette moraine devait soutenir le lac à un niveau supérieur à celui 'qu’il
occupe aujourd’hui; toutefois nous ne savons pas exactement quelle était l’altitude
de ce niveau. Sur la carte d’État-Major, le point le plus haut de la partie conservée
de la moraine est coté 303 mètres ; mais le point le plus bas de la moraine primitive
était peut-être à un niveau notablement inférieur. Nous ne savons donc pas si le lac
s’élevait assez haut pour se répandre dans la vallée de l’Ousson par la cluse du Lit-
au-Roi, située à 2 kilomètres au nord-ouest de Massignieu et dont la cote est de
282“,503. Si cette vallée a été envahie par le lac, elle devait nécessairement être
barrée par un obstacle transversal plus élevé que la moraine de Massignieu, puisque
c’est à travers celle-ci que l’émissaire du lac a creusé son lit. Il semblé qu’on retrouve
une trace d’un obstacle de cette nature dans une butte qui s’élève au sud du hameau
des Ecassaz et qui paraît être le reste d’une moraine transversale*.
Quel qu’ait été d’ailleurs cet ancien niveau, on n’en retrouvé aucune trace
aujourd’hui ; mais ce fait n’a rien qui doive nous surprendre ; car il se peut que les
terrasses qui lui correspondent soient enfouies sous les alluvions plus récentes des
affluents du lac, tout comme celles qu’a formées le Rhône dans l’ancien lac de
Genève5.
Peu à peu les affluents du lac, le Sierroz, la Leysse, le Séran, le Rhône ont
avancé leurs cônes de déjection, et le Rhône a, pour sa part, si énergiquement travaillé
que son delta est venu s’appuyer, d’une part sur la pointe sud du Colombier,
d’autre part sur la pointe nord du mont Landard ; il a ainsi divisé le lac en deux bassins
dont l’un, celui d’amont, était, à peu de chose près, le lac du Rourget actuel,
et l’autre, celui d’aval, s’étendait sur l’emplacement occupé aujourd’hui par les
1. Voir p age 348.
2 . P a g e 298.
3. D’a p rès le p rofil en lo n g d e la ro u te n a tio n a le n ° 92. La co te 243, in d iq u é e su r la ca r te d’État-
Major, p a ra ît in e x a c te .
4 . Cette b u tte e s t m a lh eu r eu sem en t b o is é e e t le s r a r e s ex c a v a tio n s q u i y s o n t p r a tiq u é e s n e m ’on t
p a s p e rm is d’a ffirmer sa n a tu r e m o r a in iq u e .
| | Voir p a g e 354.