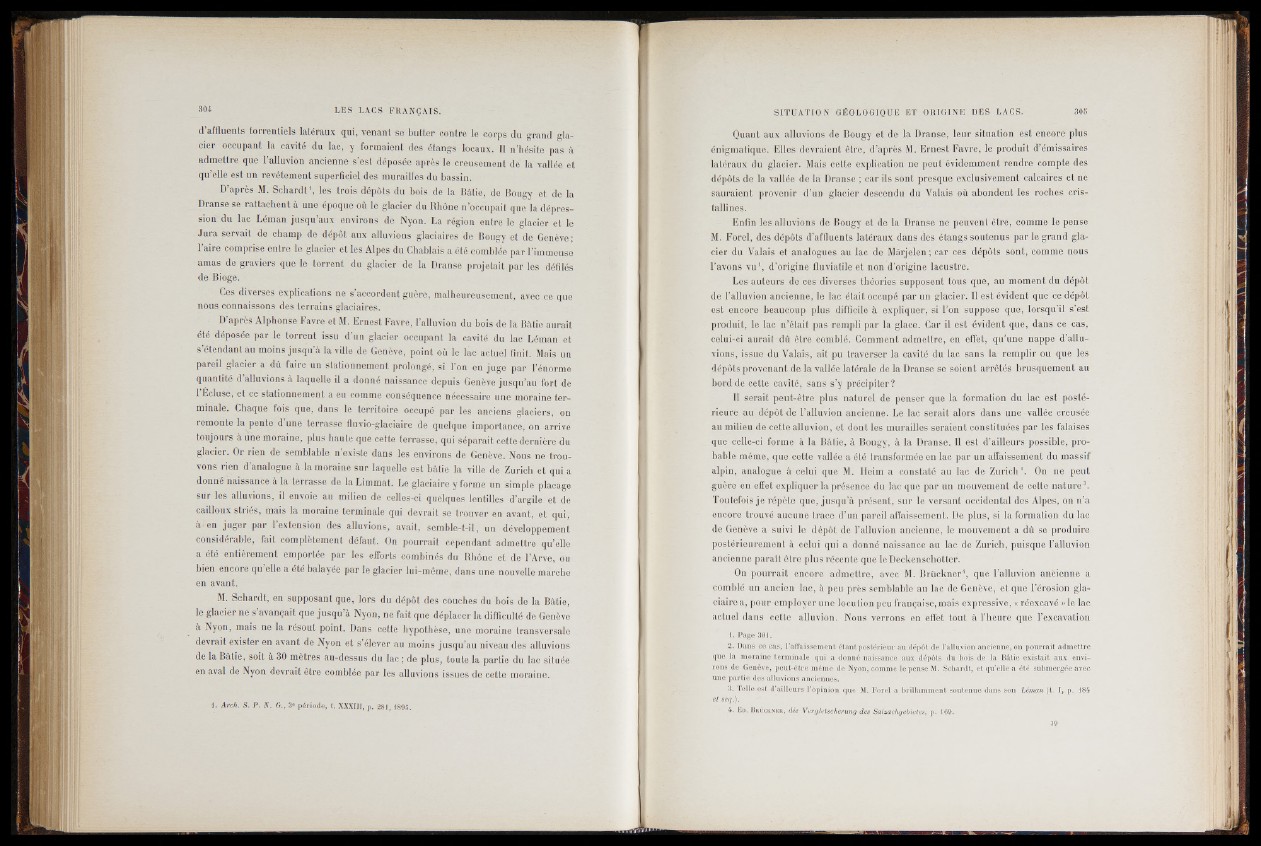
d’affluents torrentiels latéraux qui, venant se butter contre le corps du grand gla-:
cier occupant la cavité du lac, y formaient des étangs locaux. Il n’hésite pas à
admettre que l’alluvion ancienne s’est déposée après le creusement de la vallée et
qu’elle est un revêtement superficiel des murailles du bassin.
D’après M. Schardt*, les trois dépôts du bois de la Bâtie, de Bougy et de la
Dranse se rattachent à une époque où le glacier du Rhône n’occupait que la dépression
du lac Léman jusqu’aux environs de Nyon. La région entre le glacier et le
Jura servait de champ de dépôt aux alluvions glaciaires de Bougy et de Genève ;
l’aire comprise entre le glacier et les Alpes du Chablais a été comblée par l’immense
amas de graviers que le torrent du glacier de la Dranse projetait par les défilés
de Bioge.
Ces diverses explications ne s’accordent guère, malheureusement, avec ce que
nous connaissons des terrains glaciaires.
D’après Alphonse Favre et M. Ernest Favre, l’alluvion du bois de la Bâtie aurait
été déposée par le torrent issu d’un glacier occupant la cavité du lac Léman et
s’étendant au moins jusqu’à la ville de Genève, point où le lac actuel finit. Mais un
pareil glacier a dû faire un stationnement prolongé, si l’on en juge par l’énorme
quantité d alluvions à laquelle il a donné naissance depuis Genève jusqu’au fort de
1 Écluse, et ce stationnement a eu comme conséquence nécessaire une moraine terminale.
Chaque fois que, dans le territoire occupé par les anciens glaciers, on
remonte la pente d une terrasse fluvio-glaciaire de quelque importance, on arrive
toujours à une moraine, plus haute que cette terrasse, qui séparait cette dernière du
glacier. Or rien de semblable n existe dans les environs de Genève. Nous ne trouvons
rien d’analogue à la moraine sur laquelle est bâtie la ville de Zurich et qui a
donné naissance à la terrasse de la Limmat. Le glaciaire y forme un simple placage
sur les alluvions, il envoie au milieu de celles-ci quelques lentilles d’argile et de
cailloux striés, mais la moraine terminale qui devrait se trouver en avant, et qui,
à-en juger par l’extension des alluvions, avait, semble-t-il, un développement
considérable, fait complètement défaut. On pourrait cependant admettre qu’elle
a été entièrement emportée par les efforts combinés du Rhône et de l ’Arve, ou
bien encore qu elle a été balayée par le glacier lui-même, dans une nouvelle marche
en avant.
M. Schardt, en supposant que, lors du dépôt des couches du bois de la Bâtie,
le glacier ne s’avançait que jusqu’à Nyon, ne fait que déplacer la difficulté de Genève
à Nyon, mais ne la résout point. Dans cette hypothèse, une moraine transversale
devrait exister en avant de Nyon et s’élever au moins jusqu’au niveau des alluvions
de la Bâtie, soit à 30 mètres au-dessus du lac ; de plus, toute la partie du lac située
en aval de Nyon devrait être comblée par les alluvions issues de cette moraine.
1. A rch . S. P . IV. G., 3e p é r io d e , t. XXXIII, p . 281, 1895,
Quant aux alluvions de Bougy et de la Dranse, leur situation est encore plus
énigmatique. Elles devraient être, d’après M. Ernest Favre, le produit d’émissaires
latéraux du glacier. Mais cette explication ne peut évidemment rendre compte des
dépôts de la vallée de la Dranse ; car ils sont presque exclusivement calcaires et ne
sauraient provenir d’uD glacier descendu du Valais où abondent les roches cristallines.
Enfin les alluvions de Bougy et de la Dranse ne peuvent être, comme le pense
M. Forel, des dépôts d’affluents latéraux dans des étangs soutenus par le grand glacier
du Valais et analogues au lac de Màrjelen ; car ces dépôts sont, comme nous
l ’avons vu1, d’origine fluviatile et non d’origine lacustre.
Les auteurs de ces diverses théories supposent tous que, au moment du dépôt
de l’alluvion ancienne, le lac était occupé par un glacier. Il est évident que ce dépôt
est encore beaucoup plus difficile à expliquer, si l’on suppose que, lorsqu’il s’est
produit, le lac n’était pas rempli par la glace. Car il est évident que, dans ce cas,
celui-ci aurait dù être comblé. Comment admettre, en effet, qu’une nappe d’allu-
vions, issue du Valais, ait pu traverser la cavité du lac sans la remplir ou que les
dépôts provenant de la vallée latérale de la Dranse se soient arrêtés brusquement au
bord de cette cavité, sans s’y précipiter?
Il serait peut-être plus naturel de penser que la formation du lac est postérieure
au dépôt de l’alluvion ancienne. Le lac serait alors dans une vallée creusée
au milieu de cette alluvion, et dont les murailles seraient constituées par les falaises
que celle-ci forme à la Bâtie, à Bougy, à la Dranse. 11 est d’ailleurs possible, probable
même, que cette vallée a été transformée en lac par un affaissement du massif
alpin, analogue à celui que M. Heim a constaté au lac de Zurich h On ne peut
guère en effet expliquer la présence du lac que par un mouvement de cette nature3.
Toutefois je répète que, jusqu’à présent, sur le versant occidental des Alpes, on n’a
encore trouvé aucune trace d’un pareil affaissement. De plus, si la formation du lac
de Genève a suivi le dépôt de l’alluvion ancienne, le mouvement a dû se produire
postérieurement à celui qui a donné naissance au lac de Zurich, puisque l’alluvion
ancienne paraît être plus récente que leDeckenschotter.
On pourrait encore admettre, avec M. Brückner'1, que l’alluvion ancienne a
comblé un ancien lac, à peu près semblable au lac de Genève, et que l’érosion glaciaire
a, pour employer une locution peu française,mais expressive, « réexcavé » le lac
actuel dans cette alluvion. Nous verrons en effet tout à l’heure que l’excavation
1. P a g e 301.
2 . D an s c e c a s , l ’a ffa is s em en t é ta n t p o sté r ieu r au d ép ô t d e l ’a llu v io n an c ien n e , on p our ra it adm ettre
que la m o r a in e te rm in a le q u i a d on n é n a issa n c e au x d ép ô ts d u b o is d e la B â tie e x is ta it a u x en v iron
s de Genève , p eu t-ê tr e m êm e d e Ny on , com m e le p en se M. Sch ard t, e t qu ’e lle a é t é su bm e rg é e a v e c
u n e p a r tie des a llu v io n s a n c ien n e s.
3. T elle e st d’a ille u r s l’ô p in io n que M. F o r e l a b r illam m en t so u ten u e dans so n Léman (t. I , p . 184
e t seq.).
4. Ed. B r ü c k n e r , die Vergletscherung des Salzachgebietes, p. 169.