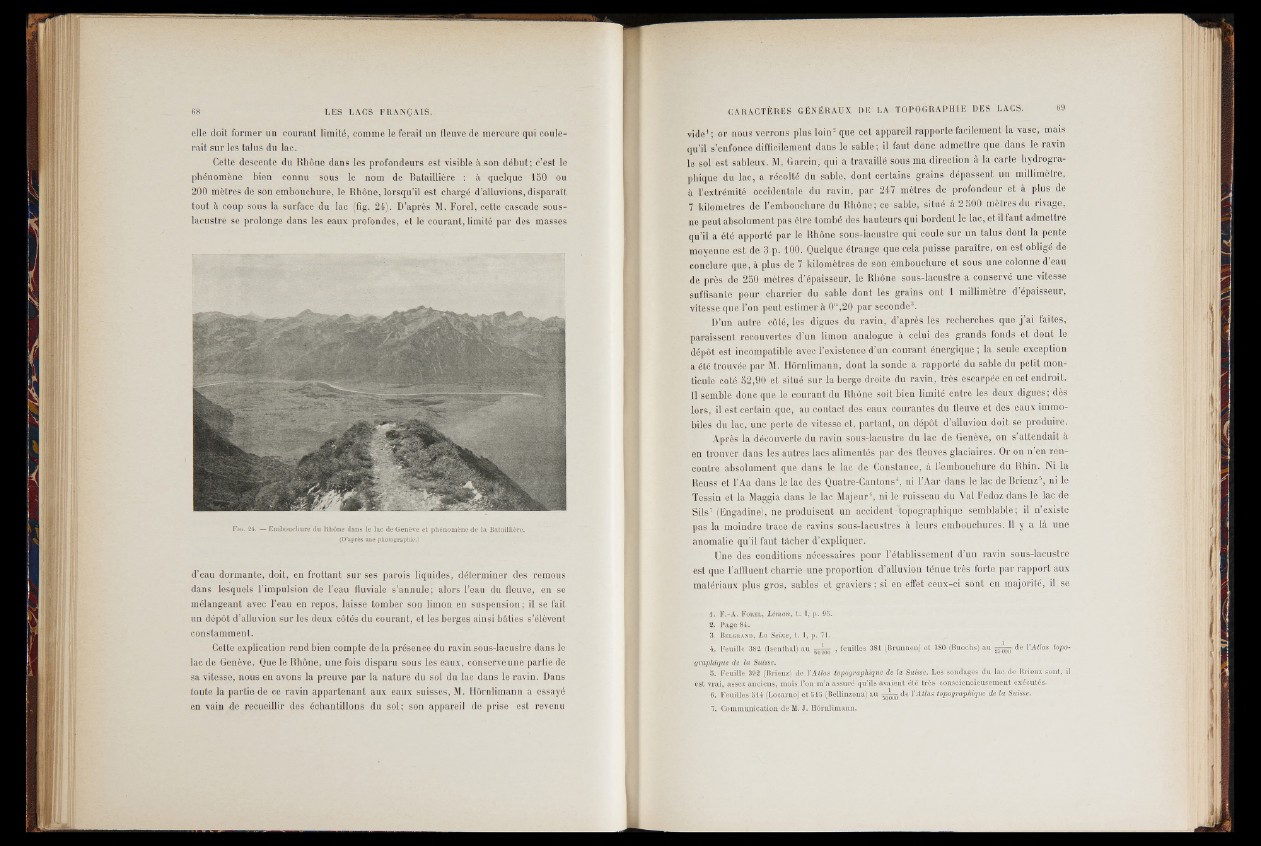
elle doit former un courant limité, comme le ferait un fleuve de mercure qui coulerait
sur les talus du lac.
Cette descente du Rhône dans les profondeurs est visible à.son début; c’est le
phénomène bien connu sous le nom de Bataillière : A quelque 150 ou
200 mètres de son embouchure, le Rhône, lorsqu’il est chargé d’alluvions, disparaît
tout à coup sous la surface du lac (fig. 24). D’après M. Forel, cette cascade sous-
lacustre se prolonge dans les eaux profondes, et le courant, limité par des masses
Fig. 24. — Embouchure du Rhône dans le lac de Genève et phénomène de la Bataillière.
(D’après une photographie.)
d’eau dormante, doit, en frottant sur ses parois liquides, déterminer des remous
dans lesquels l’impulsion de l’eau fluviale s’annule; alors l’eau du fleuve, en se
mélangeant avec l’eau en repos, laisse tomber son limon en suspension; il se fait
un dépôt d’alluvion sur les deux côtés du courant, et les berges ainçi bâties s’élèvent
constamment.
Cette explication rend bien compte delà présence du ravin.sous-lacuslre dans le
lac de Genève. Que le Rhône, une fois disparu sous les eaux, conserve une partie de
sa vitesse, nous en avons la preuve par la nature du sol du lac dans le ravin. Dans
toute la partie de ce ravin appartenant aux eaux suisses, M. Hôrnlimann a essayé
en vain de recueillir des échantillons du sol; son appareil de prise est revenu
vide1 ; or nous verrons plus loin2 que cet appareil rapporte facilement la vase, mais
qu’il s’enfonce difficilement dans le sable ; il faut donc admettre que dans le ravin
le sol est sableux. M. Garcin, qui a travaillé sous ma direction à la carte hydrographique
du lac, a récolté du sable, dont certains grains dépassent un millimètre,
à l’extrémité occidentale du ravin, par 247 mètres de profondeur et à plus de
7 kilomètres de l’embouchure du Rhône; ce sable, situé à 2 800 mètres du rivage,
ne peut absolument pas être tombé des hauteurs qui bordent le lac, et ilfaut admettre
qu’il a été apporté par le Rhône sous-lacustre qui coule sur un talus dont la pente
moyenne est de 3 p. 100. Quelque étrange que cela puisse paraître, on est obligé de
conclure que, à plus de 7 kilomètres de son embouchure et sous une colonne d’eau
de près de 250 mètres d’épaisseur, le Rhône sous-lacustre a conservé une vitesse
suffisante pour charrier du sable dont les grains ont 1 millimètre d épaisseur,
vitesse que l ’on peut estimer à 0“,20 par seconde3.
D’un autre côté, les digues du ravin, d’après les recherches que j ’ai faites,
paraissent recouvertes d’un limon analogue à celui des grands fonds et dont le
dépôt est incompatible avec l’existence d’un courant énergique ; la seule exception
a été trouvée par M. Hôrnlimann, dont la sonde a rapporté du sable du petit monticule
coté 52,90 et situé sur la berge droite du ravin, très escarpée en cet endroit.
11 semble donc que le courant du Rhône soit bien limité entre les deux digues; dès
lors, il est certain que, au contact des eaux courantes du fleuve et des eaux immobiles
du lac, une perte de vitesse et, partant, un dépôt d’alluvion doit se produire.
Après la découverte du ravin sous-lacustre du lac de Genève, on s’attendait .à
en trouver dans les autres lacs alimentés par des fleuves glaciaires. Or on n’en rencontre
absolument que dans le lac de Constance, à Uembouchüre du Rhin. Ni la
Reuss et l’Aa dans le lac des Quatre-Cantons4, ni l’Aar dans le lac de Brienz6, ni le
Tessin et la Maggia dans le lac Majeur6, ni le ruisseau du Val Fedoz dans le lac de
Sils7 (Engadine), ne produisent un accident topographique semblable; il n’existe
pas la moindre trace de ravins sous-lacustres à leurs embouchures. Il y a là une
anomalie qu’il faut tâcher d’expliquer.
Une des conditions nécessaires pour l’établissement d’un ravin sous-lacustre
est que l’affluent charrie une proportion d’alluvion ténue très forte par rapport aux
matériaux plus gros, sables et graviers ; si en effet ceux-ci sont en majorité, il se
1. F .-A . F o r e l, Léman, t. I, p. 95.
2. P a g e 84.
3. Belgrand, La Seine, t. I, p . 7 1 .
4 . F eu ille 382 (Isenthal) au , fe u ille s 381 (B ru u n c n ) e t. 3SO (Buochs) au ¿ ¿ y d e l'Aifas topo-
graph iqu e d e la Suisse.
5. F eu ille 392 (Brienz) de Y A tla s topographique de la Suisse. Les son da g e s du la c de Brienz so n t, il
e s t v ra i, a sse z a n c ien s , m a is l ’on m ’a a ssu r é q u ’ils a v a ien t é té tr è s c o n s c ien c ie u s em en t e x é cu té s .
6 . F eu ille s 514 (L o cam o ) e t 515 (BcUinzona) a u d e V Atlà s topographique de la Suisse.
7. C om m un ica tion d e M. J. Hôrn limann .