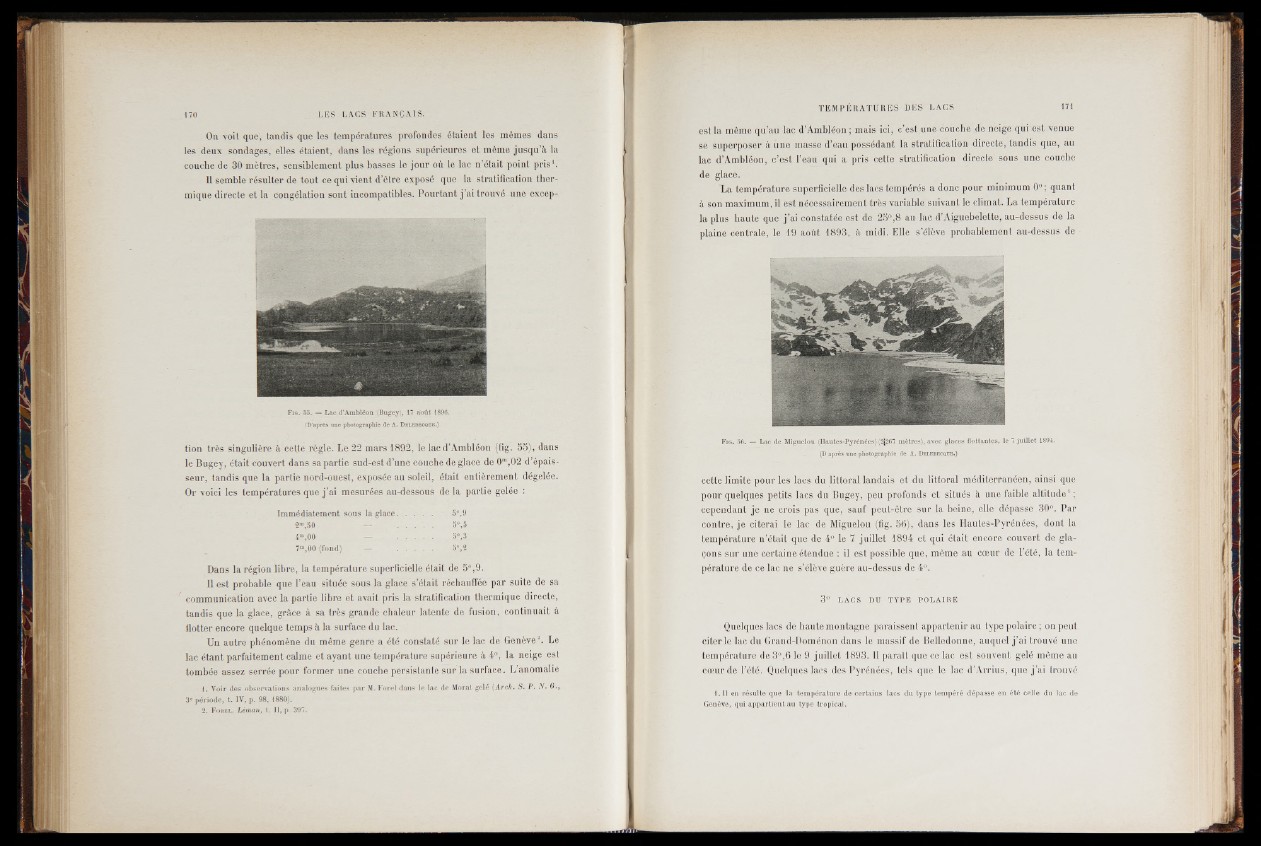
On voit que, tandis que les températures profondes étaient les mêmes dans
les deux sondages, elles étaient, dans les régions supérieures et même jusqu’à la
couche de 30 mètres, sensiblement plus basses le jour où le lac n’était point pris1.
Il semble résulter de tout ce qui vient d’être exposé que la stratification thermique
directe et la congélation sont incompatibles. Pourtant j’ai trouvé une excep-
Fig. 55. — Lac d’Amhléon (Bugey), 17 août 1896.
(D'après une photographie d e A. D e le b e c q u e .)
tion très singulière à cette règle. Le 22 mars 1892, le lacd’Àmbléon (fig. 55),-dans
le Bugey, était couvert dans sa partie sud-est d’une couche de glace de 0"',02 d’épaisseur,
tandis que la partie nord-ouest, exposée au soleil, était entièrement dégelée.
Or voici les températures que j ’ai mesurées au-dessous de la partie gelée :
Im m éd ia tem e n t sous la g la c e .................. 5°,9
2“ ,50 — . . . . . 5“,5
4 » , 0 0 —- ......................... 3 ° ,3
7"', 00 (fond) . . . . . 5°,2
Dans la région libre, la température superficielle était de 5°,9.
Il est probable que l’eau située sous la glace s’était réchauffée par suite de sa
communication avec la partie libre et avait pris la stratification thermique directe,
tandis que la glace, grâce à sa très grande chaleur latente de fusion, continuait à
flotter encore quelque temps à la surface du lac.
Un autre phénomène du même genre a été constaté sur le lac de Genève2. Le
lac étant parfaitement calme et ayant une température supérieure à 4°, la neige est
tombée assez serrée pour former une couche persistante sur la surface. L’anomalie
1. Voir d e s ob se rv a tion s an a lo gu e s fa ite s par M. Fore l dans le la c de Morat g e lé (A r eh . S . P. A'. G.,
3« p é r io d e , t . IV, p . 98, 1880).
2 . F orel. Léman, t . II, p . 3 9 7 .
est la même qu’au lac d’Ambléon ; mais ici, c’est une couche de neige qui est venue
se superposer à une masse d’eau possédant la stratification directe, tandis que, au
lac d’Ambléon, c’est l’eau qui a pris cette stratification directe sous une couche
de glace.
La température superficielle des lacs tempérés a donc pour minimum 0°; quant
à son maximum, il est nécessairement très variable suivant le climat. La température
la plus haute que j ’ai constatée est de 25°,8 au lac d’Aiguebelette, au-dessus de la
plaine centrale, le 19 août 1893, à midi. Elle s’élève probablement au-dessus de
Fig. 56. — Lac de Miguelou (Hautes-Pyrénées) (21267 mètres), avec glaces flottantes, le 7 juillet 1894.
(D a p r è s u n e ph o to g rap h ie d e A. D e leb e c q u e .)
cette limite pour les lacs du littoral landais et du littoral méditerranéen, ainsi que
pour quelques petits lacs du Bugey, peu profonds et situés à une faible altitude1;
cependant je ne crois pas que, sauf peut-être sur la beine, elle dépasse 30°. Par
contre, je citerai le lac de Miguelou (fig. 56), dans les Hautes-Pyrénées, dont la
température n’était que de 4° le 7 juillet 1894 et qui était encore couvert de glaçons
sur une certaine étendue : il est possible que, même au coeur de l’été, la température
de ce lac ne s’élève guère au-dessus de 4°.
3 ° L A C S D U T Y P E PO L A IR E
Quelques lacs de haute montagne paraissent appartenir au type polaire ; on peut
citer le lac du Grand-Doménon dans le massif de Belledonne, auquel j ’ai trouvé une
température de 3°,6 le 9 juillet 1893. 11 paraît que ce lac est souvent gelé même au
coeur de l’été. Quelques lacs des Pyrénées, tels que le lac d’Àrrius, que j ’ai trouvé
1 . 11 en ré sulte que la temp ératur e de certains la cs du type temp éré d ép a sse en é t é c e lle du la c de
Genève, q ui ap par tien t au type tropical.