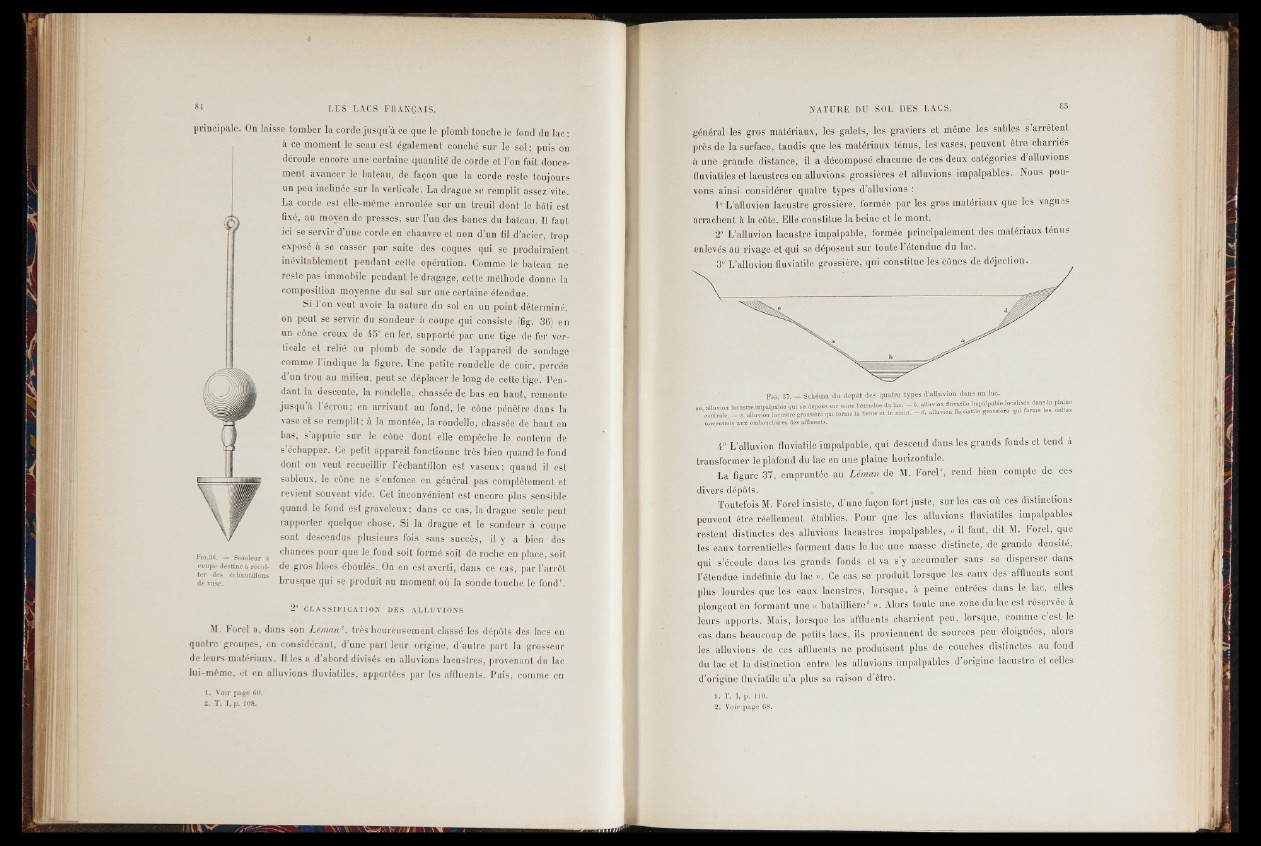
principale. On laisse tomber la corde jusqu'à ce que le plomb touche le fond du lac;
à ce moment le seau est également couché sur le sol ; puis on
déroule encore une certaine quantité de corde et l’on fait doucement
avancer le bateau, de façon que la corde reste toujours
un peu inclinée sur la verticale. La drague se remplit assez vite.
La corde est elle-même enroulée sur un treuil dont le bâti est
fixé, au moyen de presses, sur l’un des bancs du bateau. Il faut
ici se servir d’une corde en chanvre et non d’un fil d’acier, trop
exposé à se casser par suite des coques qui se produiraient
inévitablement pendant cette opération. Comme le bateau ne
reste pas immobile pendant le dragage, cette méthode donne la
composition moyenne du sol sur une certaine étendue.
Si l’on veut avoir la nature du sol en un point déterminé,
on peut se servir du sondeur à coupe qui consiste (fig. 36) en
un cône creux de 48° en fer, supporté par une tige de fer verticale
et relié au plomb de sonde de l’appareil de sondage
comme 1 indique la figure. Une petite rondelle de cuir, percée
d’un trou au milieu, peut se déplacer le long de cette tige. Pendant
la descente, la rondelle, chassée de bas en haut, remonte
jusqu’à l’écrou; en arrivant au fond, le cône pénètre dans la
vase et se remplit; à la montée, la rondelle, chassée de haut en
bas, s appuie sur le cône dont elle empêche le contenu de
s’échapper. Ce petit appareil fonctionne très bien quand le fond
dont on veut recueillir l’échantillon est vaseux; quand il est
sableux, le cône ne s’enfonce en général pas complètement et
revient souvent vide. Cet inconvénient est encore plus sensible
quand le fond est graveleux; dans ce cas, la drague seule peut
rapporter quelque chose. Si la drague et le sondeur à coupe
sont descendus plusieurs fois sans succès, il y a bien des
Fig.36. - Sondeur à chances Pour que le fond soit formé soit de roche en place, soit
coupe destiné à récoi- de gros blocs éboulés. On en est averti, dans ce cas, par l’arrêt
ter des échantillons -, . . .
de vase. nrusque qui se produit au moment où la sonde touche le fond1.
2° C L A S S IF IC A T IO N D E S A L L U V IO N S
M. Forel a, dans son Léman2, très heureusement classé les dépôts des lacs en
quatre groupes, en considérant, d’une part leur origine, d’autre part la grosseur
de leurs matériaux. 11 les a d’abord divisés en alluvions lacustres, provenant du lac
lui-même, et en alluvions fluviátiles, apportées par les affluents. Puis, comme en
1. Voir p age 60.
2 . T . I, p . 1 0 8 .
général les gros matériaux, les galets, les graviers et même les sables s arrêtent
près de la surface, tandis que les matériaux ténus, les vases, peuvent être charriés
à une grande distance, il a décomposé chacune de ces deux catégories d alluvions
fluviátiles et lacustres en alluvions grossières et alluvions impalpables. Nous pouvons
ainsi considérer quatre types d’alluvions :
1° L’alluvion lacustre grossière, formée pat- les gros matériaux que les vagues
arrachent à la côte. Elle constitue la beine et le mont.
2° L’alluvion lacustre impalpable, formée principalement des matériaux ténus
enlevés au rivage et qui se déposent sur toute l’étendue du lac.
FiG. 37. — S ch ém a d u d é p ô t d e s quatr e ty p e s d’a llu v io n d a n s u n la c .
„„ ¡aluvión lacustre impalpable qui se dépose sur toute l'étendue du lue. - 6, aUuvion üuvatile impalpable localisée dans la plaine
ucntrâlc. — À alluvion lae.stie grossière qui forme la beine et le mont. - i, alluvion iuviatde grossier, qui forme les deltas
torrentiels aux embouchures des affluents.
4° L’alluvion fluviatile impalpable, qui descend dans les grands fonds et tend à
transformer le plafond du lac en une plaine horizontale.
La figure 37, empruntée au Léman de M. Forel1, rend bien compte de ces
divers dépôts.
Toutefois M. Forel insiste, d’une façon fort juste, sur les cas où ces distinctions
peuvent être réellement établies. Pour que les alluvions fluviátiles impalpables
restent distinctes des alluvions lacustres impalpables, « il faut, dit M. Forel, que
les eaux torrentielles forment dans le lac une masse distincte, de grande densité,
qui s’écoule dans les grands fonds et va s’y accumuler sans se disperser dans
l’étendue indéfinie du lac ». Ce cas se produit lorsque les eaux des affluents sont
plus lourdes que les eaux lacustres, lorsque, à peine entrées dans le lac, elles
plongent en formant une « bataillière* ». Alors toute une zone du lac est réservée à
leurs apports. Mais, lorsque les affluents charrient peu, lorsque, comme c’est le
cas dans beaucoup de petits lacs, ils proviennent de sources peu éloignées, alors
les alluvions de ces affluents ne produisent plus de couches distinctes au fond
du lac et la distinction entre les alluvions impalpables d’origine lacustre et celles
d’origine fluviatile n’a plus sa raison d’être.
1. T. I, p. n o .
2. Voir page 68 .