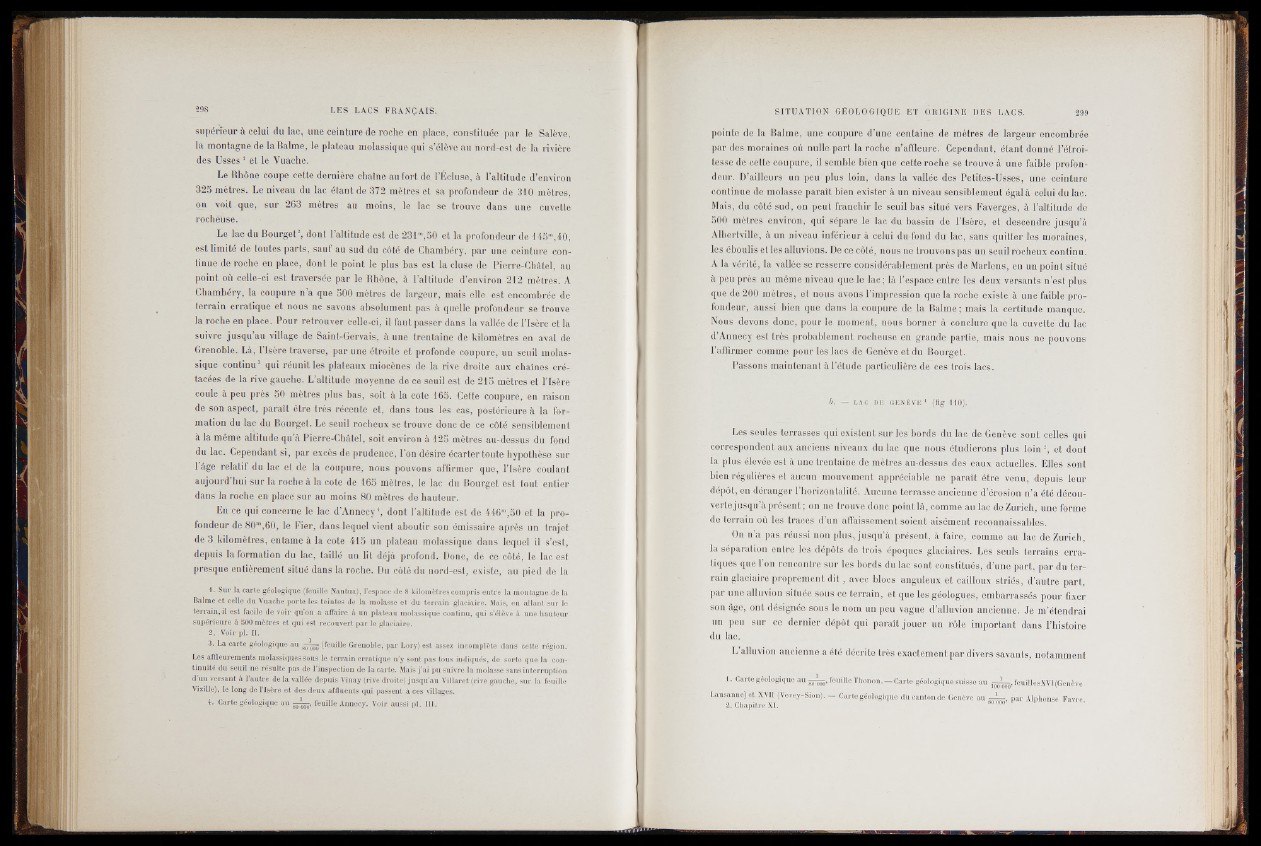
supérieur à celui du lac, une ceinture de roche en place, constituée par le Salève,
la montagne de laBalme, le plateau molassique qui s’élève au nord-est de la rivière
des Usses1 et le Vuache.
Le Rhône coupe cette dernière chaîne au fort de l’Écluse, à l’altitude d’environ
325 mètres. Le niveau du lac étant de 372 mètres et sa profondeur de 310 mètres,
on voit que, sur 263 mètres au moins, le lac se trouve dans une cuvette
rocheuse.
Le lac du Bourget5, dont l’altitude est de 231",50 et la profondeur de 145",40,
est limité de toutes parts, sauf au sud du côté de Chambéry, par une ceinture continue
de roche en place, dont le point le plus bas est la cluse de Pierre-Châtel, au
point où celle-ci est traversée par le Rhône, à l’altitude d’environ 212 mètres. A
Chambéry, la coupure n’a que 500 mètres de largeur, mais elle est encombrée de
terrain erratique et nous ne savons absolument pas à quelle profondeur se trouve
la roche en place. Pour retrouver celle-ci, il faut passer dans la vallée de l’Isère et la
suivre jusqu’au village de Saint-Gervais, à une trentaine de kilomètres en aval de
Grenoble. Là, l’Isère traverse, par une étroite et profonde coupure, un seuil molassique
continu5 qui réunit les plateaux miocènes de la rive droite aux chaînes crétacées
de la rive gauche. L’altitude moyenne de ce seuil est de 215 mètres et l’Isère
coule à peu près 50 mètres plus bas, soit à la cote 165. Cette coupure, en raison
de son aspect, paraît être très récente et, dans tous les cas, postérieure à la formation
du lac du Bourget. Le seuil rocheux se trouve donc de ce côté sensiblement
à la même altitude qu’à Pierre-Châtel, soit environ à 125 mètres au-dessus du fond
du lac. Cependant si, par excès de prudence, l’on désire écarter toute hypothèse sur
1 âge relatif du lac et de la coupure, nous pouvons affirmer que, l’Isère coulant
aujourd’hui sur la roche à la cote de 165 mètres, le lac du Bourget est tout entier
dans la roche en place sur au moins 80 mètres de hauteur.
En ce qui concerne le lac d’Annecy4, dont l’altitude est de 446",50 et la profondeur
de 80“,60, le Fier, dans lequel vient aboutir son émissaire après un trajet
de 3 kilomètres, entame à la cote 415 un plateau molassique dans lequel il s’est,
depuis la formation du lac, taillé un lit déjà profond. Donc, de ce côté, le lac est
presque entièrement situé dans la roche. Du côté du nord-est, existe, au pied de la
\. Sur la carte géologique (feuille Nantua), l’espace de 8 kilomètres compris entre la montagne de la
Bal me et celle du Vuache porte les teintes de la molasse et du terrain glaciaire. Mais, en allant sur le
terrain, il est facile de voir qu’on a affaire à un plateau molassique continu, qui s’élève à une hauteur
supérieure à 500 m ètres et qui est recouvert par le glaciaire.
2 . Voir pl. II.
3. La carte géologique au ¿ ^ 0 (feuille Grenoble, par Lory) est assez incomplète dans cette région.
Les affleurements molassiques squs le terrain erratique n ’y sont pas tous indiqués, de sorte que la continuité
du seuil ne résulte pas de l’inspection de la carte. Mais j ’ai pu suivre la molasse sans interruption
d’un versant à l’autre de la vallée depuis Vinay (rive droite) jusqu’au Villaret (rive gauche, sur la feuille
Vizille), le long de l’Isère et des deux affluents qui passent à ces villages.
4. Carte géologique au feuille Annecy. Voir aussi pl. III.
pointe de la Balme, une coupure d’une centaine de mètres de largeur encombrée
par des moraines où nulle part la roche n’affleure. Cependant, étant donné l’étroi-
tesse de cette coupure, il semble bien que cette roche se trouve à une faible profondeur.
D’ailleurs un peu plus loin, dans la vallée des Petites-Usses, une ceinture
continue de molasse paraît bien exister à un niveau sensiblement égal à celui du lac.
Mais, du côté sud, on peut franchir le seuil bas situé vers Faverges, à l’altitude de
500 mètres environ, qui sépare le lac du bassin de l’Isère, et descendre jusqu’à
Albertville, à un niveau inférieur à celui du fond du lac, sans quitter les moraines,
les éboulis etles alluvions. De ce côté, nous ne trouvonspas un seuil rocheux continu.
A la vérité, la vallée se resserre considérablement près de Marlens, en un point situé
à peu près au même niveau que le lac ; là l’espace entre les deux versants n’est plus
que de 200 mètres, et nous avons l’impression que la roche existe à une faible profondeur,
aussi bien que dans la coupure de la Balme ; mais la certitude manque.
Nous devons donc, pour le moment, nous borner à conclure que la cuvette du lac
d’Annecy est très probablement rocheuse en grande partie, mais nous ne pouvons
l’affirmer comme pour les lacs de Genève et du Bourget.
Passons maintenant à l’étude particulière de ces trois lacs.
b , H LAC DE GENÈVE * (fig 1 1 0 ).
Les seules terrasses qui existent sur les bords du lac de Genève sont celles qui
correspondent aux anciens niveaux du lac que nous étudierons plus lo in5, et dont
la plus élevée est à une trentaine de mètres au-dessus des eaux actuelles. Elles sont
bien régulières et aucun mouvement appréciable ne paraît être venu, depuis leur
dépôt, en déranger l’horizontalité. Aucune terrasse ancienne d’érosion n’a été décou-
vertejusqu’àprésent; on ne trouve donc pointlà, comme au lac de Zurich, une forme
de terrain où les traces d’un affaissement soient aisément reconnaissables.
On n’a pas.réussi non plus, jusqu’à présent, à faire, comme au lac de Zurich,
la séparation entre les dépôts de trois époques glaciaires. Les seuls terrains erratiques
que l’on rencontre sur les bords du lac sont constitués, d’une part, par du terrain
glaciaire proprement d it , avec blocs anguleux et cailloux striés, d’autre part,
par une alluvion située sous ce terrain, et que les géologues, embarrassés pour fixer
son âge, ont désignée sous le nom un peu vague d’alluvion ancienne. Je m’étendrai
un peu sur ce dernier dépôt qui paraît jouer un rôle important dans l’histoire
du lac.
L’alluvion ancienne a été décrite très exactement par divers savants, notamment
11 Carte géologique au 5jL _ , feuille Thonon. — Carte géologique suisse au —Ljg, feuillesXVI(Genève
Lausanne) et XVII ( Vevey-Sion). — Carte géologique du canton de Genève au par Alphonse Favre
2. Chapitre XI. 0 000