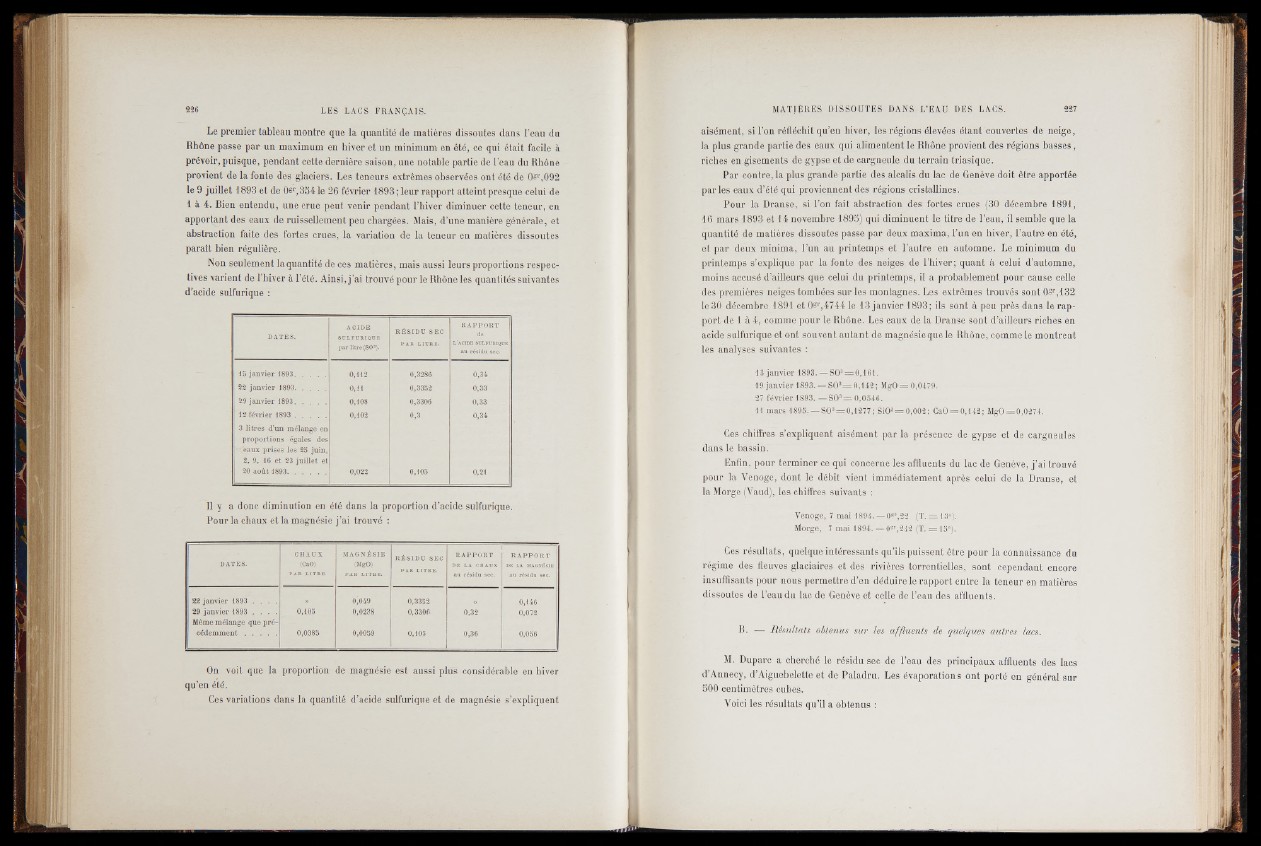
Le premier tableau montre que la quantité de matières dissoutes dans l’eau du
Rhône passe par un maximum en hiver et un minimum en été, ce qui était facile à
prévoir, puisque, pendant cette dernière saison, une notable partie de l’eau du Rhône
provient de la fonte des glaciers. Les teneurs extrêmes observées ont été de 0sr,092
le 9 juillet 1893 et de 0sr,.354 le 26 fév rier 1893; leur rapport atteint presque celui de
1 à 4. Bien entendu, une crue peut venir pendant l’hiver diminuer cette teneur, en
apportant des eaux de ruissellement peu chargées. Mais, d’une manière générale, et
abstraction faite des fortes crues, la variation de la teneur en matières dissoutes
paraît bien régulière.
Non seulement la quantité de ces matières, mais aussi leurs proportions respectives
varient de l’hiver à l ’été. Ainsi, j ’ai trouvé pour le Rhône les quantités suivantes
d’acide sulfurique :
DATES.
ACIDE
SULFURIQUE
par litre (SOs).
R É S ID U SEC
PAR LITRE.
R A P PO R T
de
l ’acide sulfurique
au résidu sec.
15 ja n v ie r 1 893................... 0,112 0,3286 0,34
22 ja n v ie r J 893................... 0,11 0,3352 0,33
29 ja n v ie r 1893. . . 0,108 0,3306 0,33
12 fé v r ie r 1893 ................... 0,102 0,3 0,34
3 litr e s d’u n m é la n g e en
prop o r tion s ég a le s des
e a u x p r ise s le s 25 ju in ,
2 , 9 , 16 e t 23 ju ille t et
20 a o û t 1893........................ 0,022 0,105 0,21
Il y a donc diminution en été dans la proportion d’acide sulfurique.
Pour la chaux et la magnésie j’ai trouvé :
DATES.
CHAUX
(CaO)
PAR LITRE.
MAGNÉSIE
(MgO)
R É SID U SEC
PAR LITRE.
RAP POR T
DE LA CHAUX
au résidu sec.
3
R A P PO R T
DE LA MAGNÉSIE
au résidu sec.
22 ja n v ie r 1893 . . . . » 0j049 0,3352 0,146
29 ja n v ie r 1893 . . . . 0,105 0,0238 0,3306 0,32 0,072
Même m é la n g e q u e p r é c
é d em m en t ................... 0,0385. 0,0059 0,105 0,36 0,056
On voit que la proportion de magnésie est aussi plus considérable en hiver
qu’en été.
Ces variations dans la quantité d’acide sulfurique et de magnésie s’expliquent
aisément, si l’on réfléchit qu’en hiver, les régions élevées étant couvertes de neige,
la plus grande partie des eaux qui alimentent le Rhône provient des régions basses,
riches en gisements de gypse et de cargneule du terrain triasique.
Par contre, la plus grande partie des alcalis du lac de Genève doit être apportée
parles eaux d’été qui proviennent des régions cristallines.
Pour la Dranse, si l’on fait abstraction des fortes crues (30 décembre 1891,
16 mars 1893 et 14 novembre 1895) qui diminuent le titre de l’eau, il semble que la
quantité de matières dissoutes passe par deux maxima, l’un en hiver, l’autre en été,
et par deux minima, l’un au printemps et l’autre en automne. Le minimum du
printemps s’explique par la fonte des neiges de l’hiver; quant à celui d’automne,
moins accusé d’ailleurs que celui du printemps, il a probablement pour cause celle
des premières neiges tombées sur les montagnes. Les extrêmes trouvés sont 0?r,132
le 30 décembre 1891 et 0sr,4744 le 13 janvier 1893; ils sont à peu près dans le rapport
de 1 à. 4, comme pour le Rhône. Les eaux de la Dranse sont d’ailleurs riches en
acide sulfurique et ont souvent autant de magnésie que le Rhône, comme le montrent
les analyses suivantes :
13 ja n v ie r 1893. — SO?=.D,161.
19 ja n v ie r 1893. — S O '= 0,142 ; MgO = 0,0479.
27 fév rie r 1893. — S0 3 = 0,0546.
,11 m a rs 1895. — SOS= 0 , 1277; Si02= 0,002; CaO = 0,142; MgO = 0,0474.
Ces chiffres s’expliquent aisément par la présence de gypse et de cargneules
dans le bassin.
Enfin, pour terminer ce qui concerne les affluents du lac de Genève, j ’ai trouvé
pour la Venoge, dont le débit vient immédiatement après celui de la Dranse, et
la Morgé (Vaud), les chiffres suivants :
Yenoge, 7 m a i 1894. —-0 s r,22 (T. ==§130).
Morge, 7 mai 1894. — 0!r,242 (T. = 15°),'
Ces résultats, quelque intéressants qu’ils puissent être pour la connaissance du
régime des fleuves glaciaires et des rivières torrentielles, sont cependant encore
insuffisants pour nous permettre d’en déduire le rapport entre la teneur en matières
dissoutes de l’eau du lac de Genève et celle de l’eau des affluents.
B. — Résultats, obtenus sur les affluents de quelques autres lacs.
M. Duparc a cherché le résidu sec de l’eau des principaux affluents des lacs
d’Annecy, d’Aiguebelette et de Paladru. Les évaporations ont porté en général sur
500 centimètres cubes.
Yoici les résultats qu’il a obtenus :