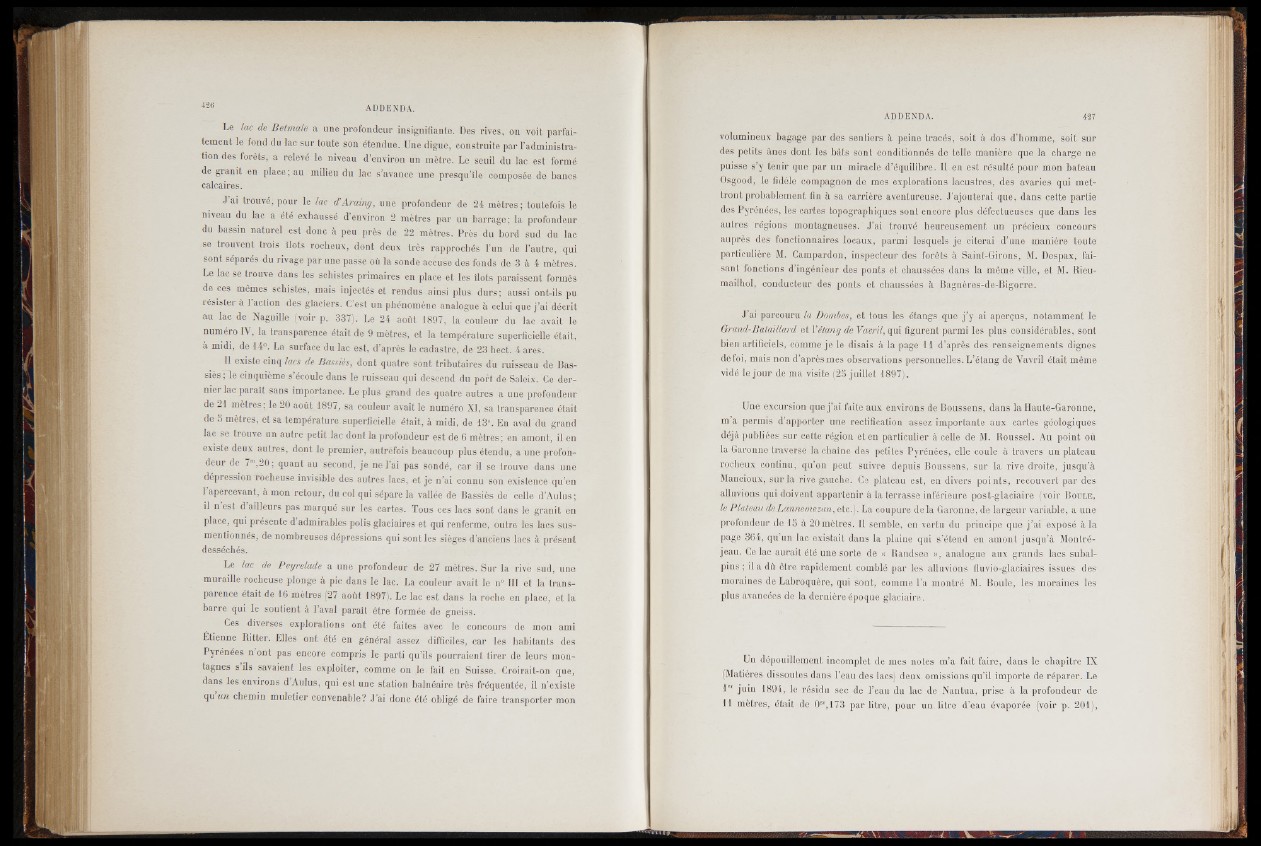
Le lac de Betmale a une profondeur insignifiante. Des rives, on voit parfaitement
le fond du lac sur toute son étendue. Une digue, construite par l’administration
des forêts, a relevé le niveau d’environ un mètre. Le seuil du lac est formé
de granit en place ; au milieu du lac s’avance une presqu’île composée de bancs
calcaires.
J’ai trouvé, pour le lac d’Araing, une profondeur de 24 mètres; toutefois le
niveau du lac a été exhaussé d’environ 2 mètres par un barrage; la profondeur
du bassin naturel est donc à peu près de 22 mètres. Près du bord sud du lac
se trouvent trois îlots rocheux, dont deux très rapprochés l’un de l’autre, qui
sont séparés du rivage par une passe où la sonde accuse des fonds de 3 à 4 mètres.
Le lac se trouve dans les schistes primaires en place et les îlots paraissent formés
de ces mêmes schistes, mais injectés et rendus ainsi plus durs; aussi ont-ils pu
résister à l’action des glaciers. C’est un phénomène analogue à celui que j ’ai décrit
au lac de Naguille (voir p. 337). Le 24 août 1897, la couleur du lac avait le
numéro IV, la transparence était de 9 mètres, et la température superficielle était,
à midi, de 14°. La surface du lac est, d’après le cadastre, de 23 hect. 4 ares.
Il existe cinq lacs de Bassiès, dont quatre sont tributaires du ruisseau de Bas-
siès fie cinquième s’écoule dans le ruisseau qui descend du port de Saleix. Ce dernier
lac paraît sans importance. Le plus grand des quatre autres a une profondeur
de 21 mètres ; le 20 août 1897, sa couleur avait le numéro XI, sa transparence était
de 5 mètres, et sa température superficielle était, à midi, de 13°. En aval du grand
lac se trouve un autre petit lac dont la profondeur est de 6 mètres; en amont, il en
existe deux autres, dont le premier, autrefois beaucoup plus étendu, a une profondeur
de 7“,20 ; quant au second, je ne l’ai pas sondé, car il se trouve dans une
dépression rocheuse invisible des autres lacs, et je n’ai connu son existence qu’en
1 apercevant, à mon retour, du col qui sépare la vallée de Bassiès de celle d’Aulus;
il n est d ailleurs pas marqué sur les cartes. Tous ces lacs sont dans le granit en
place, qui présente d admirables polis glaciaires et qui renferme, outre les lacs susmentionnés,
de nombreuses dépressions qui sont les sièges-d’anciens lacs à présent
desséchés.
Le lac de Peyrelàde a une profondeur de 27 mètres. Sur la rive Sud, une
muraille rocheuse plonge à pic dans le lac. La couleur avait le n° III et la transparence
était de 16 mètres (27 août 1897). Le lac est dans la roche en place, et la
barre qui le soutient à l’aval paraît être formée de gneiss.
Ces diverses explorations ont été faites avec le concours de mon ami
Étienne Ritter. Elles ont été en général assez difficiles, car les habitants des
Pyrénées n ont pas encore compris le parti qu’ils pourraient tirer de leurs montagnes
s ils savaient les exploiter, comme on le fait en Suisse. Croirait-on que,
dans les environs d Aulus, qui est une station balnéaire très fréquentée, il n’existe
qu un chemin muletier convenable? J’ai donc été obligé de faire transporter mon
volumineux bagage par des sentiers à peine tracés, soit à dos d’homme, soit sur
des petits ânes dont les bâts sont conditionnés de telle manière que la charge ne
puisse s’y tenir que par un miracle d’équilibre. Il en est résulté pour mon bateau
Osgood, le fidèle compagnon de mes explorations lacustres, des avaries qui mettront
probablement fin à sa carrière aventureuse. J’ajouterai que, dans cette partie
des Pyrénées, les cartes topographiques sont encore plus défectueuses que dans les
autres régions montagneuses. J’ai trouvé heureusement un précieux concours
auprès des fonctionnaires locaux, parmi lesquels je citerai d’une manière toute
particulière M. Campardon, inspecteur des forêts à Saint-Girons, M. Despax, faisant
fonctions d’ingénieur des ponts et chaussées dans la même ville, et M. Rieu-
mailhol, conducteur des ponts et chaussées à Bagnères-de-Bigqrre.
J’ai parcouru la Dombes, et tous les étangs que j ’y ai aperçus, notamment le
Grand-Bataillard et l'étang de Vavril, qui figurent parmi les plus considérables, sont
bien artificiels, comme je le disais à la page 11 d’après des_ renseignements dignes
dëfoi, mais non d’après mes observations personnelles. L’étang de Vavril était même
vidé le jour de ma visite (25 juillet 1897).
Une excursion que j’ai faite aux environs de Boussens, dans la Haute-Garonne,
m’a permis d’apporter une rectification assez importante aux cartes géologiques
déjà publiées sur cette région et en particulier à celle de M. Roussel. Au point où
la Garonne traverse la chaîne des petites Pyrénées, elle coule à travers un plateau
rocheux continu, qu’on peut suivre depuis Boussens, sur la rive droite, jusqu’à
Mancioux, sur la rive gauche. Ce plateau est, en divers points, recouvert par des
alluvions qui doivent appartenir à la terrasse inférieure post-glaciaire (voir Boule,
le Plateau deLannemezan, etc.). La coupure delà Garonne, de largeur variable, a une
profondeur de 15 à 20 mètres. Il semble, en vertu du principe que j ’ai exposé à la
page 364, qu’un lac existait dans la plaine qui s ’étend en amont jusqu’à Montré-
jeau. Ce lac aurait été une sorte de « Randsee », analogue aux grands lacs subalpins
; il a dû être rapidement comblé par les alluvions fluvio-glaciaires issues des
moraines de Labroquère, qui sont, comme l’a montré M. Boule, les moraines les
plus avancées de la dernière époque glaciaire.
Un dépouillement incomplet de mes notes m’a fait faire, dans le chapitre IX
(Matières dissoutes dans l’eau des lacs) deux omissions qu’il importe de réparer. Le
1" juin 1894, le résidu sec de l’eau du lac de Nantua, prise à la profondeur de
11 mètres, était de 0“r,173 par litre, pour un. litre d’eau évaporée (voir p. 201),