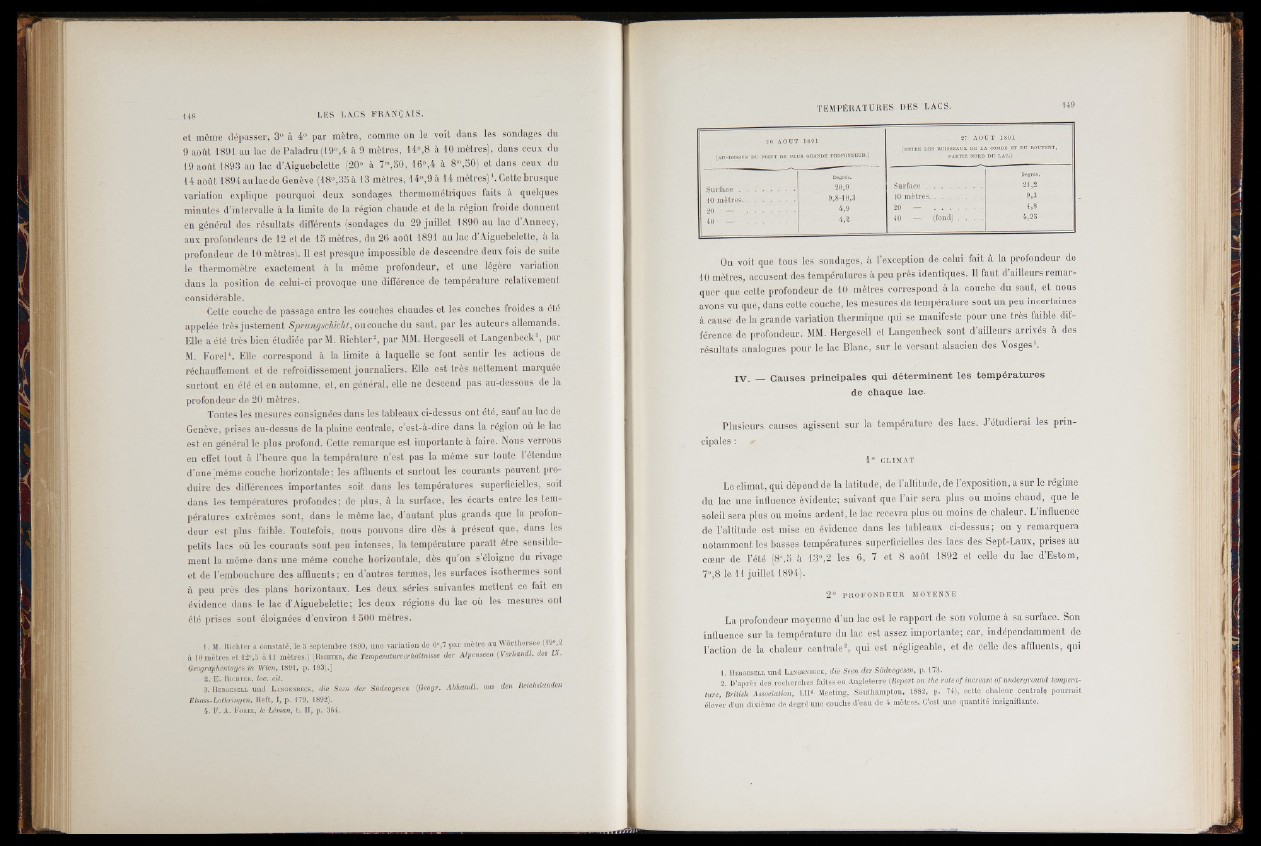
et même dépasser, 3° à 4° par mètre, comme on le voit dans les sondages du
9 août 1891 au lac de Paladru (19°,4 à 9 mètres, 14°,8 à 10 mètres), dans ceux du
19 août 1893 au lac d’Aiguebelette (20° à 7”,50, 16°,4 à 8m,30) et dans ceux du
14 août 1894 au lac de Genève (18°,33 à 13 mètres, 14°,9 à 14 mètres)'. Cette brusque
variation explique pourquoi deux sondages thermométriques faits à quelques
minutes d’intervalle à la limite de la région chaude et de la région froide donnent
en général des résultats différents (sondages du 29 juillet 1890 au lac d’Annecy,
aux profondeurs de 12 et de 13 mètres, du 26 août 1891 au lac d’Aiguebelette, à. la
profondeur de 10 mètres). Il est presque impossible de descendre deux fois de suite
le thermomètre exactement à la même profondeur, et une légère variation
dans la position de celui-ci provoque une différence de température relativement
considérable.
Cette couche de passage entre les couches chaudes et les couches froides a été
appelée très justement Sprungsckïcht, ou couche du saut, par les auteurs allemands.
Elle a été très bien étudiée parM. Richter2, par MM. Hergesell et Langenbeck3, par
M Forel4. Elle correspond à la limite à laquelle se font sentir les actions de
réchauffement et de refroidissement journaliers. Elle est très nettement marquée
surtout en été et en automne, et, en général, elle ne descend pas au-dessous de la
profondeur de 20 mètres.
Toutes les mesures consignées dans les tableaux ci-dessus ont été, sauf au lac de
Genève, prises au-dessus de la plaine centrale, c’est-à-dire dans la région où le lac
est en général le plus profond. Cette remarque est importante à faire. Nous verrons
en effet tout à l’heure que la température n’est pas la même sur toute l’étendue
d’une même couche horizontale; les affluents et surtout les courants peuvent produire
des différences importantes soit dans les températures superficielles, soit
dans les températures profondes; de plus, à la surface, les écarts entre les températures
extrêmes sont, dans le même lac, d’autant plus grands que la profondeur
est plus faible. Toutefois, nous pouvons dire dès à présent que, dans les
petits lacs ou les courants sont peu intenses, la température parait être sensiblement
la même-dans une même couche horizontale, dès qu’on s’éloigne du rivage
et de l’embouchure des affluents; en d’autres termes, les surfaces isothermes sont
à peu près des plans horizontaux. Les deux séries suivantes mettent ce fait en
évidence dans le lac d’Aiguebelette; les deux régions du lac où les mesures ont
été prises sont éloignées d’environ 1300 mètres.
1. M. Ri ch 1er a co n sta té , l e 5 s ep tem b r e 1890, u n e v a r ia tio n d e 6“,7 p ar m è tr e a u W ô r th e r se e (19°, 2
à 10 m è tr e s e t 12°,5 à 11 m è tr e s .).[Richter, d ie Temperaturverhàltnisse d e r A Ipenseen (V erh an d l. des IX.
' Geographentages in Wien, 1891, p . 193).]
2. E,, Richter, loc. cit.
3. I I e r c e s e ll u n d . Langenbeck, d ie Seen d e r Südvogesen (Geogr. Ab h a n d l. (tus d m Geichslanden
E lsass-Lothringen, Heft, I, p . 179, 1892).
4. F. A. F o r e l, le Léman, t. II, p . 364.
2 6 A O U T 1 8 9 1
(a u - des sus d u po in t d e p l u s GRANDE PROFONDEUR.)-- t.,'
27 A O U T 1 8 9 1
(en tr e l e s r u is se a u x d e l a combe e t d u bouvbnt,
PARTIE NORD DU LAC.)
Degrés. Degrés.
S u r f a c e .................................. 20,9 S u r f a c e ................... ... . . 21 2
10 m è tr e s ................................ 9,8-10,3 10 m è tr e s ................................ 9,3
20 — ............................. 4,9 20 — ............................. 4,8
40 — . ........................ 4 ,2 40 — (fond) . . . . , 4 ,2 o
On voit que tous les sondages, à l’exception de celui fait à la profondeur de
10 mètres, accusent des températures à peu près identiques. 11 faut d’ailleurs remarquer
que cette profondeur de 10 mètres correspond à la couche du saut, et nous
avons vu que, dans cette couche, les mesures dé température sont un peu incertaines
à cause de la grande variation thermique qui se manifeste pour une très faible différence
de profondeur. MM. Hergesell et Langenbeck sont d’ailleurs arrivés à des
résultats analogues pour le lac Blanc, sur le versant alsacien des Vosges1.
YV' Causes principales qui déterminent le s températures
de chaque lac.
Plusieurs causes agissent sur la température des lacs. J’étudierai les principales
: /
1 ° CLIMAT
Le climat, qui dépend de la latitude, de l’altitude, de l’exposition, a sur le régime
du lac une influence évidente; suivant que l’air sera plus ou moins chaud, que le
soleil sera plus ou moins ardent, le lac recevra plus ou moins de chaleur. L’influence
de l’altitude est mise en évidence dans les tableaux ci-dessus; on y remarquera
notamment les basses températures superficielles des lacs des Sept-Laux, prises au
coeur de l’été (8¿,S à 13°,2 les 6, 7 et 8 août 1892 et celle du lac d’Estom,
7°,8 le 11 juillet 1894),
2° P R O F O N D E U R M O Y E N N E
La profondeur moyenne d’un lac est le rapport de son volume à sa surface. Son
influence sur la température du lac est assez importante; car, indépendamment de
l’action de la chaleur centrale2, qui est négligeable, et de celle des affluents, qui
1 . H e r g e s e l l u nd L a n g e n b e c k , d ie Seen d e r Südvogesen, p . 173.
2 . D’a p rès des r e ch e r ch e s fa ite s en A n g lete rre (Report or» the r a t e o f in c r e a s e o f u nd e rg rou n d tempera-
tu re , British Asso cia tion , LIId Meeting, S ou th am p ton , 1882, p. 74), c e tte ch a leu r c en tr a le p our ra it
é le v e r d’u n d ix ièm e de d eg ré u n e co u ch e d’e a u d e 4 m è tr e s. C’e s t .u n e q u a n tité in sig n ifia n te .