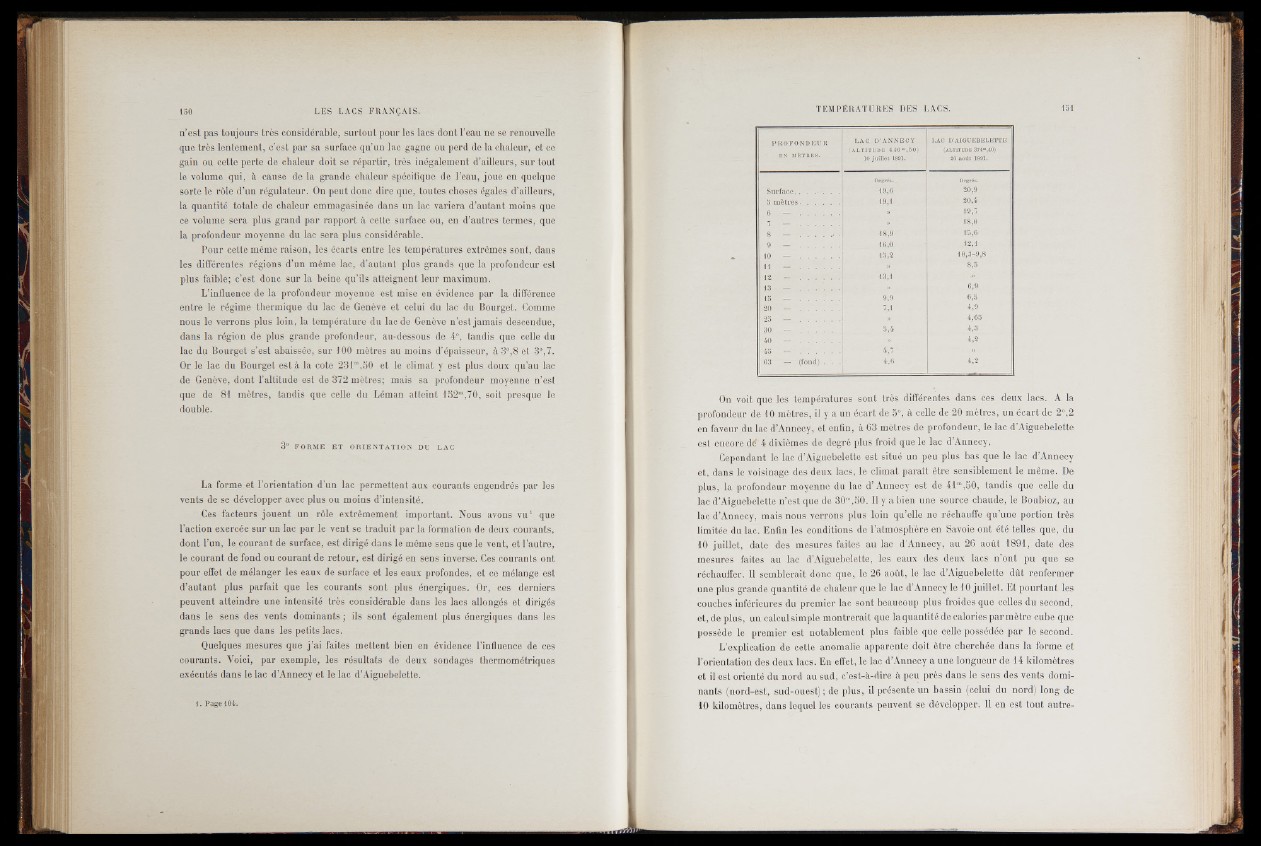
n’est pas toujours très considérable, surtout pour les lacs dont l’eau ne se renouvelle
que très lentement, c’est par sa surface qu’un lac gagne ou perd de la chaleur, et ce
gain ou cette perte de chaleur doit se répartir, très inégalement d’ailleurs, sur tout
le volume qui, à cause de la grande chaleur spécifique de l’eau, joue en quelque
sorte le rôle d’un régulateur. On peut donc dire que, toutes choses égales d’ailleurs,
la quantité totale de chaleur emmagasinée dans un lac variera d’autant moins que
ce volume sera plus grand par rapport à cette surface ou, en d’autres termes, que
la profondeur moyenne du lac sera plus considérable.
Pour cette même raison, les écarts entre les températures extrêmes sont, dans
les différentes régions d’un même lac, d’autant plus grands que la profondeur est
plus faible; c’est donc sur la beine qu’ils atteignent leur maximum.
L’influence de la profondeur moyenne est mise en évidence par la différence
entre le régime thermique du lac de Genève et celui du lac du Bourget. Comme
nous le verrons plus loin, la température du lac de Genève n’est jamais descendue,
dans la région de plus grande profondeur, au-dessous de 4°, tandis que celle du
lac du Bourget s’est abaissée, sur 100 mètres au moins d’épaisseur, à 3°,8 et 3°, 7.
Or le lac du Bourget est à la cote 231“,50 et le climat y est plus doux qu’au lac
de Genève, dont l’altitude est de 372 mètres; mais sa profondeur moyenne n’est
que de 81 mètres, tandis que celle du Léman atteint 152",70, soit presque le
double.
3° FO RME E T O R IE N T A T IO N D U LAC
La forme et l’orientation d’un lac permettent aux courants engendrés par les
vents de se développer avec plus ou moins d’intensité.
Ces facteurs jouent un rôle extrêmement important. Nous avons vu* que
l’action exercée sur un lac par le vent se traduit par la formation de deux courants,
dont l’un, le courant de surface, est dirigé dans le même sens que le vent, et l’autre,
le courant de fond ou courant de retour, est dirigé en sens inverse. Ces courants ont
pour effet de mélanger les eaux de surface et les eaux profondes, et ce mélange est
d’autant plus parfait que les courants sont plus énergiques. Or, ces derniers
peuvent atteindre une intensité très considérable dans les lacs allongés et dirigés
dans le sens des vents dominants ; ils sont également plus énergiques dans les
grands lacs que dans les petits lacs.
Quelques mesures que j ’ai faites mettent bien en évidence l’influence de ces
courants. Voici, par exemple, les résultats de deux sondages thermométriques
exécutés dans le lac d’Annecy et le lac d’Aiguebelette.
1. P a g e 104.
PRO FO N D EU R
EN MÈTRES .
LAC. D’ANNECY
( a l t i t u d e 4 4 6 “ ,5 0 )
10 j u i l l e t 1891.
LAC D’AIGUEBELETTE
( a l t i t u d e 374“ ,40)
2 6 a o û t 1891.
Degrés. _ Degrés.
Surface.. . . - ; . . 19,6 20,9
5 mètres.................... 19,1 | 20,4
6 — .................... H 19,7
7 _ » 18,0
-' 8 — . ^ K 18,9 15,6
9 — .................... 46,0 12,1
10 — .................... 15,2 10,3-9,8
11 — ............ 8,5
12 - . . . . . . 13,1 -»
13 — .................... vW k ï.': 6,9
15 — .................... 9,9 6,5
20 — .................... 7,1 4,9
25 — ................ . » ; H 4,65
30 5,4 4,3
-40 — .................... . », 4 2
45 — .................... 4,7 ’ H H
63 — (fond) . . . 4,6 4,2
On voit que les températures sont très différentes dans ces deux lacs. A la
profondeur de 10 mètres, il y a un écart de 5°, à celle de 20 mètres, un écart de 2°,2
en faveur du lac d’Annecy, et enfin, à 63 mètres de profondeur, le lac d’Aiguebelette
est encore dé 4 dixièmes de degré plus froid que le lac d’Annecy,
Cependant le lac d’Aiguebelette est situé un peu plus bas que le lac d’Annecy
et, dans le voisinage des deux lacs, le climat paraît être sensiblement le même. De
plus, la profondeur moyenne du lac d’Annecy est de 41m,50, tandis que celle du
lac d’Aiguebelette n’est que de 30“,50. Il y a bien une source chaude, le Boubioz, au
lac d’Annecy, mais nous verrons plus loin qu’elle ne réchauffe qu’une portion très
limitée du lac. Enfin les conditions de l’atmosphère en Savoie ont été telles que, du
10 juillet, date des mesures faites au lac d'Annecy, au 26 août 1891, date des
mesures faites au lac d’Aiguebelette, les eaux des deux lacs n’ont pu que se
réchauffer. 11 semblerait donc que, le 26 août, le lac d’Aiguebelette dût renfermer
une plus grande quantité de chaleur que le lac d’Annecy le 10 juillet. Et pourtant les
couches inférieures du premier lac sont beaucoup plus froides que celles du second,
et, de plus, un calcul simple montrerait que la quantité de calories parmètre cube que
possède le premier est notablement plus faible que celle possédée par le second.
L’explication de cette anomalie apparente doit être cherchée dans la forme et
l’orientation des deux lacs. En effet, le lac d’Annecy a une longueur de 14 kilomètres
et il est orienté du nord au sud, c’est-à-dire à peu près dans le sens des vents dominants
(nord-est, sud-ouest); de plus, il présente un bassin (celui du nord) long de
10 kilomètres, dans lequel les courants peuvent se développer. 11 en est tout autre