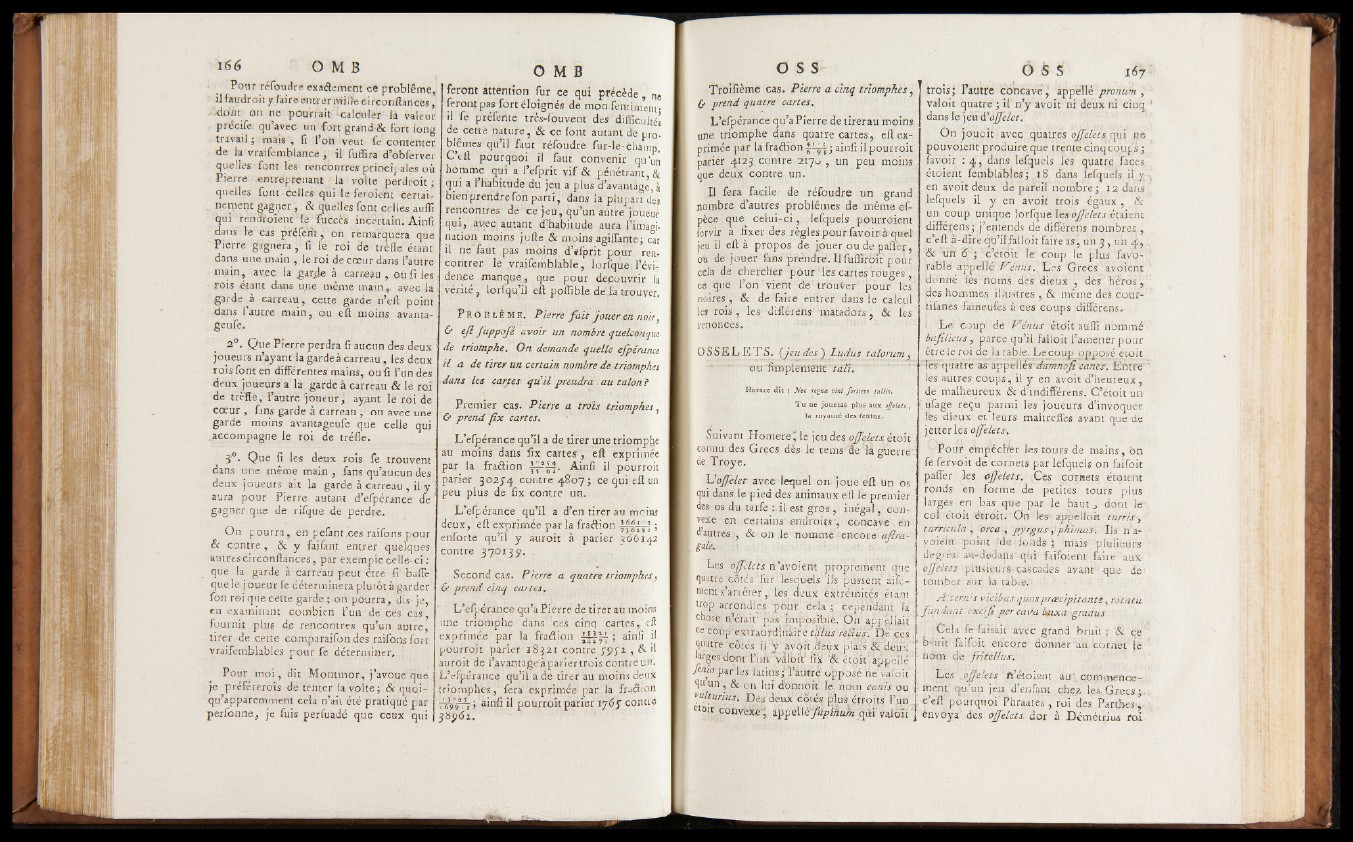
Pour réfoudre exactement ce problème,
il faudroit y faire entrer mille circonftancès,
-dont on ne pourrait calculer la valeur
précife qu’avec un fort grand & fort iong
travail; mais , fî l’on veut le contenter
de la vraifemblance |i il fuffira d’obferver
quelles font les rencontres principales où
Pierre entreprenant la volte perdr-oit ;
quelles font celles qui le feroient certai-
- nement gagner, & quelles font celles auffi
q u i’.fendtoient le fuccè's inüémin. Ainfi
dans le cas préfeiît, on remarquera que
Pierre gagnera, fi le roi ïe trèfle étant
dans une main , le roi de coeur dans l’autre
main, av.ec la garde à carreau , ou fi les :
rois étant dans u.ne même main ,. avec la i
garde i carreau, cette garde n’eft point
dans I autre main, ou efl moins avanta-
geufe,
2°. Que Pierreperdra fi aucun des deux
joueurs n’ayant lagardeàcarreau, les deux
rois font en différentes mains, ou fi l’un des
deux joueurs a la garde à carreau & le roi
de trè'Hè, l’autre joueur, ayant le roi de
coeur , fans garde à carreau , ou avec une
garde moins avantageufe que celle qui
.accompagne le roi de trèfle.
3®- Que fi les deux rots fe trouvent
dans une même main, fans qu’aucun des
deux joueurs ait la garde à carreau , il y i
aura pour Pierre autant d’efpérance de '
gagner que de rifque de perdre.
On pourra, en pefant.ces raifons pour
& contre , & y fajfant entrer quelques
autrescirconflances, par exemple celle-ci ;
que la garde à carreau peut être fi baffe
qu.ele,joueur fe déterminera plutôt à garder !
fon raiqrfe cette garde; on pourra, dis-je,
en examinant combien l’un dé ces cas
fournit plus de rencontres qu’un autre,
tirer de cette çomparaifon des raiforts fort
vraifemblables pour fe déterminer.
Pour moi, dit Montmor, j’avoue que
je préférerois de tenter la volte; & quoi-
qu’apparemment cela n’ait été pratiqué par
perforine, je fuis perfuadé que ceux qui
feront attention fur ce qui précède, ne
feront pas fort éloignés de mon fentimene
il fe préfente très-l'ouvent des difficultés
de^cette nature, & ce font autant de problèmes
qu’il faut réfoudre fur-le-champ.
C’eft pourquoi il faut convenir qu’un
homme qui a l’efprit vif & pénétrant, &
j flui a l’habitude du jeu a plus d’avantage, à
bien prendre fon parti, dans la plupart des
rencontres de ce jeu, qu’un autre joueur
qui, aveu autant d’habitude aura l’imagi-
nation moins julle & moins agiffante; cat
il ne' '.faut 3as moins d’efprit pour rencontrer
le vraifemblable, lorfque l’éviT
! dence manque, que pour découvrir la
' vérité, torl'qu’il eft poiTible de la trouver.
pRO B tïM !. Pierre fait Jaüeren noir,
& efl fuppofé avoir un nombre quelconque
de triomphe. On demande quelle efpéranct
il a de tirer un certain nombre de triompha
dans les cartes qiiil prendra au talon ?
Premier cas. Pierre a trais triomphes,
& prend flx cartes.
L ’efpérance qu’il a de tirer une triomphe
au moins dans fix cartes , eft exprimée
par la fraâion f j r f f . Ainfi il pourroit
parier 30274 contre 4807 ; ce qui eft un
peu plus de fix contre un.
L ’efpérance qu’il a d’en tirer au moins
deux, eft exprimée par la f r a é l i o n ;
enforte qu’il y auroit à parier 366142
contre 37.013p. _
Second cas. Pierre a quatre triomphes,
& prend cinq cartes.
L’efpéfânce qu’a Pierre de tirer au moins
une triomphe dans ces cinq cartes, eft
exprimée par la fradion ; ainfi il
pourroit parier 18321 contre ypyz , & il
auroit de l’avantagea parler trois contre un.
L’efpérance qu’il a de tirer au moins deux
triomphes, fera exprimée’ par la fradion
l'sVsiVï ; ainfi il pourroit parier 1767 comte
38pdi.
Troifième cas. Pierre a cinq triomphes.
(r prend quatre cartes.
L’efpérance qu’a Pierre de tirerau moins
une triomphe dans quatre cartes, eft exprimée
par la fradion ainfi il pourroit
parier 4123 contre 2170 , un peu moins
que deux contre un.
Il fera facile de réfoudre un grand
nombre d’autres problèmes de même ef-
pèce que celui-ci, lefquels pourroient
lervir à fixer des règles pour favoir-à quel
jeu il eft à propos de jouer ou de pafl'eç,
où de jouer fiais prendre'. Il fuftkoir pour
cela de chercher pour les cartes rouges ,
cè que l’on vient de trouver' pour les'
noires , & de faire entrer dans le calcul
les rois , les- différens matadors, & tes
îenonces.- :noi -
O S SE L E T S , (jeudes^ Ludus talorum^
ou tfmp<lentent lait.
Horace dit Nec régna vint Jortiere taliis.
Tu ne joueras plus aux ojjelets, r
la royauté des feftins -
Suivant Homere jj le jeu des ojfelets étoit
connu des Grecs dès le terns âe 'là guerre'
de Troye.
L’ojfelet avec lequel on !joue eft un os
qui dans le pied des animaux efl le premier
des os du tarie t il est gros, inégal ,• convexe
en: certains endroits', concave en
datttres;, & on le'nomme encore aflragale.
r::
■X , l . r -------T’ v
quatre Cotes fur lesquels ils pùssent. âire-
rnent s’arrêterles'deux extréinites-'étant
trop arrondies'pouf j cela ; cependant, la
chos|e n’était' pas împosiblè. On appelffit
| ce Coiip'extraot'dinaire talusrèçius. f)é ces
quatre côtés ii'y ' avûitff'eyx plats ^..iJejux
firges do-nt Tun vtfibiV iîx '& étoit' appelle
Jen.10 parles 'latins;'l’autre opposé né valoit
S ^fun J & on lui d'Onnqit le. nom e-anïs ou
vfllturms. Dès deux côtés plus étroits l’un
etoir convexe-^ Vjf&\è~fûplhum qiii valoit
trois; l’autre concave^ appelle pronum ,
valoit quatre ; il n’y ayoit ni deux ni cinq
dans le jeu àlojjelet.
On jouoit avec quatr.ës ojfllecs qui ne
pouvoient produire que trente cinqcqups ;
favoir : 4 , dans lefquels les quatre faces,
étoient femblables ; 18 dans lefquels il y
en avoir deux de pareil nombre; 12 dans
lefquels il y en avoit trois égaux , &
un coup unique lorfque les ojjelets étaient
différens; j’eptends de différens nombres ,
c’eft a-dire qn’iljfalioit faire as, un 3, un 4 ,
& ufi 6 ’; ; c’étdic le coup le plus favorable^
appelle Prends. Les Grecs1 avoïent
donné ies"nomS dés'dieux , des héros,
des hommes illustres , & même deè cour-
tifanès fameufes à ces coups différens-
Le coup de Vénus éto'it auffi nommé
bafilicus, parce qu’il falloir l’amener pour
être le roi de la table. Lecoup opposé étoit
lëfqûatre as appelles damnofl ennes. Entre'
les autres coups, il y en avoit d’heureux,
de malheureux & d’indifférens. C’étoit un
' ufage reçu parmi les joueurs d’invoquer
lès dieux et leurs maitreffes avant que de
jetter les ojfelets.
Pouf empêcher les tours de mains, on
fe fervoit de cornets par lefquels on faifoit
paffer les ojjelets. Ces cornets étaient
ronds en forme de petites tours plus
largesfen bas que par le haut, dont ier
col étoit étroit. Qn tes1 appelloit turris,
turriculà ; otca ; pyrgiis>\phinms-. Ils n"a*
voieilt point -’de fonds ; mais plufieürs
degrèst a'^dedaiis'-qür faifoieiit faire aux
q^à'eM 'pl'üSieuïS-cascades avant’’ que de-
tomber sur, la tablé;
A'.tem 'S vicibus quosproecipitanté, rotatu
fundutit excifl per cava bftxa gradus
Cela fe faisait avec grand bruit ; & çe
bruit faifoit encore donner'au.cornet îè
riém de fntellus.
Les .ojjelets ft etoient au' commencernent
quiua je-u d’enfant chez leS.Grecs;..
c’efl'pourquoi'Phraates, roi des Parthes v
ènvoya des ojfelets. dût à Démétrius roi