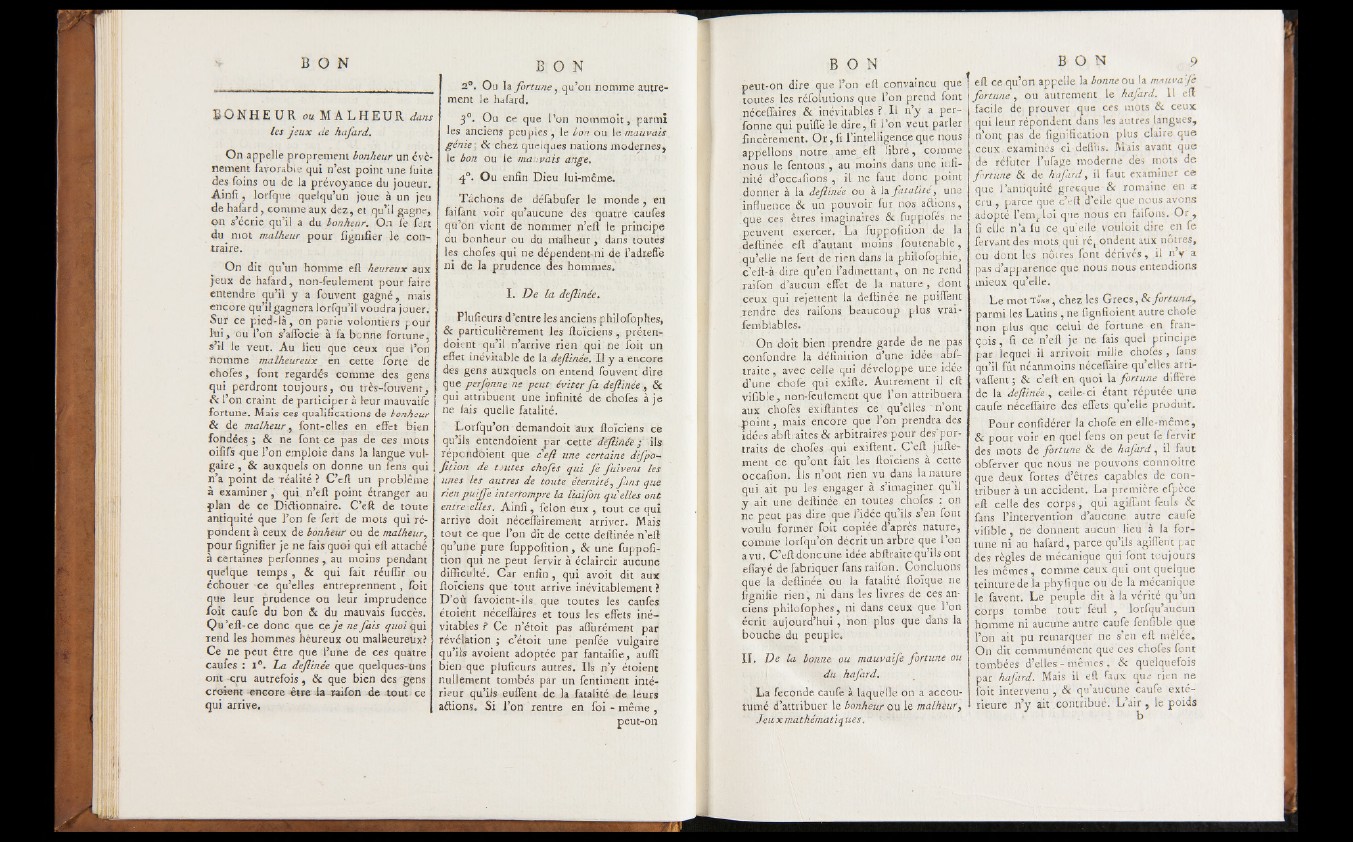
B O N H E U R ou M A L H E U R dans
les jeux de ha fard.
On appelle proprement bonheur un évènement
favorabie qui n’est point une fuite
des foins ou de la prévoyance du joueur.
Ainfi , lorfque quelqu’un joue à un jeu
de hafard, comme aux dez, et qu’il gagne,
on s’écrie qu’il a du bonheur. On fe fort
du mot malheur pour lignifier le contraire.
On dit qu'un homme ell heureux aux
jeux de hafard, non-feulement pour faire
entendre qu’il y a fouvent gagné, mais
encore qu’il gagnera lorfqu’il voudra jouer.
Sur ce pied-là, on parie volontiers pour
lu i, ou l’on s’afTocie à fa bonne fortune,
s’il le veut. Au lieu que ceux que l’on
nomme malheureux en cette forte de
chofes, font regardés comme des gens
qui perdront toujours, ou très-fouvent,
& l’on craint de participer à leur mauvaife
fortune. Mais ces qualifications de bonheur
& de malheur, font-elles en effet bien
fondées; & ne font ce pas de ces mots
oififs que l’on emploie dans la langue Vulgaire
, & auxquels on donne un iens qui
n’a point de ^réalité ? C’eft un problème
à examiner, qui n’efi point étranger au
plan de ce Diftionnaire. C’eft de toute
antiquité que l’on fe fert de mots qui répondent
à ceux de bonheur ou de malheur,
pour lignifier je ne fais quoi qui eft attaché
à certaines perfonnes , au moins pendant
quelque temps , & qui fait réuffir ou
échouer -ce qu’elles entreprennent, foit
que leur prudence ou leur imprudence
foit caufe du bon 8c du mauvais fuccès.
Q u ’eft-ce donc que ce j e ne fais quoi qui
rend les hommes heureux ou malheureux?
Ce ne peut être que l’une de ces quatre
caufes : l° . La deftinée que quelques-uns
ont -cru autrefois, & que bien des gens
croient -encore être la raifon de -tout, ce
qui arrive.
2°. Ou la fortune, qu’on nomme autrement
le hafard.
3°. Ou ce que l ’on nommoit, parmi
les anciens peuples , le Ion ou le mauvais
génie : & chez quelques nations modernes,
le bon ou le mauvais ange,
4°. Ou enfin Dieu lui-même.
Tâchons de défabufer le monde, en
faifant voir qu’aucune des quatre caufes
qu’on vient de nommer n’efl le principe
du bonheur ou du malheur , dans toutes
les chofes qui ne dépendent-ni de l’adreffe
ni de la prudence des hommes.
I. De la dejlinée.
Plusieurs d’entre les anciens philofophes,
& particulièrement les ftoïciens, préten-
doient qu’il n’arrive rien qui ne foit un
effet inévitable de la dejlinée. Il y a encore
des gens auxquels on entend fouvent dire
que perfynne ne peut éviter fa dejlinée, &
qui attribuent une infinité de chofes à je
ne lais quelle fatalité.
Lorfqu’on demandoit aux ffoïciens cô
qu’ils entendoient par c e t te deftinée; ils
report détient que c eft une certaine difp'cr—
fition de toutes ehofes qui fe fuivent les
unes les autres de toute éternité, fans que
rien puijfe intertompre la lïaifon qu'elles ont
entre1,elles. Ainfi, félon eux , tout ce qui
arrive doit néceffairement arriver. Mais
tout ce que l’on dit de cette deftinée n’eft
qu’une pure fuppofîtion, & une fuppofi-
tion qui ne peut feryir à éclaircir aucune
difficulté. Car enfin , qui avoit dit aux
ftoïciens que tout arrive inévitablement ?
D’où favoient-ils que toutes les caufes
étoieitt neceffaires et tous les effets inévitables
? Ce n’étoit pas aflurément par
révélation ; c’étoit une penfée vulgaire
qu’ils avoient adoptée par fantaifie, aulîi
bien que plufieurs autres. Us n’y étoient
nullement tombés par un fentiment intérieur
qu’ils euffent de la fatalité de leurs
aétions. Si l’on rentre en foi - même ,
peut-on
peut-on dire que l’on eft convaincu que
toutes les réfoludons que l’on prend font
néceffaires & inévitables ? Il n’y a per-
fonne qui puiffe le dire, fi l ’on veut parler
fincèrement. O r , fi l’intelligence que nous
appelions notre ame eft libre, comme
nous le fentons , au moins dans une infinité
d’occafions , il ne faut donc point
donner à la dejlinée ou à la fatalité, une
influence 8c un pouvoir fur nos a fiions,
.que ces êtres imaginaires &.fuppofés ne
peuvent exercer. La fuppofition de la
deftinée eft d’autant moins fomenable,
qu’elle ne fert de rien dans la philofophiej
c’eft-à dire qu’en l’admettant, on ne rend
raifon d’aucun effet de la nature , dont
ceux qui rejettent la deftinée ne puiffent
„rendre des raifons beaucoup plus vrai-
femb labiés.
On doit bien prendre garde de ne pas
confondre la définition d’une idée abf-
traite, avec celle qui développe une idee
d’une choie qui exifte. Autrement il eft
vifible, non-feulement que l’on attribuera
aux chofes exiftantes ce qu’elles 'n ’ont
point, mais encore que l’on prendra des
idées abftraites & arbitraires pour des'por-
traits de chofes qui exiftent. C’eft jufte-
ment ce qu’ont fait les ftoïciens à cette
occafion. Ils n’ont rien vu dans la nature
qui ait pu les engager à s’imaginer qu’il
y ait une deftinée en toutes chofes : on
ne peut pas dire que l’idée qu’ils s’en font
voulu former foit copiée d’après nature,
comme iorfqu’on décrit un arbre que l ’on
a vu. C’eft donc une idée abftraite qu’ils ont
effayé de fabriquer fans raifon. Concluons
que la deftinée ou la fatalité floique ne
fignifie rien, ni dans les livres de ces anciens
philofophes, ni dans ceux que l ’on
écrit aujourd’hui , non plus que dans la
bouche du peuple. '
II. De la bonne ou mauvaife fortune ou
du hafard.
La fécondé Caufe à laquelle on a accoutumé
d’attribuer le bonheur ou le malheur,
Jeux mathématiques.
eft ce qu’on appelle la bonne ou la mauvajê
fortune, ou autrement le hafard. 11 eft
facile de prouver que ces mots & ceux
qui leur répondent dans les autres langues,
n’ont pas de lignification plus claire que
ceux examinés ci deffbs. Mais avant que
de réfuter l’ufage moderne des mots de
fortune 8c de hafard, il faut examiner ce
que l ’antiquité grecque 8c romaine en x
cru , parce que c’eft d’eile que nous avons
adopté l’emp loi que nous en faifons. Or ,
fi elle n ’a lu ce. qu elle vouloit dire en fe
fervantdes mots qui répondent aux nôtres,
ou dont les nôtres font dérivés, il n’y a
pas d’apparence que nous nous entendions
mieux qu’elle.
Le mot Toxij, chez les Grecs, 8cfortuna,
parmi les Latins , ne fignfioient autre chofe
non plus que celui de fortune en fran-
çois, fi ce n’eft je ne fais quel principe
par lequel il arrivoit mille chofes, fans
qu’il fût néanmoins néceffaire qu’elles arri-
vaffent ; & c’ eft en quoi la fortune diffère
de la deftinée , celle-ci étant réputée une
caufe néceffaire des effets qu’elle produit.
Pour confidérer la chofe en elle-même,
& pour voir en quel fens on peut fe fervir
des mots de fortune 8c de hafard, il faut
obferver que nous ne pouvons connoître
que deux fortes d’êtres capables de contribuer
à un accident. La première efpèce
eft celle des corps , qui agiffant feuls &
fans l’intervention d’aucune autre caufe
vifible, ne donnent aucun lieu à la fortune
ni au hafard, parce qu’ils agiffent par
des règles de mécanique qui font toujours
les mêmes, comme ceux qui ont quelque
teinture de la phyfique ou de la mécanique
le favent. Le peuple dit à la vérité qu’un
corps tombe tout’ feul , lorfqu’aucun
homme ni aucune autre caufe fenfible que
l’on ait pu remarquer ne s’en eft mélée.
On dit communément que ces chofes font
tombées d’elles - mêmes , & quelquefois
par hafard. Mais il eft faux que rien ne
foit intervenu , & qu'aucune caufe extérieure
n’y ait contribué. L ’air , le poids