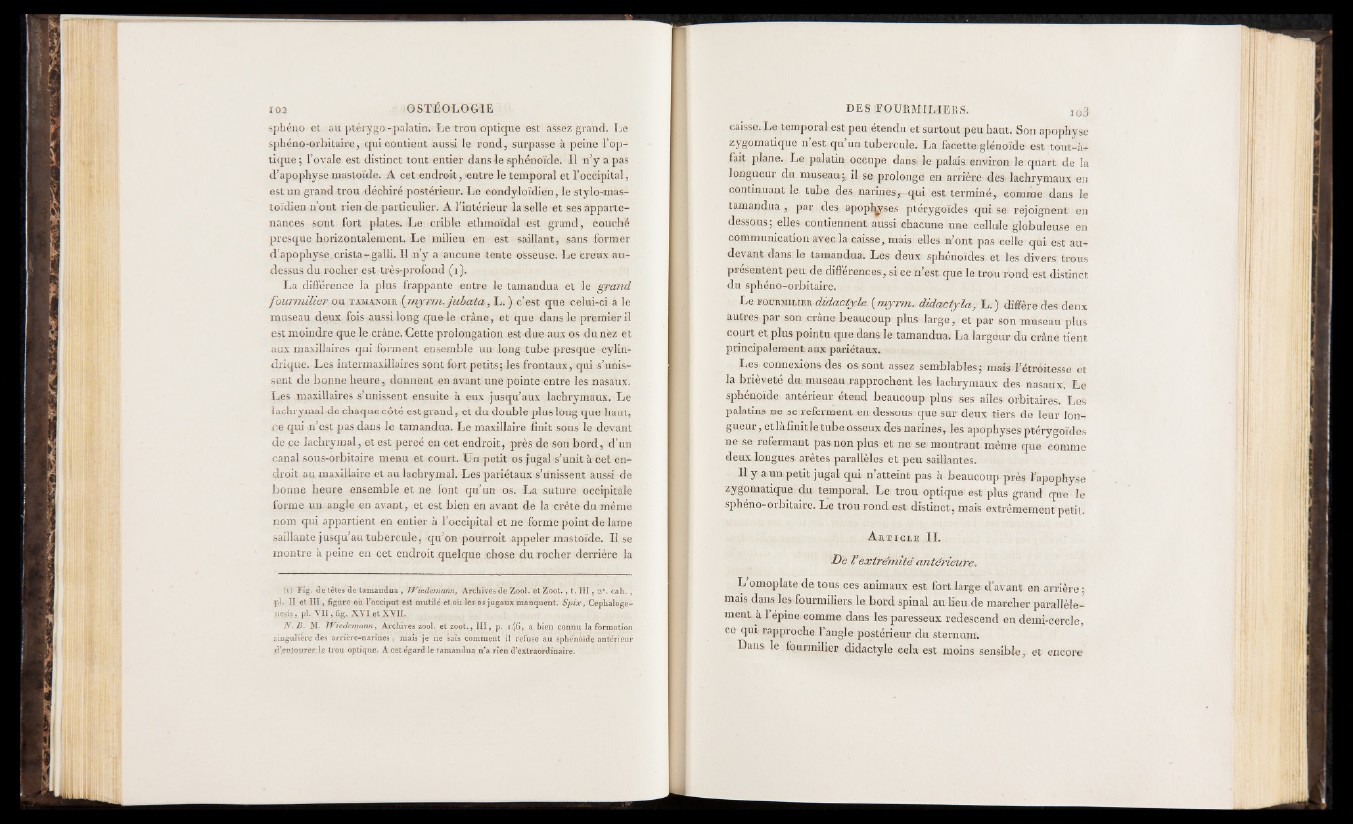
sphéno et au ptérygO r palatin. Le trou optique est assez grand. Le
sphéno-orbitaire, qui contient aussi le rond, surpasse h peine l’optique
; l’ovale est distinct tout entier dans le sphénoïde. Il n’y a pas
d’apophyse mastoïde. A cet endroit, entre le temporal et l’occipital,
est un grand trou déchiré postérieur. Le oondyloïdien, le stylo-mastoïdien
n’ont rien de particulier. A l’intérieur la selle et ses appartenances
sont fort plates. Le crible ethmoïdal est grand, couché
presque horizontalement. Le milieu en est saillant, sans former
d’apophyse.crista-galli. Il n’y a aucune tente osseuse. Le creux au-
dessus du rocher est très-profond (1).
La différence la plus frappante entre le tamandua et le grand
fourm ilier ou tam an oir ( rnyrm.. ju b a ta , L. ) c’est que celui-ci a le
museau deux fois aussi long que le crâne, et que dans le premier il
est moindre que le crâne. Cette prolongation est due aux os du nez et
aux maxillaires qui forment ensemble un long tube presque cylindrique.
Les intermaxillaires sont fort petits; les frontaux, qui s’unissent
de bonne heure, donnent en avant une pointe entre les nasaux.
Les maxillaires s’unissent ensuite à eux jusqu’aux lachrymaux. Le
lachrymal de chaque côté est grand, et du double plus long que haut,
ce qui n’est pas dans le tamandua. Le maxillaire finit sous le devant
de ce lachrymal, et est peroé en cet endroit, près de son bord, d’un
canal sous-orbitaire menu et court. Un petit os jugal s’unit à cet endroit
au maxillaire et au lachrymal. Les pariétaux s’unissent aussi de
bonne heure ensemble et ne font qu’un os. La suture occipitale
forme un angle en avant, et est bien en avant de la crête du même
nom qui appartient en entier à l’occipital et ne forme point de lame
saillante jusqu’au tubercule, qu’on pourroit appeler mastoïde. Il se
montre à peine en cet endroit quelque chose du rocher derrière la
(i) Fig. de têtes de tamandua , Wiedemann, Archives de Zool. et 2$oot.} t. I I I , 2e. eah. ,
pi. II et I I I , figure où l’occiput est mutilé'et où les os jugaux manquent. S p ix , Cephaloge-
nesis, pi. V I I , fig, X V I et XVII.
N. B. M. Wiedemann, Archives zool. et zoot., I I I , p. 146, a bien connu la formation
singulière des arriere-narines ; mais je ne sais comment il refuse au sphénoïde antérieur
d’entourer le trou optique. A cet égard le tamandua n’a rien d’extraordinaire.
caisse. Le temporal est peu étendu et surtout peu haut. Son apophyse
zygomatique n est qu’un tubercule. La facette glénoïde est tout-à-i-
fait plane. Le palatin occupe dans: le palais environ le quart de la
longueur du museau: il se prolonge en arrière des lachrymaux en
continuant le tube des narines jr-qui est terminé, comme dans le
tamandua , par des apoplÿ'ses ptérygoïdes qui se rejoignent en
dessous; elles contiennent aussi chacune une cellule globuleuse en
communication avec:la caisse, mais elles m’ont pas celle qui est au-
devant dans le tamandua. Les deux sphénoïdes et les divers trous
présentent peu de différences., si ee n’est que le trou rond est distinct
du sphéno-orbitaire.
Le. f o u r m il ie r (liductylc ( rnyrm, didactyla, L. ) diffère des deux
autres par son crâne beaucoup plus large, et par son museau plus
court et. plus pointu que. dans le tamandua:. La largeur du crâne tient
principalement aux pariétaux.
Les. connexions des os. sont assez semblables; mais l’étroitesse et
la brièveté du museau rapprochent les lachrymaux des nasaux. Le
sphénoïde: antérieur étend beaucoup plus ses ailes orbitaires: Les
palatins ne se referment en dessous que sur deux tiers de leur longueur
, et là finit le tube osseux des narines, les apophyses ptérygoïdes
ne se refermant pas non plus et 11e se montrant même que comme
deux longues arêtes parallèles et peu saillantes.
■ Il y a.un petit jugal qui n’atteint pas à beaucoup-près l’apophyse
zygomatique du temporal. Le: trou optique est plus grand que le
sphéno-orbitaire. Le trou rond, est distinct, mais extrêmement petit.
A r t i c l e II.
D e l ’extrém ité antérieure.
L ’omoplate de tous ces animaux est fort large, d’avant en arrière ;
mais dans les fourmiliers le bord spinal au lieu de marcher parallèlement
à l’épine: comme dans les paresseux redescend en demi-cercle,
ce qui, rapproche l’angle postérieur du sternum.
Dans le fourmilier didactyle cela est moins sensible, et encore