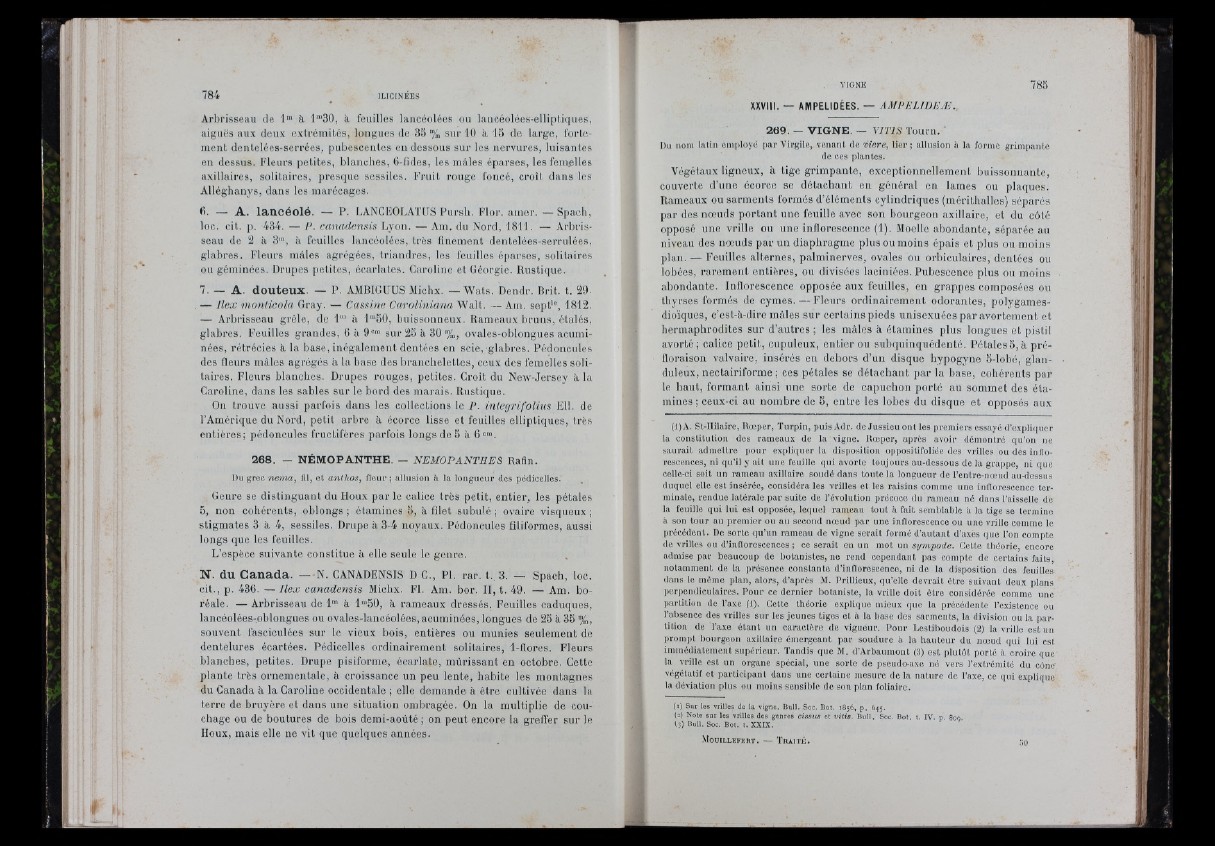
VIGNE
XXVIll. — AWPELIDÉES. — AMPE/JDEÆ.
Arhi'isseau de 1"‘ à 1"'30, à feuilles lancéolées ou laucéoléos-ellipliquos,
aiguës aux deux exlréiniiés, longues de 38 % sur 10 à 18 do large, forte-
meut denleléos-serrées, pubcsecutes eu dessous sur les nervures, luisantes
en (lossns. Fleurs polites, blanelies, (i-iidcs, les mâles éparses, les l'em,elles
axillaires, soliLairos, presque sessiles. Fruil rouge foncé, croit dans les
Allégbaiiys, dans les marécages.
(). — A . lancéolé. — F. bANGIiOl.ATUS Pursb. Flor. amer. — Siiacli,
loc. cit. p. 434. — /'. caïuiiiensis Lyon. — Am. du Nord, 1811. — Arbrisseau
de 2 à 3“ , à feuilles Imioéoloes, irès lincmcut deulclées-seiTuléos,
glalires. Fleurs màlos agrégées, iriandres, les fouilles éparses, solitaires
ou géminées. Drupes petites, écarlates. Caroline el Géorgie. Rustiipic.
7. — A . douteux. — I'. AMBIGUUS Miclix. — Wats. Dendr. Brit. l. 21).
, — Itox moiilicola Gray. — Cassine Caroliniana Wall. — Ain. sept'“, 1812.
— Arbrisseau grèlo, de 1"' à l'"80, buissonneux. Rameaux iiruns, étalés,
glabres. Feuilles grandes, (i à 9 “"' sur 25 à 30 %, ovales-oblongues acuminées,
rélrécies h la base, inégaloiiieul dentées en scie, glabres. Pédoncules
des fleurs mâles agrégés à la base des liranclielcUos, ceux des femelles solitaires.
Fleurs blaiiclics. Drupes rouges, peliles. Croît du New-Jersoy à la
Caroline, dans les sables sur lo bord dos marais. Rustique,
Ou trouve aussi parfois dans les collections lo /'. inleg ri fo liu s Eli. de
l’AinoTiipie du Nord, p e tit arlire à écorce lisse et fouilles elliptiques, très
entières; pédoncules l'ruotifcres parfois longs de 8 à ti“»'.
2 6 8 . — N ÉM O P A N T H E . — N E M O P A N T B E S Ralin.
Ou (,'i'ec n em a , 01, ot a n th o s , llcu r ; a llu sion il la lo n g u eu r des p éd ic elles.
Genre se d istinguant du IIoux pa r lo calice très petit, entier, les pélales
5, non coliérents, oblongs; éiamincs 8, à lilet subulé; ovaire visqueux;
stigmates 3 à 4, sessiles. Drupe à 3-4 noyaux. Pédouculcs ülifornies, aussi
longs que les feuilles.
L’espèce suivante coiisLiluc à elle seule le genre.
N. du Canada. — N. CANADENSIS D C., Pl. ra r. t. 3. — Spaeb, loc.
cit., p, 436. — Hex canadensis Miclix, El. Am. bor, II, t. 49. — Am. boréale.
— Arbrisseau de 1“ à 1"'5Ü, à rameaux dressés. Feuilles caduques,
laneéolées-oblongues ou ovales-lancéolées, acuminées, longues de 25 à 38 %,
souvent fasciculées sur lo vieux liois, entières ou munies seulement do
dentelures écartées, l’édicelles ordinairement solitaires, 1-llores. Fleurs
blancbes, petites. Drupe pisil'orme, écarlate, mûrissant en octobre. Celte
plante très ornementale, à croissance un peu lento, liabite les montagnes
du Canada à la Caroline occidentale ; elle demande à être cultivée dans la
terre de bruyère ot dans une situation ombragée. On la multiplie de cou-
cbage ou de boutures de bois demi-aoûté ; on peut encore la grefl'er sur le
Houx, mais elle ne vit que quelques années.
2 6 9 . ■ V IG N E . ~ V i n s ïo u rn . '
Du nom latin em p lo y é par Virgile, v en an t de v in r e , l ie r ; a llu sion a la forme g rim pante
île CCS plantes.
Végétaux ligneux, à tige grimpante, cxooptionnellemont Iniissonnantc,
couverte d’une écorce se détacliant en général on lames ou plaques.
Rameaux ou sarments formés d’éléments cylindriques (méritliallcs) séparés
par dos noeuds po rtan t une fcuillo avec son bourgeon axillairc, et du côté
opposé une vrille ou une inilorosccnoo (1). Moelle abondanio, séparée au
niveau des noeuds pa r un diaphragme plus ou m oins épais et plus ou moins
plan. — Feuilles alternes, palmincrvos, ovales ou oriiiculairos, déniées ou
lobées, rarement entières, ou divisées laciniées. Pnboacenoe plus ou moins
abondante. Inllorescence opposée aux feuilles, en grappes composées ou
tliyrses formés do cymes. — IHcurs ordinairement odorantes, polygames-
dioïques, c’est-à-dire milles sur oorlains pieds nnisoxuées par avortement et
bermaplirodites sur d ’autres ; les inàlcs à étainiiics plus longues et pistil
avorté; calice petit, cupuleux, entier ou subquinquédonlé, P é la le s8 ,à pré-
lloraison valvaire, insérés on dcliors d’un disque bypogync 8-lobé, glanduleux,
neclairiforme ; ces pétales se détachant par la base, cohérents pur
le liant, formant ainsi une sorte do capuchon porté au sommet des étamines;
ceux-ci au nombre de 5, entre les loiios du disque et opposés aux
(1) A. St-I1ilairc, Itoepcr, T iirpin, p u is Ailr. île Ju ssicu on t les p remiers e ssa y é (rcxpliqiier
la c o n stitu tio u d es ramcau.x de la v ig n e . Itaqicr, après a v o ir d ém on tr é qu ’on ne
saurait adm ettre [lour exp liq u e r la d isp o sitio n opposiLifoliéc d es v r illes ou d es inflo-
re sc en c c s, ni q u ’il y a it une feu ille qu i a v o rte tou jou rs au -d e ssou s de la grappe, ni que
celle-ci so it un rameau a x illa ir e so u d é dans toute la lon gu eu r de l ’cn tre -noe u d au-dessu s
duq uel e lle e s t in s é r é e , c on sid éra le s v r ille s e t les ra is in s com m e u n e irinorcscenco term
ina le, r endue la té ra le i>ar su ite de l’év o lu tion précoce du rameau n é d an s l ’a isse lle de
la fouille qu i lu i e s t op p o sé e , le(|u c l rameau tou t ii fa it s em b lab le ix la lig e s e termin e
à son to u r au p r emier ou au secon d noe u d par une in flo r e sc en c e ou u n e v rille comm e le
pr é c éd en t. De so r te q u ’un rameau de v ig n e s e ra it formé d ’au tan t d ’a x e s q u e l'on comp te
de v r illes ou d ’in flo r e se cn c c s ; ce se ra it en un mot un s ym p o d e . Cette tliéo ric, enco re
adm ise par beau cou p de b o ta n iste s, no rend cep en d an t pas comp te de c e rta in s faits
n o tamm ent de la p r é sen ce c o n s ta n te d ’in flo r e sc en c e , ni de la d isp o sitio n d es feu ille s
dans le mêm e plan, a lo rs, d ’aprôs M. P r illieu x , q u ’e lle d ev ra it êtr e su iv an t deu x plans
p erp en d icu la ir e s. P ou r c e d e rn ier b o ta n iste , la v r ille d o it ê tr e con sid ér é e comm e une
partition de l ’axe (I). Cette th éo rie c.xiiliqno m ieu x q u e la p r é c éd en te l ’ex isten co ou
l’altscncc d es v r illes su r le s j eu n e s tig e s et h la hase d es sa rm en ts, la d iv ision ou la partition
de l’axe é ta n t un ca ra ctère do v igu eu r . Pour Cestilmiidois (2) la v r ille e st un
prompt bourgeon a x illa ir e ém e rg ean t [lar sou d u r e ii la h au teu r du noe u d qu i lu i esl
im m éd ia tem en t su p é r ieu r . T an dis q u e .\I. d’Arbaumont (3) e s t p lu tô t porté à cro ire que
la v rille e s t un organe sp é c ia l, u n e so r te d e pseudo-axe n é v ers Tcxtrémité du cône'
v ég é ta tif e t ])a rticipant dans u n e c e rta in e m esure de la nature de Taxe, ce (iiii explique
la dév ia tion p lu s ou m o in s sen sib le de son pian fo lia ir e .
( 1 ) S u r le s v r i l le s d e la v ig n e . B u l l , S o c . B o t . 18 5 6 , p . 6 4 5 .
(2) N o te s u r le s v r i l le s d e s g e n r e s cissus et vitis. B u l l . S o c . B o t . t, IV . p 800
(3) B ull. Soc. Bot. t. X X IX .
.\roüILLKFFÎlT, — ïnA lT É . .'¡o
ji"