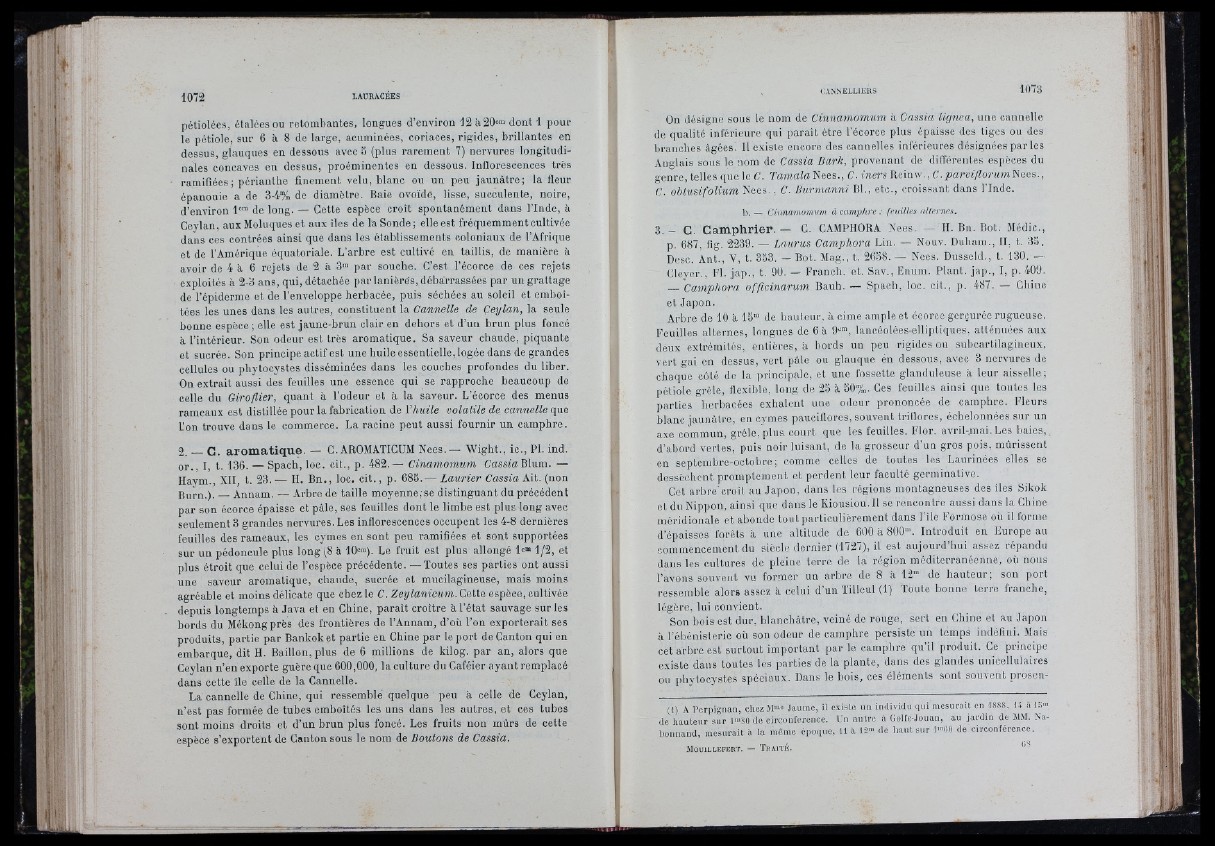
y H
» "
[■ '
i"--
f .
.
1072 LAURACEES
pétiolées, étalées ou retombantes, longues d’environ 12 à20™> dont 1 pour
le pétiole, sur 6 à 8 de large, acuminées, coriaces, rigides, brillantes en
dessus, glauques en dessous avec 8 (plus rarem ent 7) nervures longitudinales
concaves en dessus, proéminentes en dessous. Inflorescences très
ramifiées; périanlbe finement velu, blanc ou un peu jau n â tre ; la fleur
épanouie a de 3-4% de diamètre. Baie ovoïde, lisse, succulente, noire,
d’environ 1”" de long. — Cette espèce croît spontanément dans l’Inde, à
Geylan, aux Moluques et aux îles de la Sonde; elle est fréquemment cultivée
dans ces contrées ainsi que dans les établissements coloniaux de l’Afrique
et de l’Amérique équatoriale. L’arbre est cultivé en taillis, de manière â
avoir de 4 à 6 rejets de 2 à 3™ pa r soucbe. C’est l’écorce de ces rejets
exploités à 2-3 ans, qui, détachée pa r lanières, débarrassées par un grattage
de l’épiderme et de l’enveloppe herbacée, puis séchées au soleil et emboîtées
les unes dans les autres, constituent la Cannelle de Çeylan, la seule
bonne espèce ; elle est jaune-brun clair en dehors et d’un brun plus foncé
à l’intérieur. Son odeur est très aromatique. Sa saveur chaude, piquante
et sucrée. Son principe actif esl une huile essentielle, logée dans de grandes
cellules ou pbytocystcs disséminées dans les couches profondes du liber.
On extrait aussi des feuilles une essence qui se rapproche beaucoup de
celle du Giroflier, quant â l’odeur et à la saveur. L’écorce des menus
rameaux est distillée pour la fabrication de Yhuile volatile de cannelle que
L’on trouve dans le commerce. La racine peut aussi fournir un camphre.
2 , G. a r o m a t i q u e . — C. AROMATIGUM Nees.— Wight., ic.. Pl. ind.
o r ., I, t. 136. — Spach, loo. cit., p. 482.— Cinamomum CassfaBlum. —
Haym., XII, t. 2 3 .— H. Bn., loc. c it., p. 688.— Laurier Cassîa Ait. (non
B u rn .). Annam. — Arbre de taille moyenne, se d istinguant du précédent
par son écorce épaisse et pâle, ses feuilles dont le limbe est plus long avec
seulement 3 grandes nervures. Les inflorescences occupent les 4-8 dernières
feuilles des rameaux, les cymes en sont peu ramifiées et sont supportées
sur un pédoncule plus long (8 à 10™). Le fruit est plus allongé I '" 1/2, et
plus é troit que celui de l’espèce précédente. — Toutes ses parties ont aussi
une saveur aromatique, chaude, sucrée et mucilagineuse, mais moins
agréable et moins délicate que chez le C. Zeylanicuni. Cette espèce, cultivée
depuis longtemps à Java et en Chine, paraît croître à l ’état sauvage sur les
bords du Mékong près des frontières de l’Annam, d ’où l’on exporterait ses
produits, partie pa r Bankoket partie en Chine pa r le po rt de Canton qui en
embarque, dit H. Bâillon, plus de 6 millions de kilog. pa r an, alors que
Geylan n’en exporte guère que 600,000, la culture du Caféier ayant remplacé
dans cette île celle de la Cannelle.
La cannelle de Chine, qui ressemble quelque peu à celle de Geylan,
n ’est pas formée de tubes emboîtés les uns dans les autres, et ces tubes
sont moins droits et d’un brun plus foncé. Les fruits non mûrs de cette
espèce s’exportent de Canton sous le nom de Boutons de Cassia.
LAN.NELLIEHS 1073
On désigne sous le nom de Cinnamomum â Cassia lignea, une cannelle
de qualité inférieure qui paraît être l’éoorce plus épaisse des tiges ou des
lirancbes âgées! Il existe encore des cannelles inférieures désignées p a rle s
Anglais sous le nom de Cassia Bark, provenant de dill'érenles espèces du
genre, telles que lo C. 7’amatoNees., C. inersYicmw.,C.parviflorum,Nees.,
C. o b lu sifo lium Nees.. C. Hunnanni Bi., etc., croissant dans l'Inde.
1). — Cinna tiiom vm à cam p h re : feu ille s u llen ic s.
3 . - C. C a m p h r i e r .— G. CAMPIIORA Nees. - H. Bn. Bot. Médic.,
p. 687. fig. 2239. — Laurus Camphora Lin. — Nouv. Duham., II, t. 38.
Desc. Ant., V, t. 383. — Bot. Mag., t. 2688. — Nees. Dusseld., t. 130. —
Cleyer., Fl. ja p ., t. 90. — Franch. et. Sav., Enum. Plant, jap ., I, p. 409.
— Camphora o ffic in a rum Bauh. — Spach, loc. cit., p. 487. — Cbine
el Japon.
Arbre de lÜ à 18'" de hauteur, à cime ample et écorce gerçurée rugueuse.
Feuilles alternes, longues de 6 â 9™, lancéolées-elliptiques. atténuées aux
deux extrémités, entières, à bords un peu rigides ou subcartilagineux,
vert gai en dessus, vert pâle ou glauque en dessous, avec 3 nervures de
chaque côté de la )irincipale, el une fossette glanduleuse à leur aisselle;
péliole grêle, flexible, long de 28 à 80%. Ces feuilles ainsi que toutes les
parlies berbacées exhalent une odeur prononcée de camphre. Fleurs
blanc jau n â tre , en cymes paucillores, souvent triflores, échelonnées sur un
axe commun, grêle, plus court que les feuilles. Flor. avril-mai. Les liaies,^
d’abord vertes, puis noir luisant, de la grosseur d’un gros pois, mûrissent
en septembre-octobre; comme celles de toutes les Laurinées elles se
dessèchent promptement et perdent leur faculté germinative.
Cet arbre croil au Japon, dans les régions montagneuses des iles Sikok
cl du Nippon, ainsi que dans le Kiousiou. Il se rencontre aussi dans la Chine
méridiouale et abonde tout particulièrement dans l'ile Formose oü il forme
d’épaisses forêts â une altilude de 600 à 800'". In troduit en Europe au
oommencement du siècle dernier (1727), il est aujo u rd ’hui assez répandu
dans les cultures de pleine terre de la région méditerranéenne, où nous
l’avons souvent vu former un arbre de 8 à I2 ‘" de liauteur; sou port
ressemble alors assez à celui d’un Tilleul (1) Toute bonne terre franche,
légère, lui convient.
Son bois est dur. blanchâtre, veiné de rouge, sert en Chine et au Japon
à l’ébénisterie où son odeur de camphre persiste un temps indéfini. Mais
cet arbre est surtout important pa r le camphre qu ’il produit. Ce principe
exisle dans toutes les parties de la plante, dans des glandes unicellulaires
ou phytocystes spéciaux. Dans le bois, ces éléments sont souvent proseu-
(1) A P e rp ign an , chez .launie, il e x is le u n in d iv id u q u i m e su r a il en iSSS, i i à i5">
de h a u le u r su r i"'SO de c ir c o n fé r en c e . Un au tr e à Golfc-Jouan, au ja rd in de JIM. Na-
b on n an d , m esu r a it à la m êm e ép oq u e , l i ii 12'" de hau t su r l»'00 de c ir c o n fé r en c e .
M o u i l l e f e r t . — T r a i t é .
i*
•i|V
11
!r(
I)'’!