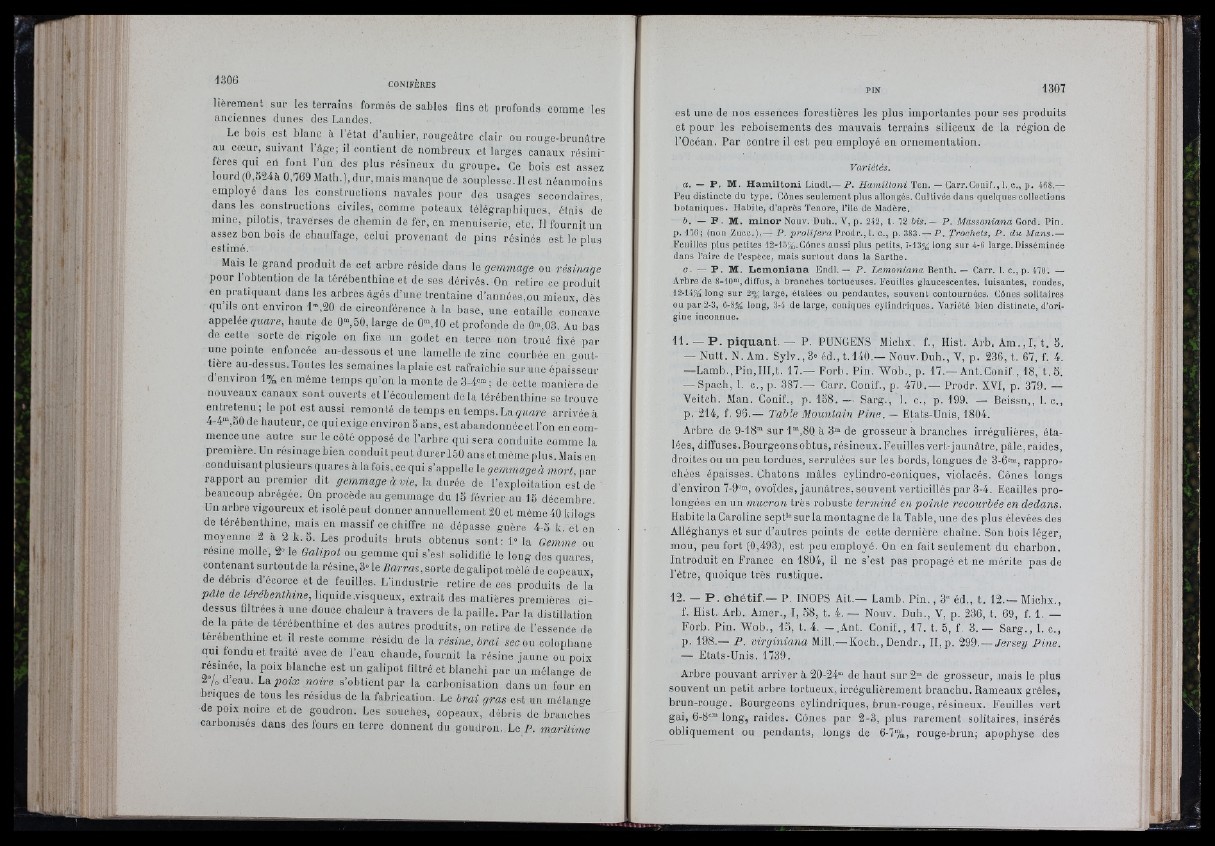
It i:
liëreraent sur les terrains formés de sables Ans ot profonds comme les
anciennes dunes des Landes.
Le bois est blanc à l’état d’aubier, rougeâtre clair ou rouge-brunâtre
au coeur, suivant l’âge; il contient de nombreux et larges canaux ré s inr
fères qui en font l’un des plus résineux du groupe. Ge bois est assez
lourd (0,824à 0,769 Math.), dur, mais manque de souplesse. Il est néanmoins
employé dans les constructions navales pour des usages secondaires,
dans les constructions civiles, comme poteaux télégraphiques, étais de
mine, pilotis, traverses de chemin de fer, en menuiserie, etc. Il fournit un
assez bon bois de chauffage, celui provenant de pins résinés est le plus
estimé.
Mais le grand produit de cet arbre réside dans le gemmage ou résinage
pour l’obtention de la térébenthine et de ses dérivés. On retire ce produit
en pratiquant dans les arbres âgés d’une trentaine d'années,ou mieux dès
qu’ils ont environ 1",20 de circonférence à la base, uue entaille concave
appelée greare, haute de 0",50, large de 0“ ,10 et profonde de 0'",03. Au bas
de cette sorte de rigole on fixe un godet en terre non troué fixé par
une pointe enfoncée au-dessous et une lamelle de zinc courbée en gouttière
au-dessus. Toutes les semaines laplaie est rafraîchie sur une épaisseur
d’environ 1% en même temps qu’on la monte de 3-4™ ; de cette manière de
nouveaux canaux sont ouverts et l’écoulement delà térébenthine se trouve
entretenu; le pot est aussi remonté de temps en temps .Lag«a re arrivée à
4-4",80 de hauteur, ce qui exige environ 8 ans, est abandonnéeet l’on en commence
une autre sur le côté opposé de l’arbre qui sera conduite comme la
première. Un résinage bien conduit peut durer 150 ans et même plus. Mais en
conduisant plusieurs quares à la fois, ce qui s ’appelle le gemmageà mort, par
rapport au premier dit gemmage à vie, \a Aavée de l’exploitation est do
beaucoup abrégée. On procède au gemmage du 18 février au 18 décembre
Un arbre vigoureux et isolé peut donner annuellement 20 et même 40 kilogs
de térébenthine, mais en massif ce chiffre ne dépasse guère 4-3 k. et en
moyenne 2 à 2 k. 8. Les produits bruts obtenus sont: 1“ la Gemme ou
résine molle, 2“ le Galipot ou gemme qui s’est solidilié le long des quares
contenant surtoutde la résine, 3« le frarras, sorte degalipot mêlé de copeaux,’
de débris d’écorce et de feuilles. L'industrie retire de ces produits de fo
p â te de térébenthine, liquide.visqueux, extrait des matières premières ci-
dessus Qltrées à une douce chaleur à travers de 1a paille. Par la distillation
de la pâte de térébenthine et des autres produits, on retire de l’essence de
térebenlhme et il reste comme résidu de 1a résine, brai sec ou colophane
qui fondu et traité avec de l’eau chaude, fournit fo résine jaune ou poix
resinée, la poix blanche est un galipot filtré et blanchi par un mélange de
27 o de au. La p o ix noire s’obtient par la carbonisation dans un four en
briques de tous les résidus de la fabrication. Le brai gras est un mélange
de poix noire et de goudron. Les souches, copeaux, débris de branches
carbonisés dans des fours en terre donnent du goudron. Le P. ma ritime
est une de nos essences forestières les plus importantes pour ses produits
et pour les reboisements des mauvais terrains siliceux de 1a région de
rOcéan. Par contre il est peu employé en ornementation.
V a r i é t é s .
a . — P . M . H a m i l t o n i L i û d l .— P . H a m i l t o n i T e n . — G a r r .C o n i f . , 1. c . , p . 468.—
P e u d i s t i n c t e d u t y p e . C ô n e s s e u l e m e n t p l u s a l l o n g é s . C u l t i v é e d a n s q u e l q u e s c o l l e c t i o n s
b o t a n i q u e s . H a b i l e , d ’a p r è s T e n o r e , Ti le d e M a d è r e .
b . — P . M . m i n o r N o u v . D u h . , V , p . 242, t . 1 2 b i s .— P . M a s s o n i a ^ i a G o r d . P i n .
p . 1 7 6 ; ( n o n Z u c c . ) .— P . p r o l i f é r a P r o d r . , 1. c . , p. 3 8 3 .— P . f r o c h e t s , P . d u M a n s .—
F e u i l l e s p l u s p e t i t e s 1 2 - l o% . C ô n e s a u s s i p l u s p e t i t s , 7-13% l o n g s u r 4-6 l a r g e . D i s s ém i n é e
d a n s P a i r e d e l’e s p è c e , m a i s s u r l o u t d a n s l a S a r l h e .
C- — P . M . L e m o n i a n a E n d l . — P . L e m o m a n a B e n t h . — C a r r . I . e . , p . 47 0 . —
A r b r e d e 8 - 1 0% d i f f u s , à b r a n c h e s t o r t u e u s e s . F e u i l l e s g l a u c e s c e n t e s , l u i s a n t e s , r o n d e s ,
12-14% l o n g s u r 2% l a r g e , é t a l é e s o u p e n d a n t e s , s o u v e n t c o n t o u r n é e s . C ô n e s s o l i t a i r e s
o u p a r 2-3, 6 - 8% l o n g , 3-4 d e l a r g e , c o n i q u e s c y l i n d r i q u e s . V a r i é t é b i e n d i s t i n c t e , d ’o r i g
i n e i n c o n n u e .
1 1 .— p . p i q u a n t . — P. PUNGENS Michx, f., Hist. Arb. Am., I, t. 8.
— Nutt. N. Am. Sylv., 3“ éd., 1.140.— Nouv. Duh., V, p. 236, t. 67, f. 4.
—Lamh., Pin,III,t. 17.— Forb. Pin. Wob., p. 17.— Ant.Conif , 18, t. 8.
— Spach, 1. c., p. 387.— Garr. Conif,, p. 47Ü.— Prodr. XVI, p. 379. —
Veitch. Man. Conif., p. 188. — Sarg., 1. c., p. 199. — Beissn,, 1. c.,
p. 214, f, 96.— Table Mountain Pine. — Etats-Unis, 1804.
Arbre de 9-18" sur 1",80 à 3" de grosseur â branches irrégulières, étalées,
diffuses. Bourgeons obtus, résineux. Feuilles vert-jaunâtre, pâle, raides,
droites ou un peu tordues, serrulées sur les bords, longues de 3-6™, rapprochées
épaisses. Chatons mâles cylindro-coniques, violacés. Cônes longs
d’environ 7-9™, ovoïdes, jaunâtres, souvent verticillés par 3-4. Ecailles prolongées
en un mucron très robuste terminé en p o in te recourbée en dedans.
Habite la Caroline sept" sur la montagne de la Table, une des plus élevées des
Alléghanys et sur d’autres points de cette dernière chaîne. Son bois léger,
mou, peu fort (0,493), est peu employé. On en fait seulement du charbon.
Introduit en France en 1804, il ne s’est pas propagé et ne mérite pas de
l’être, quoique très rustique.
12. — P . c h é t i f .— P. INOPS Ait.— Lamb. P i n . , 3' éd., t. 12.— Michx.,
f. Hist. Arb. Amer., I, 88, t. 4. — Nouv. Duh., V, p. 236, t. 69, f. 1. —
Forb, Pin. Wob., 15, t. 4. — .Ant. Conif., 17. t. 5, f . 3. ■— S a rg . , Le . ,
p. 198.— P . v irg in ia n a Mill.— Koch., Dendr., H, p. T)9.— Jersey P ine.
— Etats-Unis, 1739.
Arbre pouvant arriver à 20-24- de haut sur 2" de grosseur, mais le plus
souvent un petit arbre tortueux, irréguliëreuieiit branchu. Rameaux grêles,
brun-rouge. Bourgeons cylindriques, brun-rouge, résineux. F’euilles vert
gai, 6-8™ long, raides. Cônes par 2-3, plus rarement solitaires, insérés
obliquement ou pendants, longs de 6-7%, rouge-brun; apophyse des