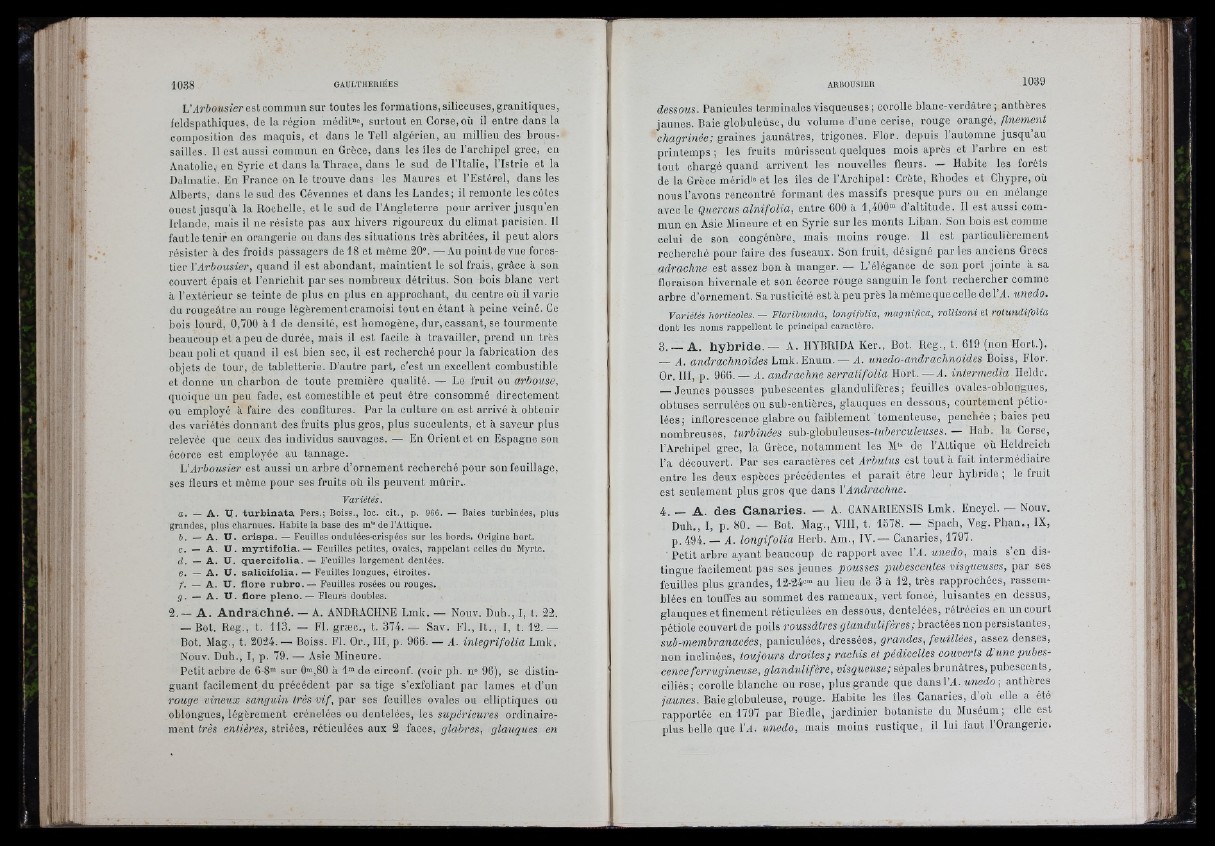
y Ml
h i i
Vi
T : ì
: f . .4
‘ li.
i
i :
I V
L’ArioiiSÎerest commun sur toutes les formations, siliceuses,granitiques,
feldspathiques, de la région médit”«, surtout en Corse, où il entre dans la
composition des maquis, et dans le Tell algérien, au millieu des broussailles.
Il est aussi commun en Grèce, dans les îles de l’arcbipel grec, on
Anatolie, en Syrie et dans la Thrace, dans le sud de l’Italie, l’Islrio et la
Dalmatie. En France on le trouve dans les Maures et l’Estérel, dans les
Alberts, dans le sud des Gévennes et dans les Landes; il remonte les côles
ouest ju sq u ’à la Rochelle, et le sud de l’Angleterre pour arriver ju sq u ’en
Irlande, mais il ne résiste pas aux bivers rigoureux du climat parisien. Il
faut le tenir en orangerie ou dans des situations très abritées, il peut alors
résister à des froids passagers de 18 et même 20°. — Au point de vue forestier
VAt'bousier, quand il est abondant, m aintient le sol frais, grâce à son
couvert épais et l’enrichit p a rs e s nombreux détritus. Son bois blanc vert
à l’extérieur se teinte de plus en plus en approchant, du centre oü il varie
du rougeâtre au rouge légèrement cramoisi tout en é tan t à peine veiné. Ge
bois lourd, 0,700 à l de densité, est homogène, dur, c assant, se tourmente
beaucoup et a peu de durée, mais il est facile à travailler, prend un très
beau poli et quand il esl bien sec, il est recherché pour la fabrication des
objets de tour, de tabletterie. D’autre p a rt, c’est un excellent combustible
et donne un charbon de toute première qualité. — Le fruit ou arbouse,
quoique uu peu fade, est comestible et peut être consommé directement
ou employé à faire des confitures. Par la culture on est arrivé à obtenir
des variétés donnant des fruits plus gros, plus succulents, et à saveur plus
relevée que ceux des individus sauvages. — En Orient et en Espagne sou
écorce est employée au tannage.
VArbousier est aussi un arbre d’ornement recherché pour son feuillage,
ses fleurs et même pour ses fruits où ils peuvent mûrir..
Variétés.
a. — A . t i . tu r b in a ta Pers.; Boiss., loc. cit., p. 966. — Baies turbinées, plus
grandes, plus charnues, liabite la base des de l’Attique.
J). — A. U. crispa. — Feuilles ondulées-crispées sur les bords. Origine hort.
c. — A. U. myrtifolia. — Feuilles petites, ovales, rappelant celles du Myrte.
d. — A. U. quercifolia. — Feuilles largement dentées.
e. — A. tJ. salicifolia. — Feuilles longues, étroites.
f. — A. U. flore rubro. — Feuilles rosées ou rouges.
g. — A. U. flore pleno.— Fleurs doubles.
2 ,— A. And rachn é. — A. ANDRACHNE Lmk. — Nouv. Duh., I, t. 22.
— Bot. Reg., t. 113. — Fl. græc., t. 3 7 4 .— Sav. Fl., I t ., I, t. 1 2 .—
Bot. Mag., t. 2024.— Boiss. Fl. Or., III, p. 966. — yl. in teg rifo lia Lmk,
Nouv. Duh., I, p. 79. — Asie Mineure.
Petit arbre de e-S“ sur 0”',80 à l “ de circonf. (voir ph. n" 96), se distinguant
facilement du précédent pa r sa tige s’exfoliant pa r lames et d’un
rouge v in eu x sanguin très v if, pa r ses feuilles ovales ou elliptiques ou
oblongues, légèrement crénelées ou dentelées, les supérieures ordinairement
très entières, striées, réticulées aux 2 faces, glabres, glauques en
dessous. Panicules terminales visqueuses; corolle blanc-verdâtre; anthères
jaunes. Baie globuleuse, du volume d’une cerise, rouge orangé, finement
chagrinée; graines jau n â tre s, trigones. Flor. depuis l’automne jusqu au
printemps ; les fruits mûrissent quelques mois après et l’arbre en est
to u t chargé quand arrivent les nouvelles fleurs. — Habite les forêts
de la Grèce mérid'« et les îles de l’Archipel : Crète, Rhodes et Chypre, où
nous l’avons rencontré formant des massifs presque purs ou en mélange
avec le Quercus a ln ifo lia , entre 600 à 1,400" d’altitude. Il est aussi commun
en Asie Mineure et en Syrie sur les monts Liban. Son bois est comme
celui de son congénère, mais moins rouge. 11 est particulièrement
recherché pour faire des fuseaux. Son fruit, désigné pa r les anciens Grecs
adrachne est assez bon à manger. — L’élégance de son po rt jointe à sa
floraison hivernale et son écorce rouge sanguin le font rechercher comme
arbre d’ornement. Sa rusticité est à p e u p rè s la même que celle de l’i . unedo.
V a r ié té s h o r tic o le s . — F lo r ib u n d a , lo n g if o lia , m a g n if ic a , r o l l i s o n i e t r o tu n d i f o l i a
d o n t le s n om s r a p p e l le n t le p r in c ip a l c a r a c tè r e .
3. — A . h y b r i d e . — A. HYBRIDA Ker., Bot. Reg., t. 619 (non Hort.).
— A. andrachnoïdes Lmk. Enum. — A. unedo-andrachnoides Boiss, Flor.
Or. III, p. 906. — A. andrachne se rralifolia Hort. — A. intermedia Heldr.
— Jeu n e sp o u ss e s pubescentes glanduliféres; feuilles ovales-oblongues,
obtuses serrulées ou sub-entières, glauques en dessous, courtement pétiolées;
inflorescence glabre ou faiblement tomenteuse, penchée ; baies peu
nombreuses, turbinées sub-globuleuses-tMÙerctifeMses. — Hab. la Gorse,
l’Archipel grec, la Grèce, notamment les M“ de l’Altique où Heldreicb
l’a découvert. Par ses caractères cet Arbutus est to u t à fait intermédiaire
entre les deux espèces précédentes et paraît être leur hybride ; le fruit
est seulement plus gros que dans l'Andi'achne.
4. — A. d e s C a n a r i e s . — A. CANARIENSIS Lmk. Encycl. — Nouv.
Duh., I, p. 80. — Bot. Mag., YIII, t. 1878. — Spach, Veg. P h a n ., IX,
p. 494. — A. lo n g ifo lia Herb. Am., IV .— Canaries, 1797.
Petit arbre ayant beaucoup de rapport avec l’A. unedo, mais s’en distingue
facilement pas ses jeunes pousses pubescentes visqueuses, p a r ses
feuilles plus grandes, 12-24«“ au lieu de 3 à 12, très rapprochées, rassemblées
en touffes au sommet des rameaux, vert foncé, luisantes en dessus,
glauques et finement réticulées en dessous, dentelées, rétrécies en un court
pétiole couvert de poils roussâtres g landuliféres; bractées non persistantes,
sub-membranacées, paniculées, dressées, grandes, feuillées, assez denses,
non inclinées, toujours d roites; racliis el pédicelles couverts d'une pubescence
ferrugineuse, glandulifère, visqueuse; sépales b ru n â tre s, pubescents,
ciliés; corolle blanche ou rose, plus grande que dans l’A. unedo; antbères
jaunes. Baie globuleuse, rouge. Habite les îles Canaries, d où elle a été
rapportée en 1797 pa r Biedle, ja rd in ie r botaniste du Muséum ; elle est
plus belle que l’A. unedo, mais moins ru stique, il lui faut l’Orangerie.
! i