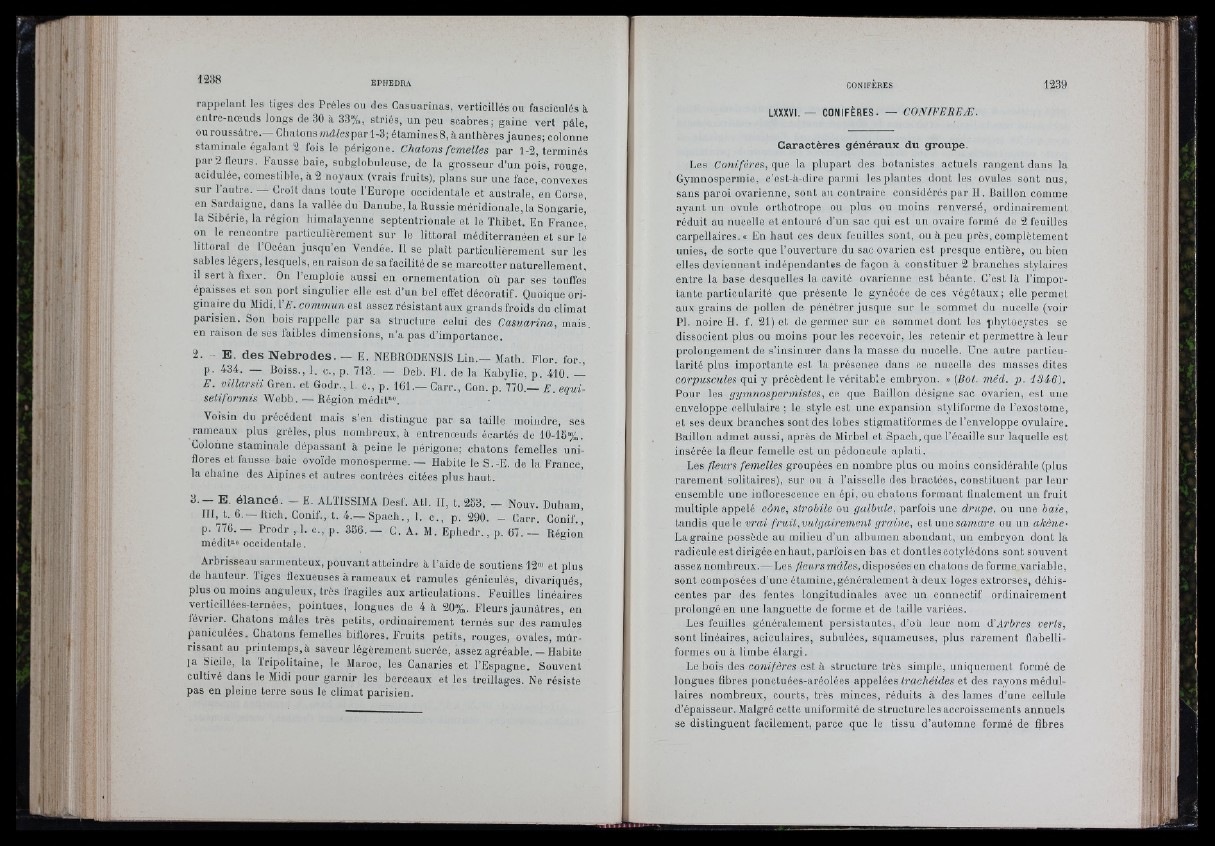
:)
■- Vr
. |!
:I
r'•f'
I i:
IM
i
ij
rappelant les tiges des Prêles ou des Casuarinas. verticillés ou fasciculés à
entre-noeuds longs de 30 à 33%, striés, un peu scabres; gaine vert pâle,
ou roussâtre.— Chatons TOâ/espar 1-3; étaminesS, à anthères jaunes; colonne
staminale égalant “2 fois le périgone. Chatons femelles pa r 1-2, terminés
pa r 2 fleurs. Fausse baie, subglobuleuse, de la grosseur d’un pois, rouge,
acidulée, comestible, à 2 noyaux (vrais fruits), plans sur une face, convexes
sur l’autre. — Croit dans toute l’Europe occidentale et australe, en Gorse,
en Sardaigne, dans la vallée du Danube, la Russie méridionale, la Songarie!
la Sibérie, la région himalayenne septentrionale et le Thibet. En France!
ou le rencontre particulièrement sur le littoral méditerranéen et sur le
littoral de l’Ooéaii ju sq u ’en Vendée. Il se plaît particulièrement sur les
sables légers, lesquels, en raison de sa facilité de se marcotter naturellement,
il sert à fixer. On l’emploie aussi en ornementation où pa r ses touffes
épaisses et son port singulier elle est d’un bel effet décoratif. Quoique originaire
du Midi, l’fr. corewnMM est assez ré sistan t aux grands froids du climat
pa risien. Son bois rappelle pa r sa slruclure celui des Casuarina, mais,
en raison de ses faibles dimensions, n ’a pas d ’importance.
2. E . d e s N e b r o d e s . - E. NEBRODENSIS Lin.— Math. Flor. for.,
p. 434. — Boiss., 1. c., p. 713. — Deb. Fl. de la Kabylie, p . 410. —
fr. villa rsii Gren. et Godr., 1. o., p. 161.— Carr., Con. p. 770.— fr. equi-
se tifo rm is Webb. — Région médit“ .
Voisin du précédent mais s’en distingue par sa taille moindre, ses
rameaux plus grêles, plus nombreux, â entrenoeuds écartés de 10-18%.
Colonne staminale dépassant à peine le périgone; chatons femelles uniflores
et fausse baie ovoïde monosperme. — Habile le S.-E. de la France,
la chaîne des Alpines et autres contrées citées plus hau t.
3 .— E . é l a n c é . - E. ALTISSIMA Desf. Atl. II, t. 283. — Nouv. Duham,
III, t. 6, — Rich. Conif., t. 4.— Sp a ch ., 1. c ., p. 290. - Carr. Conif.!
p. 7 7 6 .— Prodr , 1. c., p. 3 3 6 .— C. A. M. E p h ed r., p. 67. — Bégion
médit“ occidentale.
Arbrisseau sarmenteux, pouvant a tteindre à l’aide de soutiens 12“ et plus
de hauteur. Tiges flexueuses à rameaux et ramules géniculés, divariqués,
plus ou moins anguleux, très fragiles aux a rticulations. Feuilles linéaires
verticillées-ternées, pointues, longues de 4 à 20%. Fleurs jau n â tre s , en
février. Chatons mâles très petits, ordinairement ternés sur des ramules
paniculées. Chatons femelles bitlores. Fruits petits, rouges, ovales, mûr-
rissan t au printemps, à saveur légèrement sucrée, assez agréable. — Habite
la Sicile, la Tripolitaine, le Maroc, les Canaries et l’Espagne. Souvent
cultivé dans le Midi pour g a rn ir les berceaux et les treillages. Ne résiste
pas en pleine terre sous le climat parisien.
LXXXVI. — CONIFÈRES. — CONIFEREÆ.
C a r a c tè r e s g é n é r a u x d u g ro u p e .
Les Conifères, que la plu p art des botanistes actuels rangent dans la
Gymnospermie, c’est-à-dire parmi les plantes dont les ovules sont nus,
sans paroi ovarienne, sont au contraire considérés p a r H. Bâillon comme
ayant un ovule orthotrope ou plus ou moins renversé, ordinairement
réduit au nucelle et entouré d’un sac qui est un ovaire formé de 2 feuilles
carpellaires. « En h aut ces deux feuilles sont, ou à peu près, complètement
unies, de sorte que l’ouverture du sac ovarien est presque entière, ou bien
elles deviennent indépendantes de façon à constituer 2 branches stylaires
entre la base desquelles la cavité ovarienne est béante. G’est là l’importante
particularité que présente le gynécée de ces végétaux; elle permet
aux grains de pollen de pénétrer jusque sur le sommet du nucelle (voir
Pl. noire H. f. 21) et de germer sur ce sommet dont les phytocystes se
dissocient plus ou moins pour les recevoir, les retenir et permettre à leur
prolongement de s’in sin u er dans la masse du nucelle. Une autre p a rticu larité
plus importante est la présence dans ce nucelle des masses dites
corpuscules qui y précèdent le véritable embryon. » [Bot. méd. p . 4346).
Pour les gymnospermistes, ce que Bâillon désigne sac ovarien, est une
enveloppe cellulaire ; le style est une expansion styliforme de l’exostome,
et ses deux branches sont des lobes stigmatiformes de l’enveloppe ovulaire.
Bâillon admet aussi, après de Mlrbel et Spach, que l’écaille su r laquelle est
insérée la fleur femelle est un pédoncule aplati.
Les fleurs femelles groupées en nombre plus ou moins considérable (plus
rarement solitaires), sur ou à l’aisselle des bractées, constituent pa r leur
ensemble une inflorescence en épi, ou chatons formant finalement un fruit
multiple appelé cône, strobile ou galbule, parfois une drupe, ou une baie,
tandis que le vra i fru it, vulg a ir ement graine, eaim ia sama re ou un akène-
La graine possède au milieu d’un albumen abondant, un embryon dont la
ra d ie u le e std irig é e e n h au t,p a rfo ise n bas et donll.esoolylédons sont souvent
assez nombreux.— Les /toHj’Swâ/es.disposéesen chatons de forme variable,
sont composées d’une étamine, généralement à deux loges extrorses, déhiscentes
pa r des fentes longitudinales avec un connectif ordinairement
prolongé en une languette de forme et de taille variées.
Les feuilles généralement persistantes, d’où leur nom A'Arbres verts,
sont linéaires, aciculaires, subulées, squameuses, plus rarement flabelU-
formes ou à limbe élargi.
Le bois des conifères est à structure très simple, uniquement formé de
longues fibres ponctuées-aréolées appelées Irachéides et des rayons médullaires
nombreux, courts, très minces, réduits à des lames d’une cellule
d’épaisseur. Malgré cette uniformité de structure les accroissements annuels
se distinguent facilement, parce que le tissu d’automne formé de fibres