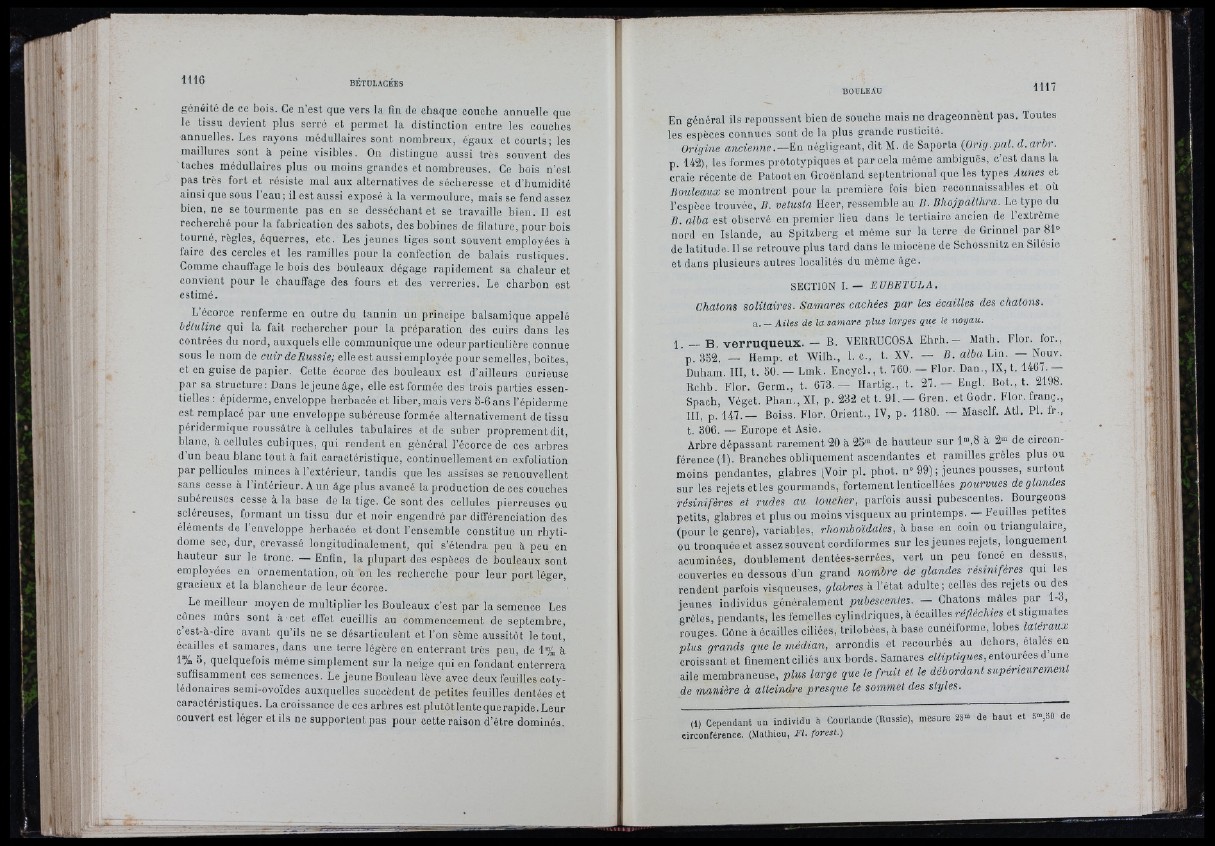
BO U L EA U
Y
1 i r !
génáité de ce bois. Ce ii’est que vers ia fin de cbaque coucbe annueiie que
ie tissu devient plus serré et permet la distinction entre les coucbos
annuelles. Les rayons médullaires sont nombreux, égaux et courls; les
maillures sont à peine visibles. On distingue aussi 1res souvent des
taclies médullaires plus ou moins grandes et nombreuses. Ce bois n ’est
pas très fort et résiste mal aux alternatives de sécberesse et d ’iiumidité
ainsi que sous l’eau; il ost aussi exposé à la vermoulure, mais se fend assez
bien, ne se tourmente pas on se dessécbant et se travaille bien. Il est
recbercbé pour la fabrication des sabots, des bobines de filature, pour bois
tourné, règles, équerres, etc. Les jeu n e s tiges sont souvent employées à
faire des cercles et les ramilles pour la confection de balais rustiques.
Comme cbaullage le bois des bouleaux dégage rapidement sa cbaleur et
convient pour le cbauffage des fours et des verreries. Le cbarbon est
estimé.
L’écorce renferme en outre du tannin un principe balsamique appelé
hétuline qui la fait recbercber pour la p réparation des cuirs dans les
contrées du nord, auxquels elle communique une odeur particulière connue
sous le nom de cuir de Russie; eWt est aussi employée pour semelles, boîtes,
et en guise de papier. Cette écorce des bouleaux est d ’ailleurs curieuse
pa r sa structure: Dans le jeune âge, elle est formée des trois parties essentielles
: épiderme, enveloppe herbacée et liber, mais vers S-6 ans l’épiderme
est remplacé pa r une enveloppe subéreuse formée alternativement de tissu
péridermique roussâtre à cellules tabulaires e id e suber proprement dit,
blanc, à cellules cubiques, qui rendent en général l’écorce de ces arbres
d’un beau blanc tout à fait caractéristique, continuellement en exfoliation
pa r pellicules minces à l’extérieur, tandis que les assises se renouvellent
sans cesse à l’intérieur. A un âge plus avancé la production de ces couches
subéreuses cesse à la base de la tige. Ce sont des cellules pierreuses ou
scléreuses, formant un tissu dur et noir engendré par dilTérenciation des
éléments de 1 enveloppe herbacée et dont l’ensemble constitue un rb y tidome
sec, dur, crevassé longitudinalement, qui s’étendra peu à peu en
h au teu r sur le tronc. — Enfin, la p lupart des espèces de bouleaux sont
employées en ornementation, où on les rechercbo pour leur po rt léger,
gracieux et la blancheur de leur écorce.
Le meilleur moyen de multiplier les Bouleaux c’est par la semence Les
cônes mûrs sont à cet effet cueillis au commencement de septembre,
c est-à-dire avant qu’ils ne se désarticulent et l’on sème aussitôt le tout,
écailles et samares, dans une terre légère en en te rran t très peu, de 1% à
1% 5, quelquefois même simplement sur la neige qui en fondant enterrera
suffisamment ces semences. Le jeune Bouleau lève avec deux feuilles coty-
lédonaires semi-ovoïdes auxquelles succèdent de petites feuilles dentées et
caractéristiques. La croissance de ces arbres est plutôt lente querapide. Leur
couvert est léger et ils ne supportent pas pour cette raison d’être dominés.
En général ils repoussent b len d e souche mais ne drageonnent pas. Toutes
les espèces connues sont de la plus grande rusticité.
Origine an c ien n e.—En négligeant, dit M. de Saporta (Orig.pal. d. arbr.
p. 142), les formes prototypiques et pa r cela même ambiguës, c’est dans la
craie récente de Patoot en Groënland septentrional que les types Aunes et
Bouleaux se montrent pour la première fois bien reconnaissables et oü
l’espèce trouvée, B. vetusta Ileer, ressemble au B. Bhojpallhra. Le type du
B. alba est observé en premier lieu dans le tertiaire ancien de 1 extrême
nord en Islande, au Spilzberg et môme sur la terre de Grinnel par
de latitude. Il se retrouve plus tard dans le miocène de Schossnilz en Silésie
et dans plusieurs autres localités du même âge.
SECTION I. — EOBETULA.
Chatons solitaires. Samares cachées p a r les écailles des chatons,
a . — A i l e s d e la s a m a r e p l u s la rg e s q u e le n o y a u .
1 — B . v e r r u q u e u x . - B. VERRUCOSA E h r h . - Math. Flor. for.,
p. 382. — Hemp, et Wilh,, i .e . , t. XV. - B .a lb a U a . — Nouv.
Duham. Iti, t. 8 0 . - Lmk. Encycl., t. 760. - Flor. Dan,, IX, t. 1 4 6 7 . -
Rchb. Flor. Germ., t. 6 7 3 .— Hartig., t. 2 7 .— Engl. Bot., t. 2198.
Spach, Véget. Phan., XI, p. 232 et t. 91. — Gren. e tG o d r. Flor. franç.,
III, p. 147.— Boiss. Flor. Orient., IV, p . 1180. — Masclf. Atl. Pl. fr.,
t. 306. — Europe et Asie,
Arbre dépassant rarement 20 à 28“ de hauteur sur 1“ ,8 à 2“ de circonférence
(1). Branches obliquement ascendantes et ramilles grêles plus ou
moins pendantes, glabres (Voir pl. phot, n» 99) ; jeunes pousses, surtout
sur les rejets et les gourmands, fortement lenticellées pourvues de glandes
résinifères et rudes au loucher, parfois aussi pubescentes. Bourgeons
petits, glabres et plus ou moins visqueux au printemps. — Feuilles petites
(pour le genre), variables, rhomboïdales, à base on coin ou triangulaire,
ou tronquée et assez souvent cordiformes sur les jeunes rejets, longuemeni
acuminées, doublement dentées-serrées, vert un peu foncé en dessus,
couvertes en dessous d’un grand nombre de glandes résinifères qui les
rendent parfois visqueuses, glabres â l’état adulte; celles des rejets ou des
jeunes individus généralement pubescentes. — Chatons mâles pa r 1-3,
grêles, pendants, lesl'emelles cylindriques, à écailles re/Zec/w'es et stigmates
rouges. Cône à écailles ciliées, trilobées, à base cunéiforme, lobes latéraux
p lu s grands que le médian, arrondis et recourbés au dehors, claies en
croissant et finement ciliés aux bords. Samares ellipliques, entourées, d une
aile membraneuse, p lu s large que le fr u it et le débordant supérieurement
de manière à atteindre presque le sommet des styles.
(1) Cependant un in d iv id u à Courtaude (Russie), m esu r e 28" d e h au t e t b",bO de
c ir c o n fé r en c e . (Mathieu, F l. fo r e s t.)
!:i