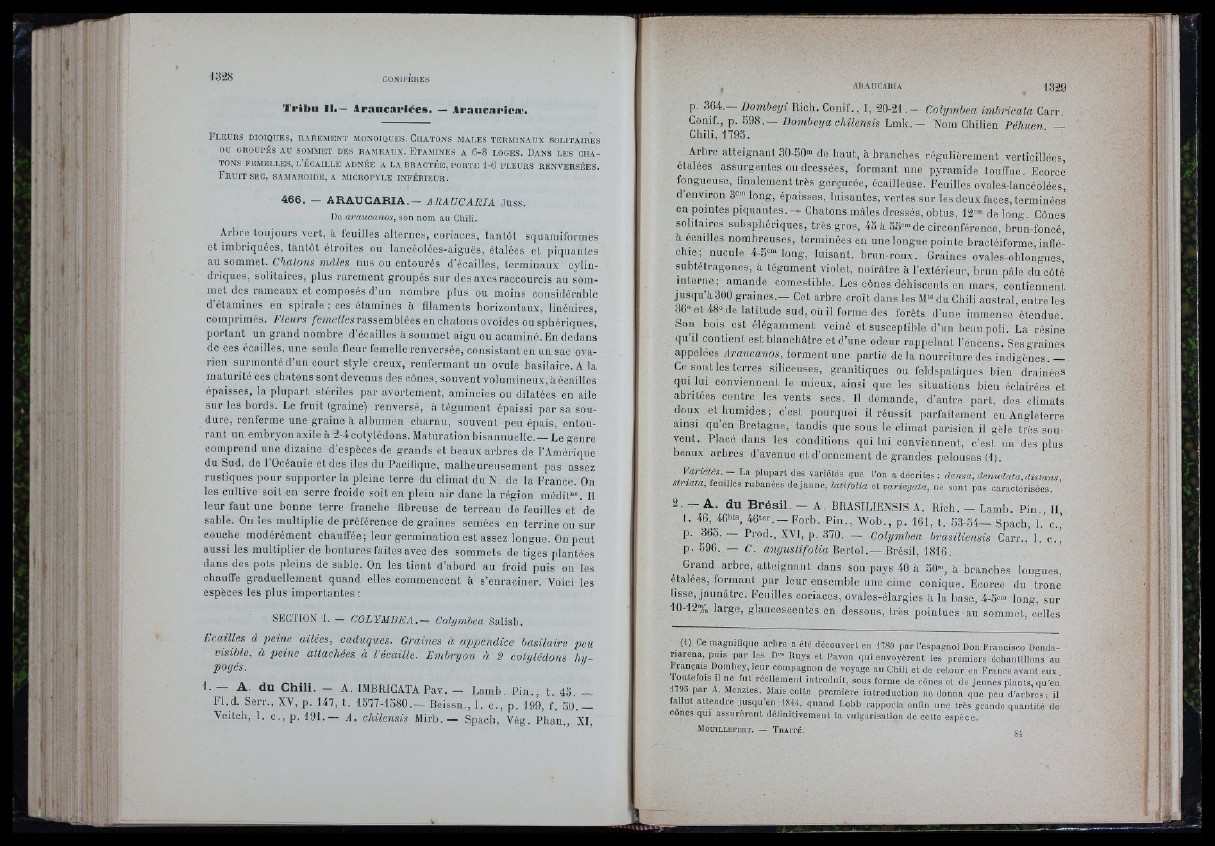
'! i*
f! • i
»Si
i v . . -
. J
J -
. i'.
' j
T I
? ,ï
:i
t l j
T i ' i b i i I I .— A p a i i c a r i c e s . — A iM i i c a r i c a ' .
F l e u r s d i o i q u e s , r a r e m e n t m o n o ï q u e s . C h a t o n s m a l e s t e r m i n a u x s o l i t a i r e s
o u G R O U P É S A U S O M M E T D E S R A M E A U X . E T A M IN E S A 6 - 8 L O G E S . D A N S L E S C H A T
O N S F E M E L L E S , L Ë O A I L L E A D N É E A L A B R A C T É E , P O R T E 1 - 0 F L E U R S R E N V E R S É E S .
F r u i t S E C , s a m a r o ï d e , a m i c r o p y l e i n f é r i e u r .
466. — ARAUCARIA.— ARAUCARIA .luss.
D e a r a u c a r i a s , s o n n o m a u Ch i l i .
Arlii-e toujours vert, à feuilles alternes, coriaces, tantôt squamiformes
et imbriquées, tantôt étroites ou lancéolées-aiguës, étalées et piquantes
au sommet. Chatons mâles nus ou entourés d’écailles, terminaux cvlin-
driques, solitaires, plus rarement groupés sur des axes raccourcis au sommet
des rameaux et composés d’un nombre plus ou moins considérable
d’élamines en spirale ; ces étamines à filaments horizonlaux, linéaires,
comprimés. Fleurs /’eme/ïes rassemblées en chatons ovoïdes ou sphériques,
portant un grand nombre d’écailles à sommet aigu ou acuminé. En dedans
de ces écailles, une seule fleur femelle renversée, consistant en un sac ovarien
surmonté d’un court style creux, renfermant un ovule basilaire. A la
maturité ces chatons sont devenus des cônes, souvent volumineux, à écailles
épaisses, la plupart stériles par avortement, amincies ou dilatées en aile
sur les bords. Le fruit (graine) renversé, à tégument épaissi par sa sou-
dure, renferme une graine à albumen charnu, souvent peu épais, entourant
un embryon axile à 2-4 cotylédons. Maturation bisannuelle.— Le genre
comprend une dizaine d’espèces de grands et beaux arbres de l’Amérique
du Sud, de l’Océanie et des îles du Pacifique, malheureusement pas assez
rustiques pour supporter la pleine terre du climat du N. de la France. On
les cultive soit en serre froide soit en plein air dane la région médit™. Il
leur faut une bonne terre franche fibreuse de terreau de feuilles et de
sable. On les multiplie de préférence de graines semées en terrine ou sur
couche modérément chauffée; leur germination est assez longue. On peut
aussi les multiplier de boutures faites avec des sommets de tiges plantées
dans des pots pleins de sable. On les tient d’abord au froid puis ou les
chauffe graduellement quand elles commencent à s’enraciner. Voici les
espèces les plus importantes :
SECTION I. — COLTMBEA.— Colymbea Salisb.
Ecailles à p eine ailées, caduques. Graines ci appendice basilaire peu
visible, à p eine attachées à l'écaille. Em b ryo n ci S cotylédons h y pogés.
I . — A . d u C h i l i . - A. IMBRICATA Pav. - Lamb. Pin. t 48 —
Fl.d. Serr., XV. p. 147, t. 1877-1580.- Beissn., 1. c . , p. 199, f. 8 ü . -
Veitch, 1. c . , p, 191.— A. chilensis Mirb. — Spach, Vég. Phan., XI,
a r a u c a r i a 1329
p. 3 6 4 . - n om b e y i Rich. Conif., I, 20 -2 1 .- Colymbea imbricata Carr.
Gonif., p. 898.— Dombeya chilensis L m k . - Nom Chilien Péhuen —
Chili, 1798.
Arbre atteignant 30-80™ de haut, à branches régulièrement verticillées,
étalées assurgentes ou dressées, formant une pyramide touffue. Ecorc!
fongueuse, finalement très gerçurée, écailleuse. Feuilles ovales-lancéolées,
d’environ 3“™ long, épaisses, luisantes, vertes sur les deux faces, terminées
en pointes piquantes.— Chatons mâles dressés, obtus, 12““ de long. Cônes
solitaires subsphériques, très gros, 48 à 88“™ de circonférence, brun-foncé,
à écailles nombreuses, terminées en une longue pointe bractéiforme, infléchie;
nucule 4-8“™ long, luisant, brun-roux. Graines ovales-oblongues,
subtétragones, à tégument violet, noirâtre â l’extérieur, brun pâle du côté
interne; amande comestible. Les cônes déhiscents en mars, contiennent
jusqu’àSOO g raines.— Cet arbre croît dans les M" du Chili austral, entre les
36" et 48“ de latitude sud, où il forme des forêts d’une immense étendue.
Son bois est élégamment veiné et susceptible d’un beau poli. La résine
qu il contient est blanchâtre et d’une odeur rappelant l’encens. Ses graines
appelées Araucanos, forment une partie de la nourriture des indigènes. —
Ce sont les terres siliceuses, granitiques ou feldspatiqucs bien drainées
qui lui conviennent le mieux, ainsi que les situations bien éclairées et
abritées contre les vents secs. II demande, d’autre part, des climats
doux et humides; c’est pourquoi il réussit parfaitement eu Angleterre
ainsi qu’en Bretagne, taudis que sous le climat parisien il gèle très souvent.
Placé dans les conditions qui lui conviennent, c’est un des plus
beaux arbre s d’avenue et d’ornement de grandes pelouses (I).
Variétés. — L a p l u p a r t d e s v a r i é t é s q u e l ’o n a d é c r i t e s ; densa, denudata distans
striata, f e u i l l e s r u b a n é e s d e j a u n e , latiTolia eivariegata, n e s o n t p a s c a r a c t é r i s é e s . ’
2. - A . d u B r é s i l . - A. BRASILIENSIS A. Rich. - Lamb. Pin II
t. 46, 40bis, 4 6 t e r ._ F o rb . Pin., Wo b . , p. 161, t. 5 3 -5 4 - Spach, 1. c.,’
p. 368.— Prod., XVI, p. 370. — Colymbea brasiliensis Carr., 1. e . ’,
p. 896. — C. aregres/i/olia Bertol.— Brésil, 1816.
Grand arbre, atteignant dans son pays 40 à 80'”, à branches longues,
étalées, formant par leur ensemble une cime conique. Ecorce du tronc
lisse, jaunâtre. Feuilles coriaces, ovales-élargios à la base, 4-3“™ long, sur
10-12% large, glaucescentes en dessous, très pointues au sommet, celles
( t ) Ce m a g n i f i q u e a r b r e a é t é d é c o u v e r t e n 1780 p a r l ’e s p a g n o l D o n F r a n c i s c o D e n d a -
r i a r e n a , p u i s p a r l e s D™ R i i y s e t P a v o n q u i e n v o y è r e n t l e s p r e m i e r s é c h a n t i l l o n s a u
F r a n ç a i s D o m b e y , l e u r c o m p a g n o n d e v o y a g e a u C h i l i e t d e r e t o u r e n F r a n c e a v a n t e u x
t o u t e f o i s il n e f u t r é e l l e m e n t i n t r o d u i t , s o u s f o rm e d e c ô n e s e t d e j e u n e s p l a n t s , q u ' e n
179» p a r A. M e n z i e s . Ma i s c e t t e p r e m i è r e i n t r o d u c t i o n n e d o n n a q u e p e u d ’a r b r e s ; il
f a l l u t a t t e n d r e j u s q u ’e n 1844, q u a n d L o b b r a p p o r l a e n f i n u n e t r è s g r a n d e q u a n t i t é d e
c ô n e s q u i a s s u r è r e n t d é i i n i t i v e m e n t l a v u l g a r i s a t i o n d e c e t t e e s p è c e .
M o u i l l e f e r t . — T r a i t é . g j