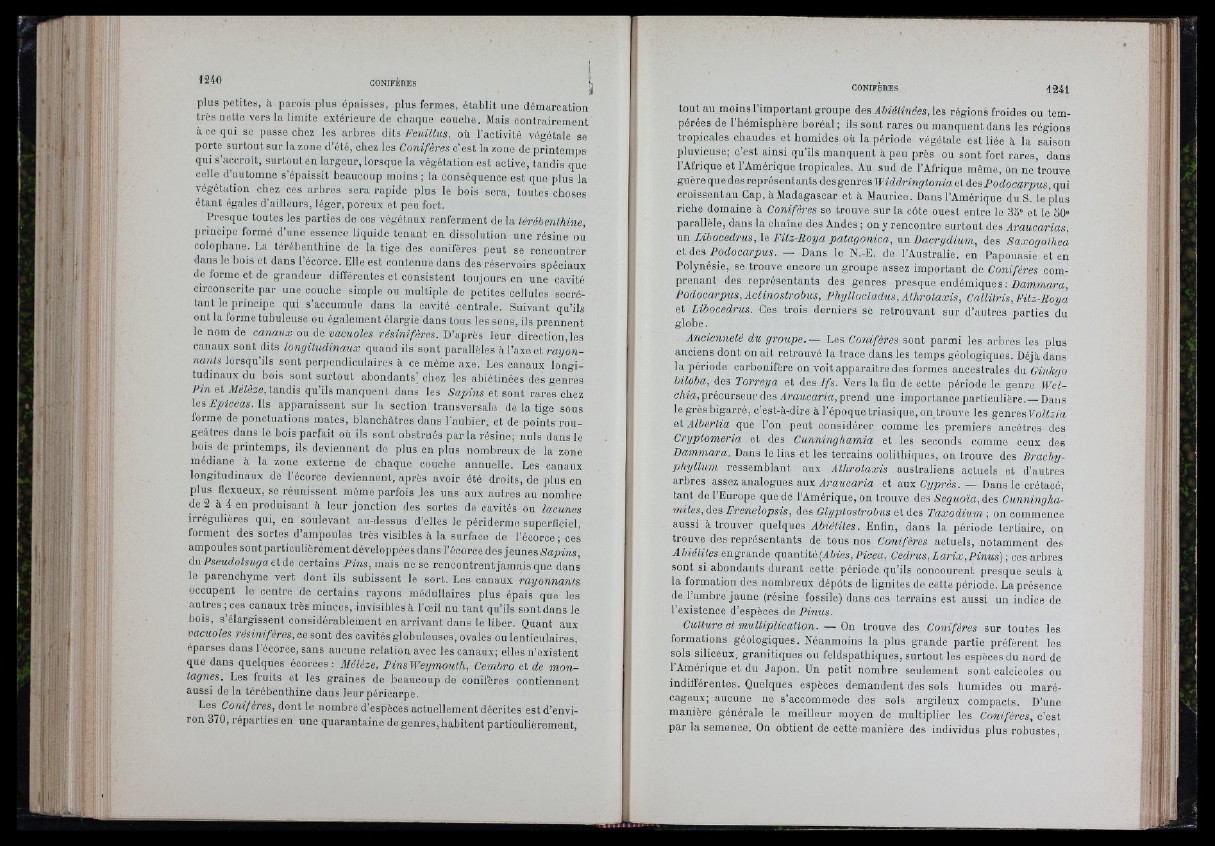
• !'
1240 C O N IF È R E S
plus petites, à parois plus épaisses, plus fermes, établit une dénuircation
très nette vers la limite extérieure de chaque couche. Mais contrairement
à ce qui se passe chez les arbres dits où raotivité végétale se
porte surtout sur la zone d’été, chez les Conifères c’est la zone de printemps
qui s’accroît, surtout en largeur, lorsque la végétation est active, tandis que
celle d’automne s’épaissit beaucoup moins ; la conséquence est que plus la
végétation chez ces arbres sera rapide plus le bois sera, toutes choses
étan t égales d’ailleurs, léger, poreux et peu fort.
Presque toutes les parties de ces végétaux renferment de la térébenthine,
principe formé d’une essence liquide ten an t en dissolution une résine ou
colophane. La térébenthine de la tige des conifères peut se rencontrer
dans le bois et dans l’écoroe. Elle est contenue dans des réservoirs spéciaux
de forme et de grandeur différentes et consistent toujours eu une cavité
circonscrite par une couche simple ou multiple de petites cellules sécrétant
le principe qui s’accumule dans la cavité centrale. Suivant qu ’ils
ont la forme tubuleuse ou également élargie dans tous les sens, ils p rennent
le nom de ca n a u x ou de vacuoles résinifères. D’après leur direction, les
canaux sont dits lo n g itu d in a u x quand ils sont parallèles à l’axe et toî/ow-
nants lorsqu’ils sont perpendiculaires à ce même axe. Les canaux longitudinaux
du bois sont surtout abondants] chez les abiétinées des genres
frire et i f / i t o , tandis qu ’ils manquent dans les frafrfres et sont rares chez
les Epicéas. Ils apparaissent sur la section transversale de la tige sous
forme de ponctuations mates, blanchâtres dans l'aubier, et de points ro u geâtres
dans le bois parfait où ils sont obstrués p a r la résine; nuls dans le
bois de printemps, ils deviennent de plus en plus nombreux de la zone
médiane à la zone externe de chaque couche annuelle. Les canaux
longitudinaux dê l’écorce deviennent, après avoir été droits, de plus en
plus flexueux, se réunissent même parfois les uns aux autres au nombre
de 2 à 4 en produisant à leur jonction des sortes de cavités ou lacunes
irrégulières qui, en soulevant au-dessus d’elles le périderme superfloiel,
forment des sortes d’ampoules très visibles à la surface de l’écorce; ces
ampoules sont particulièrement développées dans l’écorce des jeunes Sa p in s,
ànPseudotsugaelAa certains P ins, mais ne se renco n tren t jamais que dans
le parenchyme vert dont ils subissent le sort. Les canaux rayonnants
occupent le centre de certains rayons médullaires plus épais que les
autres ; ces canaux très minces, invisibles à l’oeil nu tan t qu’ils sont dans le
bois, s’élargissent considérablement en a rrivant dans le liber. Quant aux
vacuoles résinifères, ce sont des cavités globuleuses, ovales ou lenticulaires,
éparses dans l’écorce, sans aucune relation avec les canaux; elles n ’existent
que dans quelques écorces : Mélèze, P in sW eym o u th , Cembro et de m o n tagnes.
Les fruits et les graines de beaucoup de conifères contiennent
aussi de la térébenthine dans leur p éricarpe.
Les Com'/ères, dont le nombre d’espèces actuellement décrites est d ’environ
370, réparties en une q uarantaine de genres, habitent particulièrement.
tout au moins l’important groupe Aaa Abiétinées, \aa régions froides ou tempérées
de l’hémisphère boréal ; ils sont rares ou manquent dans les régions
tropicales chaudes et humides où la période végétale est liée à la saison
pluvieuse; c’est ainsi qu ’ils manquent à peu près ou sont fort rares, dans
l’Afrique et l’Amérique tropicales. Au sud de l’Afrique même, on ne trouve
guère que des représentants des genres Widdringtonia et des Podocarpus, qui
croissent au Gap, à Madagascar et k Maurice. Dans l’Amérique du S. le plus
riche domaine à Conifères se trouve sur la côte ouest entre le 38» et le 50«
parallèle, dans la chaîne des Andes ; on y rencontre su rtout des Araucarias,
un Libocedrus, le Füz-Roya patagónica, un Dacrydium, des Saxogothea
ai Aaa Podocarpus. — Dans le N.-E. de l’Australie, en Papouasie et en
Polynésie, se trouve encore un groupe assez important de Conifères comp
ren an t des rep résentants des genres presque endémiques : frareireiara,
Podocarpus, A ciinostrobus, Phyllocladus, A lhrotaxis, Ca llüris,Fitz-Eoya
et Libocedrus. Ces trois derniers se retrouvant sur d’autres parties du
globe.
Ancienneté du groupe. — Les Conifères sont parmi les arbres les plus
anciens dont on ait retrouvé la trace dans les temps géologiques. Déjà dans
la période carbonifère on voit apparaître des formes ancestrales du Ginkgo
biloba, des Torreya et des Ifs. Vers la fm de cette période le genre Wel-
chia, précurseur des Araucaria, prend une importance particulière.— Dans
le grès b igarré, c’est-à-dire à l’époque triasique, on trouve les genres Vollzia
et Albertia que l’on peut considérer comme les premiers ancêtres des
Cryptomeria et des Cunninghamia et les seconds comme ceux des
Dammara. Dans le lias et les terrains oolithiques, on trouve des Brachy-
p h y llum ressemblant aux A th ro ta x is australiens actuels et d’autres
arbres assez analogues aux Araucaria et aux Cyprès. — Dans le crétacé,
tant de l’Europe q uede l'Amérique, on trouve des Sequoia, Aaa Cunningha-
mites,Aea Frenelopsis, des Glyptostrobus et des T a xo d ium ; on commence
aussi à trouver quelques Abiétites. Enfin, dans la période tertiaire, on
trouve des représentants de tous nos Conifères actuels, notamment des
Abiétites engrande quantité(Aôfos, Picea, C ed ru s,La rix ,P in u s) ; ces arbres
sont si abondants duran t cette période qu’ils concourent presque seuls à
la formation des nombreux dépôts de lignites de cette période. La présence
de l’ambre jau n e (résine fossile) dans ces terra in s est aussi un indice de
l’existence d’espèces de Pinus.
Culture et mu ltip lica tio n . — Qa trouve des Conifères sur toutes les
formations géologiques. Néanmoins la plus grande partie préfèrent les
sols siliceux, granitiques ou feldspathiques, su rto u t les espèces du nord de
1 Amérique et du Japon, ü n petit nombre seulement sont caloicoles ou
indifférentes. Quelques espèces demandent des sols humides ou m aré cageux;
aucune ne s ’accommode des sols argileux compacts. D’une
manière générale le meilleur moyen de multiplier les Conifères, c’est
pa r la semence. On o btient de cette manière des individus plus robustes.