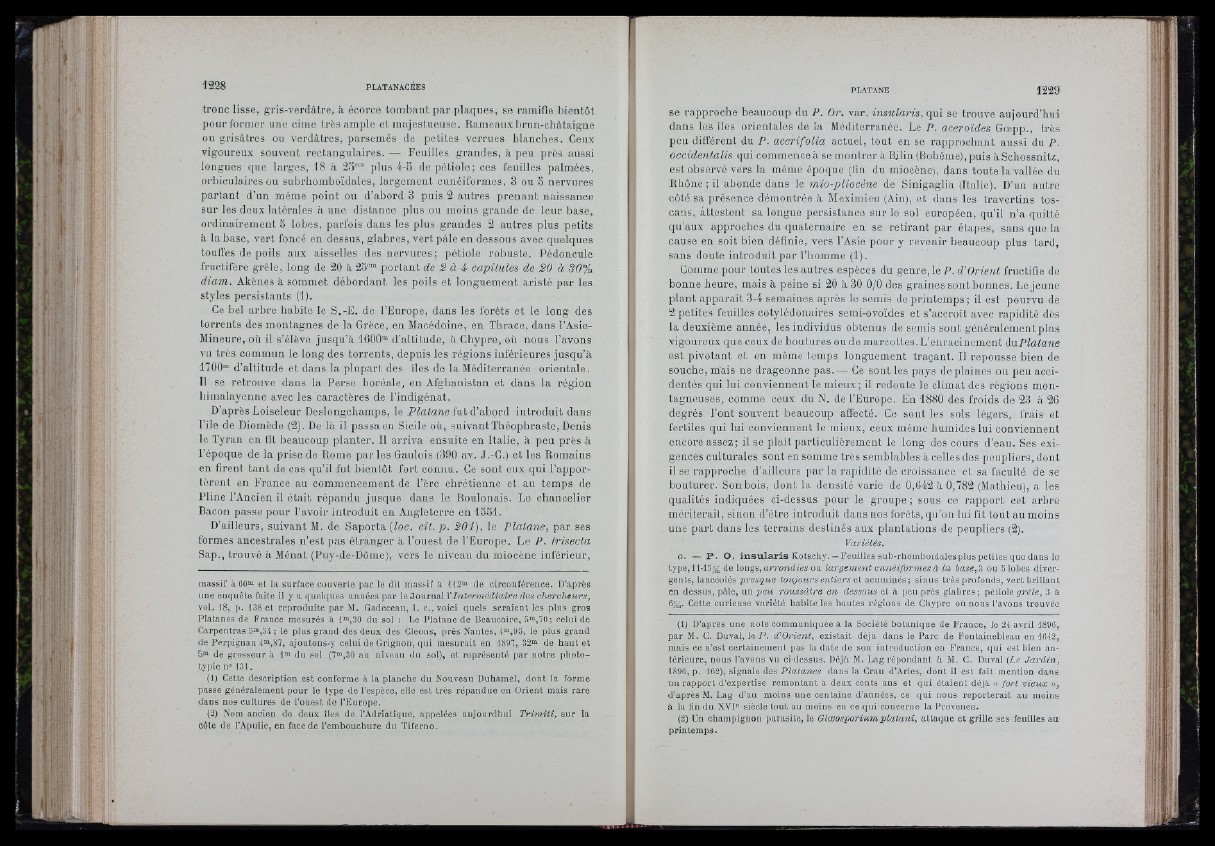
• y
:|t
s
^ < f ] ,
t .
I . - :
i i i
ii!
is ! i
i t
tronc lisse, gris-verdâtre, â écorce tombant pa r plaques, se rnmifie bientôt
pour former une cime très ample et majestueuse. Rameaux brun-châtaigne
ou grisâtres ou verdâtres, parsemés de petites verrues blanches. Ceux
vigoureux souvent rectangulaires. — Feuilles grandes, à peu près aussi
longues que larges, 18 à Îo “" plus 4-8 de pétiole; ces feuilles palmées,
orbiculaires ou subrhomboïdales, largement cunéiformes, 3 ou 8 nervures
p a rta n t d ’im même point ou d’abord 3 puis 2 autres p ren an t naissance
sur les deux latérales à une distance plus ou moins grande de leur base,
ordinairement 8 lobes, parfois dans les plus grandes 2 autres plus petits
â la base, vert foncé en dessus, glabres, vert pâle en dessous avec quelques
touffes de poils aux aisselles des nervures; pétiole robuste. Pédoncule
fructifère grêle, long de 20 à 28™ po rtan t de S à 4 capitules de SO ci 80%
d iam . Akènes à sommet débordant les poils et longuement aristé pa r les
styles persistants (1).
Ce bel arbre habite le S.-E. de l’Europe, dans les forêts et le long des
to rren ts des montagnes de la Grèce, en Macédoine, en Thrace, dans l’Asie-
Mineure, où il s’élève ju sq u ’à 1600™ d’altitude, à Chypre, où nous l'avons
vu très commun le long des to rren ts, depuis les régions inférieures ju sq u ’à
1700" d’altitude et dans la plupart des îles de la Méditerranée orientale.
Il se retrouve dans la Perse boréale, en Afghanistan et dans la région
himalayenne avec les caractères de l’indigénat.
D’après Loiseleur Deslongchamps, le Ætotoree fut d ’abord in troduit dans
l’ile de Diomède (2). De là il passa en Sicile où, suivant Théophraste, Denis
le Tyran en fit beaucoup planter. Il arriva ensuite en Italie, à peu près à
l ’époque de la prise de .Rome p a rle s Gaulois (390 av. J.-G.) et les Romains
en firent tan t de cas qu’il fut bientôt fort connu. Ce sont eux qui l’apportèren
t en France au commencement de l’ère chrétienne et au temps do
Pline l’Ancien il é tait répandu jusque dans le Boulonais. Le chancelier
Bacon passe pour l’avoir introduit en Angleterre en 1851.
D’ailleurs, suivant M. de Saporta (¿oc. cit. p . SOI), le Platane, pa r ses
formes ancestrales n’est pas étran g er à l’ouest de l’Europe. Le P. trisecta
Sap., trouvé à Ménat (Puy-de-Dôme), vers le niveau du miocène inférieur,
m a s s i f à 6 0 " e t l a s u r f a c e c o u v e r t e p a r l e d i t m a s s i f à 1 1 2 " d e c i r c o n f é r e n c e . D ’a p r è s
u n e e n q u ê t e f a i t e i l y a q u e l q u e s a n n é e s p a r l e l o a r a a W I n t e r m é d i a i r e d e s c h e r c h e u r s ,
v o l . 18, p . 138 e t r e p r o d u i t e p a r M . G a d e c e a u , 1. c . , v o i c i q u e l s s e r a i e n t l e s p l u s g r o s
P l a t a n e s d e F r a n c e m e s u r é s à 1 " ,3 0 d u s o l : L e P l a t a n e d e B e a u c a i r e , 6 " , 7 0 ; c e l u i d e
C a r p e n t r a s 3 " ,5 4 ; l e p l u s g r a n d d e s d e u x d e s C le o n s , p r è s N a n t e s , 4 " ,9 5 , l e p l u s g r a n d
d e P e r p i g n a n 4 " ,8 7 , a j o u t o n s - y c e l u i d e G r ig n o n , q u i m e s u r a i t e n 1 8 9 7 , 3 2 " d e h a u t e t
5 " d e g r o s s e u r à i " d u s o l ( 7 " ,3 0 a u n i v e a u d u s o l ) , e t r e p r é s e n t é p a r n o t r e p h o t o t
y p i e n " 1 3 1 .
(1) C e t t e d e s c r i p t i o n e s t c o n f o rm e à l a p l a n c h e d u N o u v e a u D u h a m e l , d o n t l a f o rm e
p a s s e g é n é r a l e m e n t p o u r l e t y p e d e l ’e s p è c e , e l l e e s t t r è s r é p a n d u e e n O r i e n t m a i s r a r e
d a n s n o s c u l t u r e s d e l’o u e s t d e l ’E u r o p e .
(2) N om a n c i e n d e d e u x î l e s d e l ’A d r i a ü q n e , a p p e l é e s a u j o u r d h u i T r i m i t i , s u r l a
c ô t e d e l ’A p u l i e , e n f a c e d e l ’e m b o u c h u r e d u T i f e r n o .
se rapproche beaucoup du P. Or. var. insu la ris, qui se trouve aujourd’hui
dans les îles orientales de la Méditerranée. Le P. aceroïdes Goepp., très
peu différent du P. acerifolia actuel, tout en se rapprochant aussi du P.
occidentalis qui commence à se montrer à Bilin (Bohême), puis à Schossnitz,
est observé vers la même époque (fin du miocène), dans toute la vallée du
Rhône; il abonde dans le mio-pliocène de Sinigaglia (Italie). D’un autre
côté sa présence démontrée à Meximieu (Ain), et dans les travertins toscans,
attestent sa longue persistance sur le sol européen, qu’il n ’a quitté
q u ’aux approches du quaternaire en se re tiran t par étapes, sans que la
cause en soit bien définie, vers l’Asie pour y revenir beaucoup plus tard,
sans doute in troduit pa r l’homme (1).
Comme pour toutes les autres espèces du genre, le P. d ’Orient fructifie de
bonne heure, mais à peine si 20 à 30 0/0 des graines sont bonnes. Le jeune
plan t apparaît 3-4 semaines après le semis de p rin tem p s; il est pourvu de
2 petites feuilles cotylédonaires semi-ovoïdes et s’accroît avee rapidité dès
la deuxième année, les individus obtenus de semis sont généralement plus
vigoureux que ceux de boutures ou de marcottes. L’enracinement ànPlatane
est pivotant et en même temps longuement traçant. Il repousse bien de
souche, mais ue drageonne p a s .— Ce sont les pays de plaines ou peu accidentés
qui lui conviennent le mieux; il redoute le climat des régions montagneuses,
comme ceux du N. de l’Europe. En 1880 des froids de 23 à 26
degrés l’ont souvent beaucoup affecté. Ge sont les sols légers, frais et
fertiles qui lui conviennent le mieux, ceux même humides lui conviennent
encore assez ; il se plaît particulièrement le long des cours d ’eau. Ses exigences
culturales sont en somme très semblables à celles des peupliers, dont
il se rapproche d’ailleurs par la rapidité de croissance et sa faculté de se
bouturer. Sonbois, dont la densité varie de ü,642 à 0,782 (Mathieu), a les
qualités indiquées ci-dessus pour le groupe ; sous ce rap p o rt cet arbre
mériterail, sinon d’être introduit dans nos forêts, qu’on lui fît tout au moins
une p a rt dans les terra in s destinés aux plantations de peupliers (2).
V a r i é t é s .
a . — P . O . i n s u l a r i s K o ts ch y .— FeuiUes su b -rlîom b o ïd a le sp lu s p e tite s q u e d an s le
ty p e ,1 1 -15% de \ o n % s ,,a r r o n d i e s o n l a r g e m e n t c u n é i f o r m e s à l a b a s e ,2 ou Slobes d iv e rgents,
lancéolés - p r e s q u e t o u j o u r s e n t i e r s e t a c um in é s ; sin u s trè s p ro fo n d s, v e r t b rilla n t
en d e ssu s, p àle, un p e u r o u s s â t r e e n d e s s o u s e t à peu p rès glab res ; pétiole g r ê l e , 3 à
6%. Cette cu rieu s e v a rié té h ab ite les h au te s régions de Chypre où nous l’avons tro u v é e
(1) D ’a p r è s u n e n o t e c o m m u n i q u é e à l a S o c i é t é b o t a n i q u e d e F r a n c e , le 24 a v r i l 1896,
p a r M . G. D u v a l , l e / G d ' O r i e n t , e x i s t a i t d é j à d a n s le P a r c d e F o n t a i n e b l e a u e n 1642,
m a i s c e n ’e s t c e r t a i n e m e n t p a s l a d a t e d e s o n i n t r o d u c t i o n e n F r a n c e , q u i e s t b i e n a n t
é r i e u r e , n o u s l ’a v o n s v u c i - d e s s u s . D é j à M . L a g r é p o n d a n t à M . C . D iiv a l { L e J a r d i n ,
1 8 9 6 , p . 1 6 2 ), s i g n a l e d e s P l a t a n e s d a n s l a C r a u d ’A r l e s , d o n t il e s t f a i t m e n t i o n d a n s
u n r a p p o r t d ’e x p e r t i s e r e m o n t a n t à d e u x c e n t s a n s e t q u i é t a i e n t d é j à <c f o r t v i e u x » ,
d ’a p r è s M. L a g d ’a u m o i n s u n e c e n t a i n e d ’a n n é e s , c e q u i n o u s r e p o r t e r a i t a u m o i n s
à l a f in d u X V I ° s i è c l e t o u t a u m o i n s e n c e q u i c o n c e r n e l a P r o v e n c e .
(2) U n c h a m p ig n o n p a r a s i t e , l e G l oe o s p o r i u m p l a t a n i , a t t a q u e e t g r i l l e s e s f e u i l l e s a u
p r i n t e m p s .