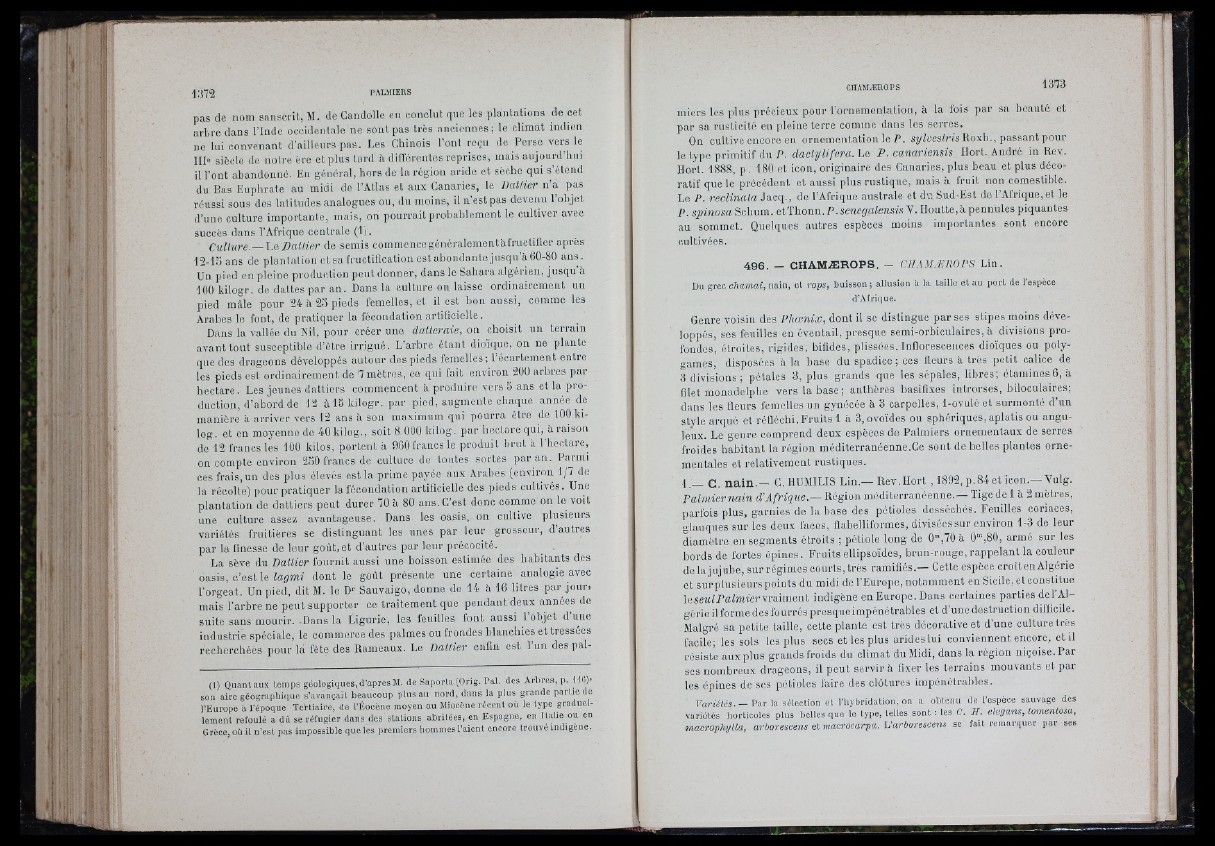
pas de nom sanscrit, M. de Candolle en conclut que les plantations de cet
arbre dans l’Inde occidentale ne sont pas très anciennes ; le climat indien
ne lui convenant d’ailleurs pas. Les Chinois l'ont reçu de Perse vers le
IIP siècle de notre ère et plus tard cà differontes reprises, mais aujourd’hui
il l’ont abandonné. Ln général, hors de la région aride et sèche qui s’étend
du Bas Euphrate au midi de l’Atlas et aux Canaries, le Dattier n’a pas
réussi sous des latitudes iinalogues ou, du moins, il n ’est pas devenu l’objet
d’une culture importante, mais, on pourrait probablement le cultiver avec
succès dans l’Afrique centrale (1).
Culture.— Le D attier de semis c o m m e n c e généralemcntàfructifier après
12-18 ans de plantation et sa fructification est abondante jusqu’à 60-80 ans.
Un pied en pleine production peut donner, dans le Sahara .algérien, jusqu’à
100 kilogr. de dattes par an. Dans la culture on laisse ordinairement un
pied mâle pour 24 à 23 pieds femelles, et il est bon aussi, comme les
Arabes le font, de pratiquer la fécondation .artificielle.
Dans la vallée du Nil, pour créer une datteraie, on choisit un terrain
avant tout susceptible d’être irrigué. L’arbre étant dioïque, on ne plante
que des drageons développés autour des pieds femelles; l’écartement entre
les pieds est ordinairement de 7 mètres, ce qui fait environ 200 arbres par
hectare. Les jeunes dattiers commencent à produire vers 8 ans et la production,
d’abord de 12 ù 18 kilogr. par pied, augmente chaque année do
manière à arriver vers 12 ans à son maximum qui pourra être de 100 ki-
log. et en moyenne do 40 kilog., soit 8,000 kilog. par hectare qui, à raison
de 12 francs les 100 kilos, portent à 960 francs le produit brut à l’hectare,
on compte environ 230 francs de culture de toutes sortes par an. Pajmi
ces frais, un des plus élevés est la prime payée aux Arabes (environ 1/7 de
la récolte) pour pratiquer laféeondation arliücielle des pieds cultivés. Une
plantation de dattiers peut durer 70 à 80 ans. C’est donc comme on le voit
une culture assez avantageuse. Dans les oasis, on cultive plusieurs
variétés fruitières se distinguant les unes par leur grosseur, d’autres
par la finesse de leur goût, et d’autres par leur précocité.
La sève du Dattier fournit aussi une boisson estimée des habitants des
oasis, c’est le togmï dont le goût présente une certaine analogie avec
l’orgeat. Un pied, dit M. le D° Sauvaigo, donne de 14 à 16 litres par jour-
mais l’arbre ne peut supporter ce traitement que pendant deux années de
suite sans mourir. Dans la Ligurie, les feuilles font aussi 1 objet d une
industrie spéciale, le commerce des palmes ou frondes blanchies el tressées
recherchées pour la fête des Bameaux. Le Dattier enfin est 1 un des pal-
(1) Q u a n t a u x t e m p s g é o l o g i q u e s , d ' a p r è s M. d e S a p o r t a (O r i g . P a l . d e s A r b r e s , p . liC)>
s o n a i r e g é o g r a p h i q u e s ' a v a n ç a i t b e a u c o u p p l u s a u n o r d , d a n s l a p l u s g r a n d e p a r t i e d e
P E u r o p e à l ’é p o q u e T e r t i a i r e , d e P l i o c è n e m o y e n a u M i o c è n e r é c e n t o ù l e t y p e g r a d u e l l
e m e n t r e f o u l é a d û s e r é f u g i e r d a n s d e s s t a t i o n s a b r i l é e s , e n E s p a g n e , e n I t a l i e o u en
G r è c e , o ù i l n ’e s t p a s im p o s s i b l e q u e le s p r e m i e r s h o m m e s P a i e n t e n c o r e t r o u v é i n d i g e n e .
miers les plus précieux pour l’ornementation, à la lois par sa beauté et
par sa rusticité en pleine terre comme dans les serres.
On cultive encore en ornementation le P. sg/yesD’iS Boxb., passant pour
le type primitif du P. d a c ty life ra .h e P . canariensis Hort. André in Rev.
Hort. 1888, p. 180 et icon, originaire des Canaries, plus beau et plus décoratif
que le précédent et aussi plus rusiique, mais à fruit non comestible.
Le P. reclinata Jacq., de l’Afrique australe et du Sud-Est de l’Afrique, et le
P. spinosa Schum. etThonn. P .senegalensis Y . Houtte, â pennules piquantes
au sommet. Quelques autres espèces moins importantes sont encore
cultivées.
4 9 6 . — G H A M Æ R O P S . - CHAM.EROPS L i n .
D u g r e c c h a î n a i , n a i n , e t r o p s , b u i s s o n ; a l l u s i o n à l a t a i l l e e t a u p o r t d e P e s p è c e
d ’.-Vfrique.
Genre voisin des P hoe n ix , dont il se distingue par ses stipes moins développés,
ses feuilles on éventail, presque semi-orbiculaires, à divisions profondes,
élroiles, rigides, bifides, plissées. Inflorescences dioïques ou polygames,
disposées à la hase du spadice ; ces Ileurs à très petit calice de
3 divisions; pétales 3, plus grands que les sépales, libres; étamines 6, à
fllet monadelphe vers la b a s e ; anthères basifixes introrses, biloculaires;
dans les fleurs femelles un gynécée à 3 carpelles, 1-ovulé et surmonté d’un
style arqué et rélléchi. Fruits 1 à 3, ovoïdes ou sphériques, aplatis ou anguleux.
Le genre comprend deux espèces de Palmiers ornementaux de serres
froides habitant la région méditerranéenne.Ge sont de belles plantes ornementales
et relativement rustiques.
1.— C. n a i n .— C. HUMILIS Lin.— Rev.Hort , 1892, p . 84 et icon.— Vulg.
P a lm ie r n a in d ’A friq u e .— Région méditerranéenne.— Tige de 1 à 2mètres,
parfois plus, garnies de lab a s e des pétioles desséchés, leuilles coriaces,
glauques sur les deux faces, flabelliformes, divisées sur environ 1-3 de leur
diamètre en segments étroits ; pcliole long de 0",7Ü à 0",80, armé sur les
bords de fortes épines. Fruits ellipsoïdes, brun-rouge, rappelant la couleur
de la jujube, sur régimes courts, très r ami f i é s . - Cette espèce croît en Algérie
et sui’plusieurspointsdu midi de l’Europe, notamment en Sicile, et constitue
\e seul P a lm ie r y vaunenl indigène en Europe. Dans certaines parties de l’Algérie
il forme des fourres presque impénétrables el d’une destruction difficile.
Malgré sa pelite taille, cette plante est très décorative et d’une culture très
facile; les sols lesplus secs et les plus arides lui conviennent encore, et il
résiste aux plus grands froids du climat du Midi, dans la région niçoise. Par
ses nombreux drageons, il peut servir à fixer les terrains mouvants et par
les epines de ses pétioles faire des clôtures impénétrables.
F a r i iS i é s . — P a r l a s é l e c t i o n e t l ’h y b r i d a t i o n , o n a o b t e n u d e l ’e s p è c e s a u v a g e d e s
v a r i é t é s h o r t i c o l e s p l u s b e l l e s q u e l e t y p e , t e l l e s s o n t : l e s C . I I . e l e g a n s , t o m e n t o s a ,
m a c r o p h y l l a , a r b o r e s c e n s e t m a c r o c a r p a . L ’ a r b o r e s c e n s s e t a i t r e m a r q u e r p a r s e s