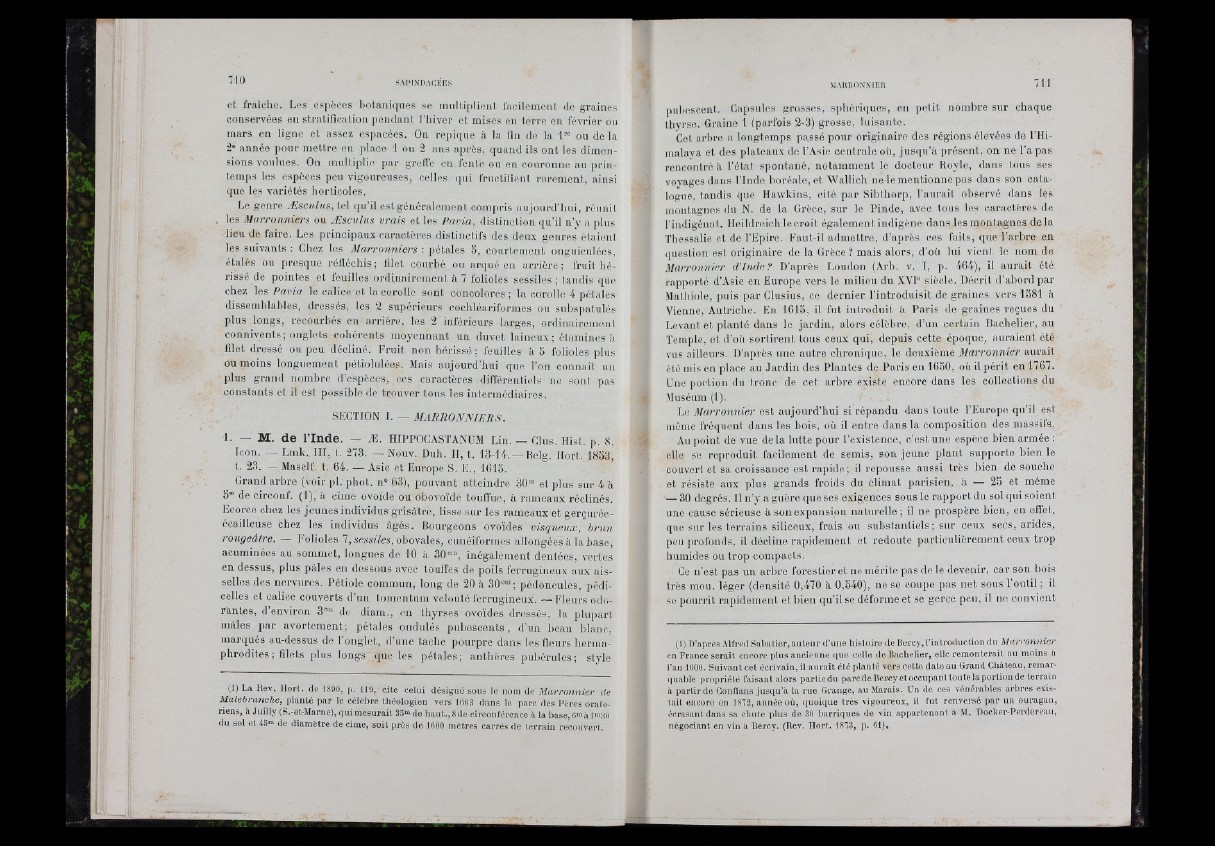
et fraiclie. L(>s espèces liotaiiiques sc miiltiplicnl facilement ilc graines
conservées en stratification pendani l’hiver et mises en terre en février ou
mars en ligne et assez espacées. On repique à la fm do la 1™ ou de la
2* année pour mettre en jilace 1 ou 2 ans après, quand ils ont les dimensions
voulues. On mulliplic par greffe en fente ou en couronne au p rin temps
les espèces peu vigoureuses, celles qui fructillent rarement, ainsi
que les variétés liorlicolcs.
Le genre cEsciiliis, tel ([u’il estgénéralemcnl compris aujourd’hui, réunil
les Marronniers ou Æscidits vrais el les Paria, distinction ipi’il n ’y a pins
lieu de faire. Los principaux caractères distinctifs îles deux genres étaioni
les suivants ; Chez les Marronniers : pétales 8, courtement onguiculées,
étalés ou presque réfléchis ; iilct courbé ou arqué en arriére ; fruil hérissé
de pointes et feuilles ordinairement à 7 folioles sessiles ; tandis que
chez \es Paria le calice et la corolle sont concolores ; la corolle 4 pétales
dissemblables, dressés, les 2 supérieurs cochléariformes ou subspatulés
plus longs, recourbés en arrière, les 2 inférieurs larges, ordiiiairenienl
connivents; onglels cohérents moyennant un duvet laineux; élamiues à
filet dressé ou peu décliné. Fru it non h é rissé; feuilles à 8 folioles plus
ou moins longuement pétiolulées. Mais aujourd'hui que l’on connaît un
plus grand nombre d’espèces, ces caractères différentiels ne soni pas
constants el il esl possible de trouver tous les inlermédi,aires.
SECTION I. — MARRONNIERS.
1. — M. de l’Inde. - Æ. HIPPOCASTANUM Lin. — Clus. Hist. p. 8.
Icon. — Lmk. III, I. 273. — Nouv. Duh. H, t. 13-14. — Dclg. Horl. 1853,
t. 23. - Masclf. t. 64. — Asie et Europe S. E., 1618.
Grand arbre (voir pl. phot, n» 63), pouvant atteindre 30“ et plus sur 4 à
S'" de circonf. (1), à cime ovoïde ou obovoïde touffue, à rameaux réolinés.
Ecorce chez les jeunes individus grisâtre, lisse sur les rameaux et gerçurée-
écailleuse chez les individus âgés. Bourgeons ovoïdes v isqueux, brun
rougeâtre. — Folioles 7, se.s.siYe.s-, obovales, cunéiformes allongées à la base,
acuminées au sommet, longues de 10 à 3 0 '" , inégalement dentées, vertes
en dessus, plus pâles en dessous avec touffes de poils ferrugineux aux aisselles
des nervures. Pétiole commun, long de 20 à 3 0 '“ ; pédoncules, pédicelles
et calice couverts d’un tomentum velouté ferrugineux. — Fleurs odorantes,
d’environ 3 '“ de diam., en thyrses ovoïdes dressés, la plupart
mâles pa r avortement; pétales ondulés p ubescents, d’nn beau blanc,
marqués au-dessus de l’onglet, d’une tache pourpre dans les fleurs hermaphrodites
; fdets plus longs ipic les pélales; anthères pubérules; style
i l ) La Rev. H o rt. d e 1890, p. 110, c ite c e lu i d é s ig n é sou s le nom de M a r r o n n i e r d e
M a le b r a n c h e , plan té par le célèb r e th éo lo g ien v ers 1663 d an s le parc d es Pères orato-
r ien s, à Ju illy (S.-et-Marne), qu i m esu ra it 33*» d e h a u t., 8 d e circon fé ren c e à la b a s e ,6 ” à l ” 30
du sol e t 43” de d iam è tr e de cim e , s o it près de 1600 m ètres carrés de terrain r e cou v er l.
pubescent. Capsules grosses, sphériques, en petit nombre sur chaque
Ihyrsc. Graine 1 (parfois 2-3) grosse, luisante.
Cet arbre a longtemps passé pour originaire des régions élevées de l’Hi-
malaya et des plateaux de l’Asie centrale où, ju sq u ’à présent, on ne l’a pas
rencontré à l’étal spontané, notamment le docteur Royle, dans Ions ses
voyages dans l'Inde boréale, el Wallicli ne le mentionne pas dans son catalogue.
tandis que Hawkius, cilé par Sibthorp, l’aurait observé dans les
montagnes du N. de la Grèce, sur le Pinde, avec tous les caractères de
rindigénal. Heildreicb le croit également indigène dans les montagnes de là
Tliessalie et de l’Epire. Faut-il admettre, d’après ces faits, que l’arbre en
question esl originaire de la Grèce ? mais alors, d’oii lui vient le nom de
Marronnier d’Inde? D’après Loudon (Arb, v. I, p. 464), il au rait été
rapporté d’Asie en Europe vers le milieu du XVP siècle. Décrit d’abord par
Mathiole, puis par Glusius, oc dernier l’introduisit de graines vers 1881 à
Vienne, Autriche. Eu 1618, il fut in troduit à Paris de graines reçues du
Levant et planté dans le jard in , alors célèbre, d’un certain Bachelier, au
Temple, et d’où so rtiren t tous ceux qui, depuis cette époque, auraient été
vus ailleurs. D’après une autre chronique, le deuxième Marronnier aurait
été mis on place au Ja rd in des Plantes de P a ris e n I6 6 0 , o ù il périt en l7 6 7 .
Une portion du tronc de cet arbre existe encore dans les collections du
Muséum (1).
Le Marronnier est aujourd’hui si répandu dans toute l’Europe qu’il est
même frcqiienl dans les bois, où il entre dans la composition des massifs.
Au point de vue d e là lutte pour l’existence, c’est une espèce bien armée :
elle se reproduit facilement de semis, son jeune p lan t supporte bien le
couvert et sa croissance esl rapide; il repousse aussi très bien de souche
et résiste aux plus grands froids du climat parisien, à — 28 et même
— 30 degrés. Il n ’y a guère que ses exigences sous le rapport du sol qui soient
une cause sérieuse à son expansion n a turelle; il ne prospère bien, en effet,
que sur les terra in s siliceux, frais ou substantiels; sur ceux secs, arides,
peu profonds, il décline rapidement et redoute particulièrement ceux trop
humides ou trop compacts.
Ce n’est pas un arbre forestier et ne m érite pas de le devenir, car son bois
très mou, léger (densité 0,470 à 0,840), ne se coupe pas net sous 1 outil ; il
se pourrit rapidement et bien qu’il se déforme et se gerce peu. il ne convient
(I) D'après A lfred S ab aü er , au teu r d ’u ne h isto ir e de Bercy, r in tr o d u c lio n du M a r r o n n ie r
en France se ra it en co r e plus a n c ien n e que c e lle de Bachelier, e lle remon te ra it au m o in s a
l’an 1600. S u iv an t c e t é c riv a in , il au ra it é té plan té v ers c e tte d a te au Grand Château, remarquable
propriété fa isan t a lors p a r lie d u p a r cd e Bercy e t o ccupant toute la portion d e terrain
â partir de Conflans ju sq u ’à la rue Grange, au Marais. Un de ces v én é rab le s arbres e x is tait
encore en 1872, an n é e où , q u o iq u e trè s v ig ou r eu x , il fut r en v e rsé par un ou ra g an ,
écrasant dans sa ch u te p lu s d e 30 b a rriq u es d e vin appartenant ,i M. Oocker-Perdereau,
n ég o c ian t en vin â Bercy. (Rev. Hort. 1873, p. 61).