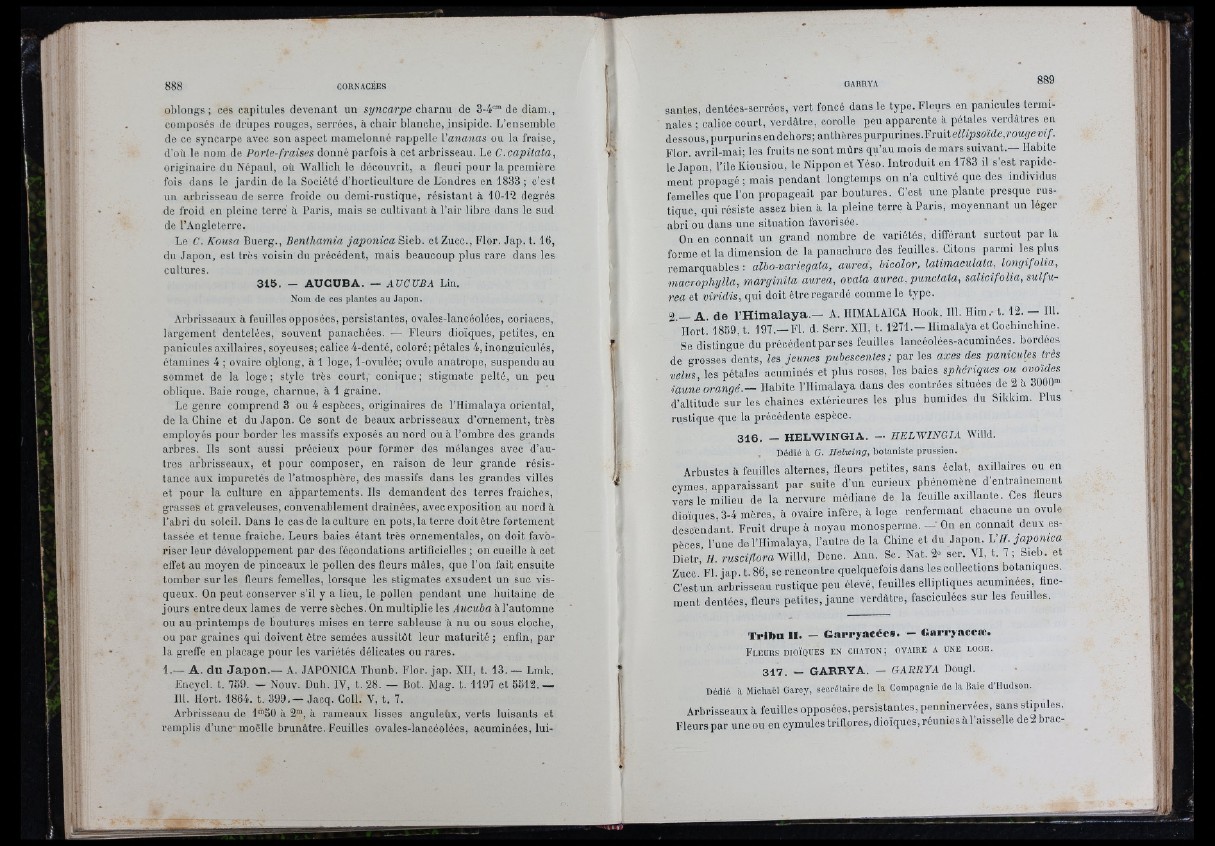
oblongs ; ces capitules devenant un syncarpe cbarnu de 3-4™ de diam.,
composés de drupes rouges, serrées, à cbair blancbe, insipide. L’ensemble
de ce syncarpe avec son aspect mamelonné rappelle l'ananas ou la fraise,
d’où lo nom de Porte-fraises donné parfois à cet arbrisseau. Le C. capitata,
originaire du Népaul, où Walliob le découvrit, a fleuri pour la première
fois dans le jardin de la Société d’borticulture de Londres en 1833 ; c’est
uu arbrisseau de serre froide ou demi-rustique, résistant à 1 0 - 1 2 degrés
de froid en pleine terre' à Paris, mais se cultivant à l’air libre dans le sud
de l’Angleterre.
Le C. Kousa Buerg., Benthamia ja p ó n ica Sieb. et Zucc., Flor. Jap. t. 16,
du Japon, est très voisin du précédent, mais beaucoup plus rare dans les
cullures.
3 1 5 . — A U C U B A . — A V C Ü B A Lin.
Nom de c e s p lan tes au Japon.
Arbrisseaux à feuilles opposées, persistantes, ovales-lancéolées, coriaces,
largement dentelées, souvent panachées. — Fleurs dio'iques, petites, en
panicules axillaires, soyeuses; calice 4-denlé, coloré; pétales 4, inonguiculés,
étamines 4 ; ovaire oblong, à 1 loge, 1-ovulée; ovule anatrope, suspendu au
sommet de la loge; style très court, conique; stigmate pelté, un peu
oblique. Baie rouge, charnue, à 1 graine.
Le genre comprend 3 ou 4 espèces, originaires de l’IIimalaya oriental,
de la Chine et du Japon. Ce sont de beaux arbrisseaux d’ornement, très
employés pour border les massifs exposés au nord ou à l’ombre des grands
arbres. Ils sont aussi précieux pour former des mélanges avec d’autres
arbrisseaux, et pour composer, en raison de leur grande résistance
aux impuretés de l’atmosphère, des massifs dans les grandes villes
et pour la culture en a'ppartements. Ils demandent des terres fraîches,
grasses et graveleuses, convenablement drainées, avec exposition au nord à
l’abri du soleil. Dans le cas de la culture en pots, la terre doit être fortement
tassée et tenue fraîche. Leurs baies étant très ornementales, on doit favorise
r leur développement par des fécondations artificielles ; on cueille à cet
effet au moyen de pinceaux le pollen des fleurs mâles, que l’on fait ensuite
tomber sur les fleurs femelles, lorsque les stigmates exsudent un suc visqueux.
On peut conserver s’il y a lieu, le pollen pendant une huitaine de
jo u rs entre deux lames de verre sèches. On multiplie les AiiCîtia à l’automne
on au printemps de boutures mises en te rre sableuse à nu ou sous cloche,
ou pa r graines qui doivent être semées aussitôt leur maturité ; enfin, par
la greffe en placage pour les variétés délicates ou rares.
1.— A . d u J a p o n .— A. JAPONICA Tbunb. Flor. jap . XII, t. 13. - Lmk.
Encycl. t. 789. — Nouv. Duh. IV, t. 28. — Bot. iMag. t. 1197 et 5812. —
111, Hort. 1864. t. 399. — Jacq. Coll. V, t. 7.
Arbrisseau de 1™5Ü à 2™, à rameaux lisses anguleux, verts luisants et
remplis d’une moëlle brunâtre. Feuilles ovales-lancéolées, acuminées, luisantés,
dentées-serrées, vert foncé dans le type. Fleurs en panicules terminales
; calice court, verdâtre, corolle peu apparente â pétales verdâtres en
dessous, purpurinsendehors;antbèrespurpurines.Fruite«i/JSOza!e,rOMi/eui7.
Flor. avril-mai; les fruits ne sont mûrs qu’au mois de mars suivant.— Habite
le Japon, l’ile Kiousiou, le Nippon et Yéso. Introduit en 1783 il s’est rapidement
propagé ; mais pendant longtemps on n ’a cultivé que des individus
femelles que l’on propageait par boutures. G’est une plante presque ru stique,
qui résiste assez bien à la pleine terre à Paris, moyennant un léger
abri ou dans une situation favorisée.
On en connaît un grand nombre de variétés, différant surtout par la
forme et la dimension de la panacbure des feuilles. Citons parmi les plus
remarquables : albo-variegata, aurea, bicolor, latimaculata, longifolia,
macrophylla, marg in ila aurea, ovaia aurea, p u nctata, sa licifo lia , su lfu rea
et v iridis, qui doit être regardé comme le type.
2 , Lk. d e l’H im a la y a .— A. HIMALAICA Hook. 111. Him.-1. 12. — 111.
" ilo rt. 1869, t. 197.— Fl. d. Serr. XII, t. 1 2 7 1 .— Himalaya et Gochinchine.
Se distingue du précédent pa r ses feuilles lancéolées-acuminées. bordées
de grosses dents, les jeunes pubescentes; pa r les axes des panicules très
velus, les pétales acuminés et plus roses, les baies sphériques ou ovo'ides
iaune orangé.— Habite l’IIimalaya dans des contrées situées de 2 à 3000™
d’altitude sur les chaînes extérieures les plus humides du Sikkim. Plus
rustique que la précédente espcce.
3 16 . — HELWINGIA. — HELWINGIA 'SViUd.
D éd ié à G. H e lw in g , b o ta n iste p ru s s ien .
Arbustes à feuilles alternes, fleurs petites, sans éclat, axillaires ou en
cymes, apparaissant par suite d’un curieux phénomène d’entraînement
vers le milieu de la nervure médiane de la feuille axillante. Ces fleurs
dio'iques, 3 - 4 mères, à ovaire infère, à loge renfermant chacune un ovule
descendant. Fruit drupe à noyau monosperme. — On en connaît deux espèces,
l’une de l’Himalaya, l’autre de la Chine et du Japon. h'II. ja p om c a
Dietr, II. ru s c iflo raW û ld , Dcne. Ann. So. Nat. 2» ser. VI, t. 7 ; Sieb. et
Zucc Fl. jap. t. 8 6 , se rencontre quelquefois dans les collections botaniques.
C’e s tu n arbrisseau rustique peu élevé, feuilles elliptiques acuminées, finement
dentées, fleurs petites, jaune verdâtre, fasciculées sur les feuilles.
Tribu II. — Garryacces. — Gnrryaccse.
F l e u r s d io 'iq u e s e n c i ia t o n ; o v a ir e a u n e l o g e .
3 1 7 . - GARRYA. — GARUYA Dougl.
Dédié à Michaël Garcy, s e c r é ta ir e de la Compagnie de la Baie d ’ITudson.
Arbrisseaux à feuilles opposées, persistantes, penninervées, sans stipules.
Fleurs p ar une ou en cymules triflores, dio'iques, réunies à l’aisselle de 2 brac