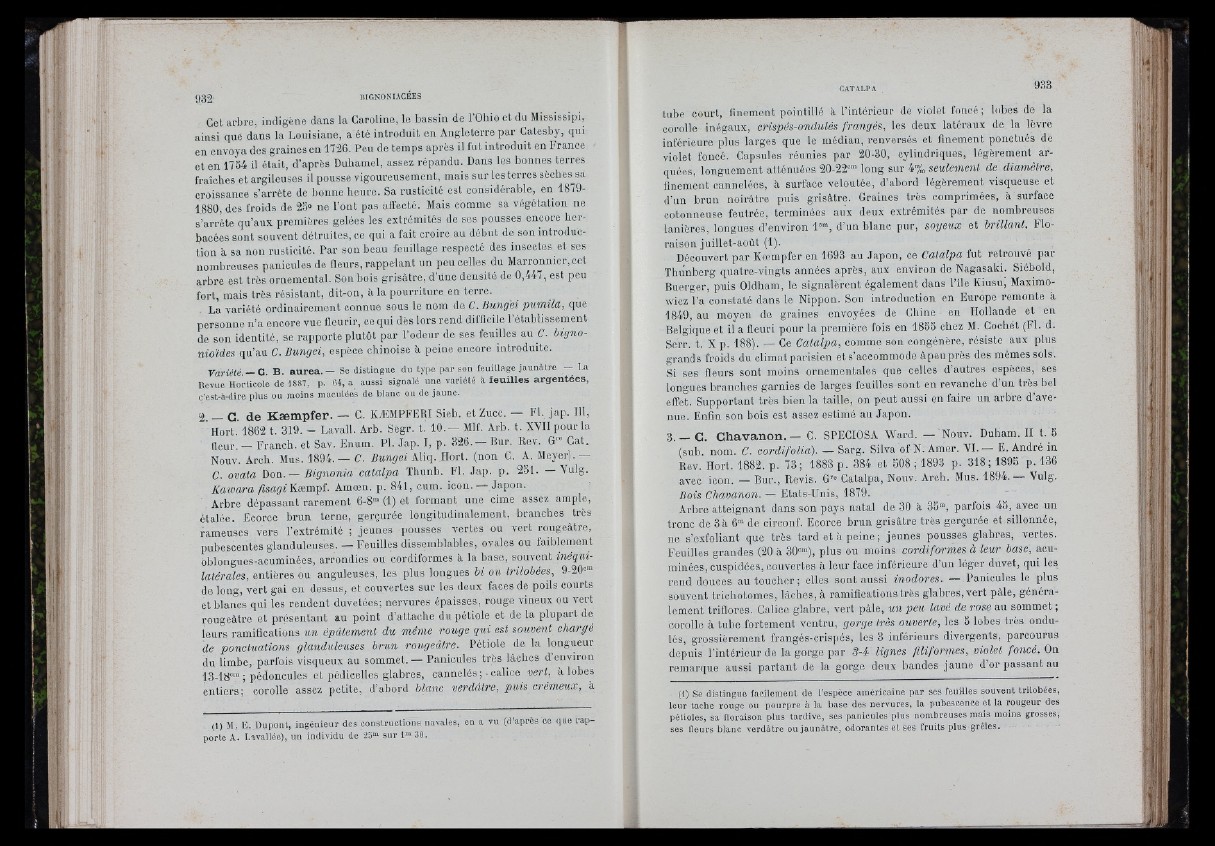
Cot arbre, indigène dans la Caroline, le bassin de l’Obio et du Mississipi,
ainsi que dans la Louisiane, a été introduit en Angleterre par Catesby, qui
en envoya des graines en 1726. Peu de temps après il fui introduit en France
et en 1784 il était, d’après Dubamel, assez répandu. Dans les bonnes terres
fraîches et argileuses il pousse vigoureusement, mais sur les terres sèches^sa
croissance s’arrête de bonne heure. Sa rusticité ost considérable, en 1879-
1880, des froids de 28« ne l’ont pas affecté. Mais comme sa végétation ne
s’arrête qu’aux premières gelées les extrémités de ses pousses encore h e rbacées
sont souvent détruites, ce qui a fait croire au début de son introduction
à sa non rusticité. Par son beau feuillage respecté des insectes et scs
nombreuses panicules de fleurs, rappelant un peu celles du Marronnier, cet
arbre est très ornemental. Son bois grisâtre, d’une densité de 0,447, est peu
fort, mais très résistant, dit-on, à la pourriture en terre.
La variété ordinairement connue sous le nom de C. Bungei p um ila , que
personne n ’a encore vue fleurir, ce qui dès lors rend diificile 1 établissement
de son identité, se rapporte plutôt par l’odeur de ses feuilles au C. bigno-
nioïdes qu’au C. Bungei, espèce chinoise à peine encore introduite.
V a r i é t é .— C . B . au r e a . — Se d is tin g u e du type par son to u illa g e ja u n â tr e — La
Revue H o rtico le de 1887, p. C4, a a u s s i sig n a lé u n e v a r ié té â l e u i l l e s a r g e n t e e s ,
c ’est-à-dire p lu s ou m o in s m a cu lé e s d e b lan c ou de ja u n e .
2 — C. d e K æ m p f e r . — G. KÆMPFERI Sieb. et Zucc. — Fl. ,jap. Ill,
" llo rt. 1862 t. 319. - Lavall. Arb. Segr. t. 10 .— Mlf. Arb. t. XVII pour la
fleur. — Franch. et Sav. Enum. Pl. Jap. I, p. 326. — Bur. Rev, G’“ Cat.
Nouv. Arcb. Mus. 1894. — C. Bungei Aliq. Ilort. (non G. A. Meyer). —
C. ovala Don.— Bignonia catalpa Thunb. El. Jap. p. 281. - Vuig.
Kawara /îsa^t Kæmpf. Amoen. p. 841, cum. icon. — Japon.
Arbre dépassant rarem ent 6-8" (1) et formant une cime assez ample,
étalée. Ecorce brun terne, gerçurée longitudinalement, branches très
rameuses vers l’extrémité ; jeunes pousses vertes ou vert rougeâtre,
pubescentes glanduleuses. — Feuilles dissemblables, ovales ou faiblement
oblongues-acuminées, arrondies ou cordiformes â la base, souvent inéqui-
lalérales, entières ou anguleuses, les plus longues bi ou trilobées, 9-20™
de long, vert gai en dessus, et couvertes sur les deux faces de poils courts
et blancs qui les rendent duvetées; nervures épaisses, rouge vineux ou vert
rougeâtre el p ré sentant au p oint d’attache du pétiole et de la plu p art de
leurs ramifications u n épâtement du même rouge qui est souvent chargé
de ponctuations glanduleuses brun rougeâtre. Pétiole de la longueur
du limbe, parfois visqueux au sommet.— Panicules très lâches d environ
13-18“ '; pédoncules el pédicelles glabres, cannelés ;■ calice vert, à lobes
en tie rs; corolle assez petite, d’abord blanc verdâtre, p u is crémeux, a
(1) M. K. D u p on t, in g é n ie u r d e s c o n s tr u c t io n s n a v a le s, en a vu (d’après c c que rap
porte A . La v a llé e ), un in d iv id u d e 2o“ su r 30.
tube court, finement pointillé â l’intérieur de violet foncé; lobes de la
corolle inégaux, crispés-ondulés frangés, les deux latéraux de la lèvre
inférieure plus largos que le médian, renversés et finement ponctués de
violet foncé. Capsules réunies par 20-30, cylindriques, légèrement^ a rquées,
longuement atténuées 20-22™ long sur 4"/» seulement de diamètre,
finement cannelées, à surface veloutée, d’abord légèrement visqueuse et
d’un brun noirâtre puis grisâtre. Graines très comprimées, à surface
cotonneuse feutrée, terminées aux deux extrémités pa r de nombreuses
lanières, longues d’environ 1™, d’un blane pur, so y eu x et brillant. Floraison
ju illet-ao û t (1).
Découvert pa r Kæmpfer en 1693 au Japon, ce Catalpa fut retrouvé par
Thunberg quatre-vingts années après, aux environ de Nagasaki. Siébold,
Buerger, puis Oldham, le signalèrent également dans l’ile Kiusu, Maximo-
wicz l’a constaté dans le Nippon. Son introduction en Europe remonte à
1849, au moyen de graines envoyées de Cbine en Hollande et en
Belgique et il a fleuri pour la première fois en 1888 chez M. Cochet (Fl. d.
Serr. t. X p. 188). — Ce Catalpa, comme son congénère, résiste aux plus
grands froids du climat p arisien et s’accommode àp eu p rè s des mêmes sols.
Si ses fleurs sont moins ornementales que celles d’autres espèces, ses
longues branches garnies de larges feuilles sont en revanche d’un très bel
effet. Supportant très bien la taille, on peut aussi en faire un arbre d’avenue.
Enfin son bois est assez estimé au Japon.
3 .— C. G h a v a n o n .— G. SPECIOSA Ward. — Nouv. Duham. II t. 8
(sub. nom. C. cordifolia). — Sarg. Silva of N. Amer. VI. E. André in
Rev. Hort. 1882. p. 73; 1888 p . 384 ot 808 ; 1893 p. 318; 1898 p. 136
avec icon. — Bur., Revis. G'« Catalpa, Nouv. Arcb. Mus. 1894.— Vulg.
Bois Chavanon. — Etats-Unis, 1879.
Arbre atteignant dans son pays natal do 30 â 38", parfois 48, avee un
tronc de 3 à 6" de circonf. Ecorce brun grisâtre très gerçurée et sillonnée,
ne s’exfoliant que très ta rd et à peine ; jeunes pousses glabres, vertes.
Fouilles grandes (20 à 30“ '), plus ou moins cordiformes à leur base, acuminées,
cuspidées, couvertes â leur face inférieure d’un léger duvet, qui les
rend douces au toucher ; elles sont aussi inodores. — Panicules lo plus
souvent trichotomes, lâches, à ramifications très glabres, vert pâle, généralement
triflores. Galice glabre, vert pâle, u n p e u lavé de rose au sommet ;
corolle à tube fortement ventru, gorge très ouverte, les 8 lobes très ondulés,
grossièrement frangés-crispés, les 3 inférieurs divergents, parcourus
depuis l’in térieur de la gorge pa r 3 - i lignes filiformes, violet foncé. On
remarque aussi p a rta n t de la gorge deux bandes jaune d’or passant au
(1) Se d is tin g u e fa c ilem en t d e l'e sp è c e am é r ic a in e par se s feu ille s so u v en t tr ilo b é e s ,
leu r tach e r o u g e ou pou rp r e à la b a se d es n e r v u r e s, la p u b e s c en c e e t la rou g eu r d es
p é tio le s, sa Horaison p lu s ta rd iv e , s e s p a n icu le s p lu s n om b r eu se s m a is m o in s g r o sse s,
se s fleurs b la n c v e rd â tr e ou ja u n â tr e , o d o r an te s e t se s fru its p lu s g r ê le s .
I l s '
i
i
i! ^
■ ' : l