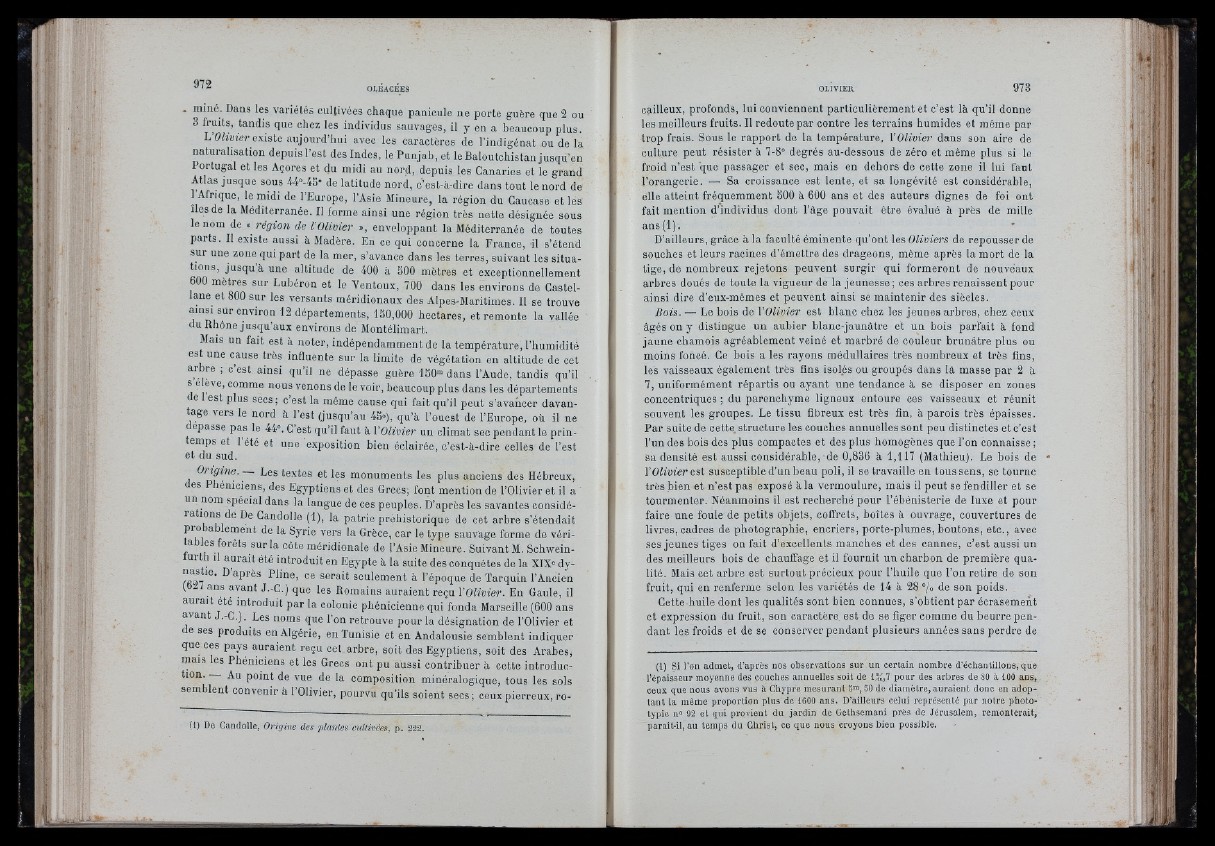
I 1
î 'k
. miné. Dans les variétés cultivées chaque panicule ne porte guère que 2 ou
3 fruits, tandis que chez les hidividus sauvages, il y en a beaucoup plus.
L Olivier existe aujourd’hui avec les caractères de l’indigénat ou de la
naturalisation depuis l’est des Indes, le Punjab, et le B aloutchistan ju sq u ’en
Portugal et les Açores et du midi au nord, depuis les Canaries et le grand
Atlas jusque sous 4.4“-48” de latitude nord, c’est-à-dire dans tout le nord de
1 Afrique, le midi de l’Europe, l’Asie Mineure, la région du Caucase et les
îles de la Méditerranée. Il forme ainsi une région très nette désignée sous
le nom de « région de l'Olivier », enveloppant la Méditerranée de toutes
p a rts . Il existe aussi à Madère. En ce qui concerne la France, il s’étend
sur une zone qui pa rt de la mer, s’avance dans les terres, suivant les situa-
tions, jusqu à une altitude de 400 à 800 mètres et exceptionnellement
600 mètres su r Lubéron et le Ventoux. 700 dans les environs de Castel-
lane et 800 sur les versants méridionaux des Alpes-Maritimes. Il se trouve
ainsi sur environ 12 départements, 180,000 hectares, et remonte la vallée
du Rhône ju sq u ’aux environs de Moatélimart.
Mais un fait est à noter, indépendamment de la température, l’humidité
est une cause teès influente sur la limite de végétation en altitude de cet
arffle ; c’est ainsi q u ’il ne dépasse guère 180" dans l’Aude, taudis qu ’il
s c y e , comme nous venons de le voir, beaucoup plus dans les départements
e est plus secs; c’est la même cause qui fait qu’il peut s’avancer davan-
tage vers le nord à l’est (jusqu’au 48»), qu ’à l’ouest de l’Europe, où il ne
epasse pas le 44". C’est qu’il faut à VOlivier un climat sec pendant le p rin temps
et l’été et une exposition bien éclairée, c’est-à-dire celles de l’est
et du sud.
Ol igine. ^ Les textes et les monuments les plus anciens des Hébreux,
des Phéniciens, des Egyptiens et des Grecs, font mention de l’Olivier et il a
un nom spécial dans la langue de ces peuples. D’après les savantes considé-
1 a Dons de De Candolle (1), la patrie préhistorique de cet arb re s’étendait
probablement de la Syrie vers la Grèce, car le type sauvage forme de véritables
forêts sur la côte méridionale de l’Asie Mineure. Suivant M. Schwein-
iu rth il au rait été in troduit en Egypte à la suite des conquêtes de la XIX» dy-
Mstie . D’après Pline, ce serait seulement à l’époque de Tarquín l’Ancien
(b., / ans avant J.-C.) que les Romains auraien t reçu VOlivier. En Gaule, il
au rait été introduit p a r la colonie phénicienne qui fonda Marseille (600 ans
avant J.-C.), Les noms que l’on retrouve pour la désignation de l’Olivier et
de ses produits en Algérie, en Tunisie et en Andalousie semblent indiquer
que ces pays auraient reçu cet arbre, soit des Egyptiens, soit des Arabes,
mais les Phéniciens et les Grecs ont pu aussi contribuer à cette introduction.
Au point de vue de la composition minéralogique, tous les sols
semblent convenir à l’Olivier, pourvu qu’ils soient secs; ceux p ierreux, ro-
(1) De Candolle, O r ig in e des ¡liantes cultivées, p . 222.
cailleux, profonds, lui conviennent particulièrement et c’est là qu’il donne
les meilleurs fruits. H redoute p ar contre les terrains humides et même par
trop frais. Sous le rap p o rt de la température, VOlivier dans son aire de
culture peut résister à 7-8» degrés au-dessous de zéro et même plus si le
froid n’est que passager et sec, mais en dehors de cette zone il lui faut
l’orangerie. —• Sa croissance est lente, et sa longévité est considérable,
elle a tte in t fréquemment 800 à 600 ans et des auteurs dignes de foi ont
fait mention d’individus dont l’âge pouvait être évalué à près de mille
a n s ( l) .
D’ailleurs, grâce à la faculté éminente qu’ont les Oliviers de repousser de
souches et leurs racines d ’émettre des drageons, même après la mort de la
lige, de nombreux rejetons peuvent surgir qui formeront de nouveaux
arbres doués de toute la vigueur de la jeu n e sse; ces arbres ren aissen t pour
ainsi dire d’eux-mêmes et peuvent ainsi se maintenir des siècles.
Bois. — Le bois de VOlivier est blanc chez les jeunes arbres, chez ceux
âgés on y distingue un aubier blanc-jaunâtre et un bois parfait à fond
jau n e chamois agréablement veiné et marbré de couleur brunâtre plus ou
moins foncé. Ce bois a les rayons médullaires très nombreux et très fins,
les vaisseaux également très fins isol.és ou groupés dans lâ masse pa r 2 à
7, uniformément rép artis ou ayant une tendance à se disposer en zones
concentriques ; du parenchyme ligneux entoure ces vaisseaux et réunit
souvent les groupes. Le tissu fibreux est très fm, à parois très épaisses.
Par suite de cette, structure les couches annuelles sont peu distinctes et c’est
l’un des bois des plus compactes et des plus homogènes que l’on connaisse;
sa densité est aussi considérable, de 0,836 à 1,117 (Mathieu). Le bois de
VOlivier est susceptible d’un beau poli, il se travaille en tous sens, se tourne
très bien et n ’est pas exposé à la vermoulure, mais il peut se fendiller et se
tourmenter. Néanmoins il est recherché pour l’ébénisterie de luxe et pour
faire une foule de petits objets, coffrets, boîtes à ouvrage, couvertures de
livres, cadres de photographie, encriers, porte-plumes, boutons, etc., avec
.ses jeunes tiges on fait d’excellents manches et des cannes, c’est aussi un
des meilleurs bois de chauffage et il fournit un charbon de première qualité.
Mais cet arbre est surtout précieux pour l’huile que l’on retire de son
fruit, qui en renferme selon les variétés de 14 à 28 ”/o de son poids.
Cette huile dont les qualités sont bien connues, s ’obtient p ar écrasement
et expression du fruit, son caractère est de se figer comme du beurre p en dant
les froids et de se conserver pendant plusieurs années sans perdre de
(1) Si l ’on adm e t, d ’après nos o b se r v a tio n s su r u n ce rta in n om bre d ’é ch a n tillo n s , que
l’ép a isseu r m o y en n e d es c ou ch e s a n n u e lle s s o it de I X ,1 p our d es arbres de 80 à 100 an s,
c eu x q u e n o u s a v o n s v u s à Chypre m esu r an t 5", 50 d e d iam è tr e , a u r a ien t d onc en ad op tan
t la m êm e p ropo rtion p lu s de 1600 a n s . D ’a illeu r s c e lu i rep r ésen té par n o tr e p h o to typ
ie n» 92 e t q u i pro v ien t du ja rd in de G ethseman i près d e J érusa lem , r em on te r a it,
paraît-il, au tem p s du C h rist, c e q u e n o u s c r o y on s bien p o ssib le .
' r - '
t : '
I