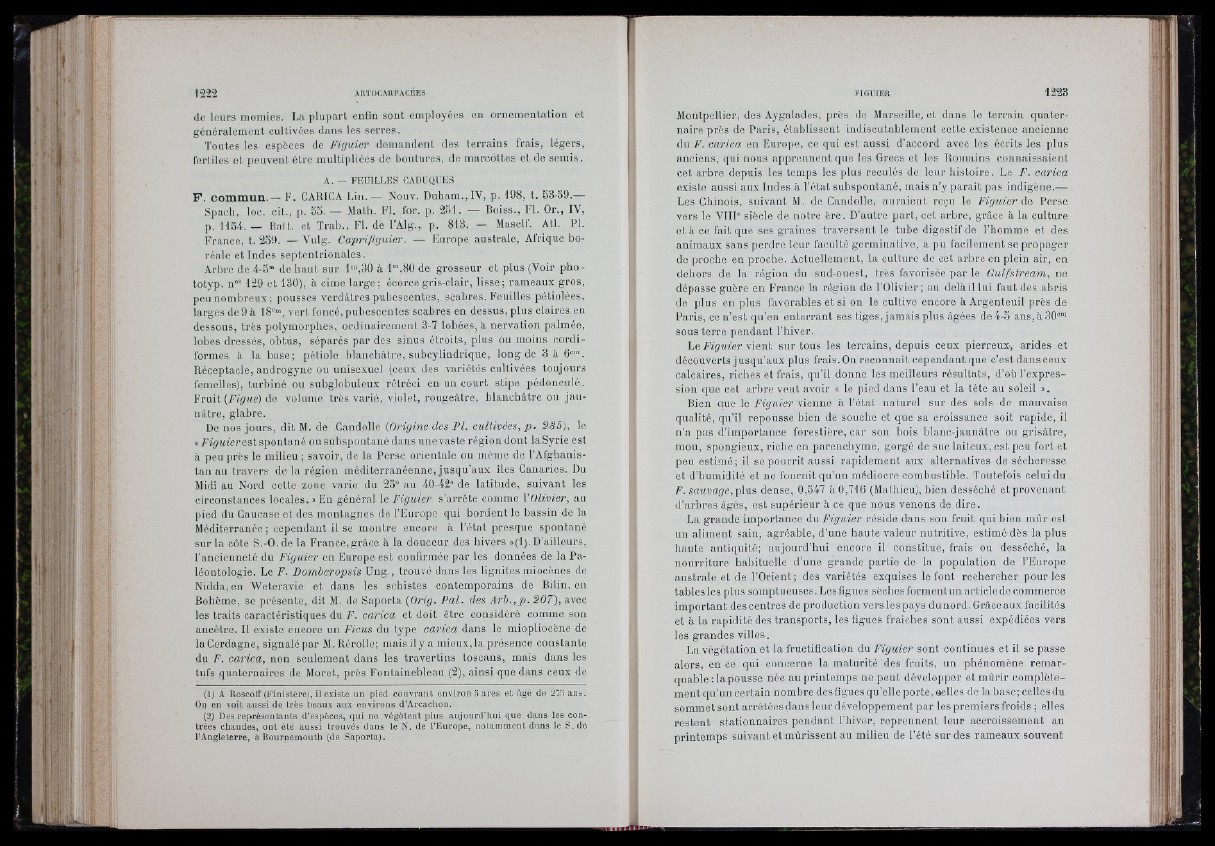
j | f
1 1 :
de leurs momies. La p lupart enfin sont employées en ornementation et
généralement cultivées dans les serres.
Toutes les espèces de Figuier demandent des terra in s frais, légers,
fertiles et peuvent être multipliées de boutures, de marcottes et de semis.
A . _ F E U lL U î S C A D U Q U E S
F . c o m m u n .— F. CAllICA L in .— Nouv. Duham., IV, p. 198, t. 83-S9.—
Spach, loo. cit., p. B5. - - Math. Fl. for. p. 251. — Boiss., Fl. Or., IV,
p . -1 1 8 4 . _ Balt. et Trab., Fl. de l’Alg., p. 813. — Masclf. Atl. Pl.
France, t. 259. — Vulg. Caprifiguier. — Europe australe, Afrique boréale
et Indes septentrionales.
Arbre de 4-8'" de h au t sur 1”>,30 à 1",8Ü de grosseur et plus (Voir pho-
totyp. n“« 129 et 13Ü), à cime large; écorce gris-clair, lisse; rameaux gros,
peu nombreux; pousses verdâtres pubescentes, scabres. Feuilles pétiolées,
larges de 9 à IS™, vert foncé, pubescentes scabres en dessus, plus claires en
dessous, très polymorphes, ordinairement 3-7 lobées, à nervation palmée,
lobes dressés, obtus, séparés par des sinus étroits, plus ou moins cordiformes
à la base; pétiole blanchâtre, subcylindrique, long do 3 à 6™.
Réceptacle, androgyne ou unisexual (ceux des variétés cultivées toujours
femelles), turbiné ou subglobuleux rétréci en un court stipe pédonculé.
Fru it {Figue) do volume très varié, violet, rougeâtre, blanchâtre ou ja u nâtre,
glabre.
De nos jo u rs, dit M. de Candolle {Origine des PL cultivées, p . S35), le
« frigtitorest spontané ou subspontané d an su n ev aste région dont laSyrie est
à peu près le milieu ; savoir, de la Perse orientale ou môme de l’Afghanistan
au travers de la région méditerranéenne, ju sq u 'au x îles Canaries. Du
Midi au Nord cette zone varie du 28° au 40-42° de latitude, suivant les
circonstances locales.» En général le Figuier s’arrête comme VOlivier, au
pied du Gaucase et des montagnes de l’Europe qui bordent le bassin de la
Méditerranée ; cependant il se montre encore à l’é ta t presque spontané
sur la côte S.-O. de la France,grâce à la douceur des hivers »(1). D’ailleurs,
l’ancienneté du Figuier en Europe est confirmée par les données de la Paléontologie.
Le F. Domberopsis Ung., trouvé dans les lignites miocènes do
Nidda.en Wetcravie et dans les schistes contemporains de Bilin, en
Bohème, se présente, dit M. de Saporta {Orig. P a l. des A rb .,p . 2 07), avee
les traits caractéristiques du F. carica et doit être considéré comme sou
ancêtre. Il existe encore un Ficus du type carica dans le miopliocène de
la Cerdagne, signalé pa r M,. Rérolle; mais il y a mieux, la présence constante
du F. carica, non seulement dans les travertins toscans, mais dans les
tufs quaternaires de Moret, près Fontainebleau (2), ainsi que dans ceux de
(-1) A H o s c o ir ( F i n i s t è r e ) , il e x i s t e u n p i e d c o u v r a n t e n v i r o n 5 a r e s e t â g é d e 27S a n s .
O n e n v o i t a u s s i d e t r è s b e a u x a u x e n v i r o n s d ’A r c a c b o n .
(2) D e s r e p r é s e n t a n t s d ’e s p è c e s , q u i n e v é g è t e n t p l u s a u j o u r d ’h u i q u e d a n s l e s c o n t
r é e s c h a u d e s , o n t é t é a u s s i t r o u v é s d a n s l e N , d e l ’E u r o p e , n o l a m m e u t d a n s le S . d e
l ’A n g l e t e r r e , â B o u r n e m o u t h ( d e S a p o r t a ) .
Montpellier, des Aygalados, près de Marseille, et dans le terra in quaternaire
près de Paris, établissent indisoutablement cette existence ancienne
du F. carica en Europe, ce qui est aussi d’accord avec les écrits les plus
anciens, qui nous apprennent que les Grecs et les Romains connaissaient
cet arbre depuis les temps les plus reculés de leur histoire. Le F. carica
exisle aussi aux Indes à l’état subspontané, mais n ’y p a raît pas indigène.—
Les Chinois, suivant M. de Candolle, auraien t reçu le Figuier Ae Perse
vers le VIII° siècle de notre è re. D’autre p a ri, cet arbre, grâce â la culture
et à ce fait que ses graines traversent le tube digestif de l’homme et des
animaux sans perdre leur faculté germinative, a pu facilement se propager
de proche en proche. Actuellement, la culture de cet arbre en plein air, en
dehors de la région du sud-ouest, très favorisée par le Gulfstream, ne
dépasse guère en France la région de l’Olivier; au delà il lui faut des abris
de plus en plus favorables et si on le cultive encore à Argenteuil près de
Paris, ce n’est qu’en en te rran t ses tiges, jamais plus âgées de 4-8 ans, à 80°“
sous terre pendant l’hiver.
he F iguier y'ievA sur tous les terra in s, depuis ceux pierreux-, arides et
découverts ju sq u ’aux plus frais. On reconnaît cependant que c’est dans ceux
calcaires, riches et frais, qu’il donne les meilleurs résultats, d’où l’expression
que cet arbre veut avoir « le pied dans l’eau et la tête au soleil ».
Bien que le Figuier vienne à l’état naturel sur des sols de mauvaise
qualité, qu’il repousse bien de souche et que sa croissance soit rapide, il
n ’a pas d’importance forestière, car son bois blanc-jaunâtre ou grisâtre,
mou, spongieux, riche en parenchyme, gorgé de suc laiteux, est peu fort et
peu estimé; il se pourrit aussi rapidement aux alternatives de sécheresse
et d ’humidité et ne fournit qu’un médiocre combustible. Toutefois celui du
F. sauvage, fia s dense, 0,547 à 0,716 (Mathieu), bien desséché et provenant
d ’arbres âgés, est supérieur a ce que nous venons de dire.
La grande importance du Figuier réside dans son fruit qui bien mûr est
un aliment sain, agréable, d ’une haute valeur nutritive, estimé dès la plus
haute antiquité; aujo u rd ’hui encore il constitue, frais ou desséché, la
nourriture habituelle d’une grande partie de la population de l’Europe
australe et de l’Orient; des variétés exquises le font rechercher pour les
tables les plus somptueuses. Les figues sèches forment un. article de commerce
important des centres de p roduction vers les pays d u nord. Grâce aux facilités
et à la rapidité des transports, les figues fraîches sont aussi expédiées vers
les grandes v ille s.
La végétation et la fructification du Figuier sont continues et il se passe
alors, en ce qui concerne la maturité des fruits, un phénomène rema rquable
: la pousse née au printemps ne peut développer et mûrir complètement
qu’un certain nombre des figues qu’elle porte, aelles de labase; celles du
sommet sont a rrêtées dan s leur développement p a r les premiers froids ; elles
re sten t stationnaires pendant l’hiver, rep ren n en t leur accroissement au
printemps suivant et m ûrissent au milieu de l’été sur des rameaux souvent