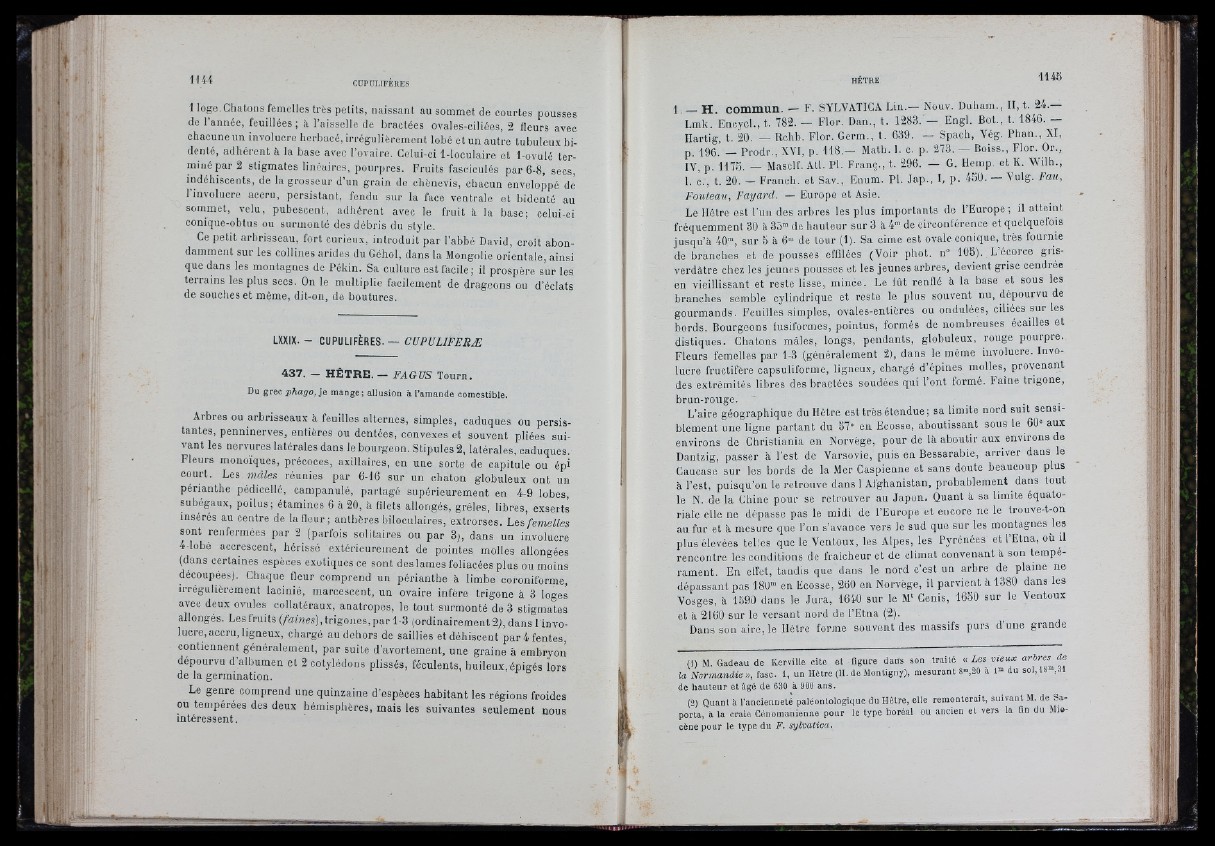
â
'
ii:
ÍT
í^ '
| í
1 loge. Chatons femelles très petits, naissant au sommet de courtes pousses
de l’année, feuillées; à l’aisselle de bractées ovales-ciliées, 2 fleurs avec
chacune un involucre herbacé, irrégulièrement lobé et un autre tubuleux bi-
denté, adhérent à la base avec l’ovaire. Celui-ci 1-loculaire et 1-ovulé terminé
par 2 stigmates linéaires, pourpres. Fruits fasciculés par 6-8, secs,
indéliiscents, de la grosseur d'un grain de cbènevis, cliacun enveloppé de
l’involucre accru, persistant, fendu sur la face ventrale et bidente au
sommet, velu, pubescent, adhérent avec le fruit à la base; celui-ci
conique-obtus ou surmonté des débris du style.
Ce petit arbrisseau, fort curieux, introduit pa r l’abbé David, croit abondamment
sur les collines arides du Géhol, dans la Mongolie orientale, ainsi
que dans les montagnes de Pékin. Sa culture est facile; il prospère sur les
terrains les plus secs. On le multiplie facilement de drageons ou d’éclats
de souches et même, dit-on, de boutures.
LXXIX. - CUPULIFÈRES.— CÜPULIFERÆ
437. - H Ê TR E . — FAGVS Tourn.
Du g r e c pA a y o , j e m a n g e ; a llu s io n à l’am ande c om e s tib le .
Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes, simples, caduques ou persistantes,
penninerves, entières ou dentées, convexes et souvent pliées suivant
les nervures latérales dans le bourgeon. Stipules 2, latérales, caduques.
Fleurs monoïques, précoces, axillaires, en une sorte de capitule ou épi
court. Les mâles réunies pa r 6-16 sur un chaton globuleux ont un
p érianthe pédioellé, campanulé, partagé supérieurement en 4-9 lobes,
subégaux, poilus; étamines 6 à 20, à filets allongés, grêles, libres, e.xseits
insérés au centre de la fleur; anthères biloculaires, extrorses. Les femelles
sont renfermées pa r 2 (parfois solitaires ou pa r 3;, dans un involucre
4 lobé accrescent, hérissé extérieurement de pointes molles allongées
(dans certaines espèces e.xotiques ce sont des lames foliacées plus ou moins
découpées). Chaque fleur comprend un périanthe à limbe coroniforme,
irrégulièrement lacinié, marcescent, un ovaire infère trigone à 3 loges
avec deux ovules collatéraux, anatropes, le tout surmonté de 3 stigmates
allongés. Les fruits (/’âmes), trigones, pa r 1-3 (ordinairement 2), dans 1 involucre,
accru, ligneux, chargé au dehors de saillies et déhiscent pa r 4 fentes,
contiennent généralement, pa r suite d ’avortement, une graine à embryon
dépourvu d’albumen el 2 cotylédons plissés, féculents, huileux, épigés lors
de la germination.
Le genre comprend une quinzaine d ’espèces hab itan t les régions froides
ou tempérées des deux hémisphères, mais les suivantes seulement nous
intéressent.
1 , H . c o m m u n . — F. SYLVATICA Lin.— Nouv. Dubam., II, t. 24.
Lmk. Encycl., t. 782. - Flor. Dan., t . 1283, - Engl. Bot., t. 1846. -
Hartig, t. 20. — Rchb. Flor. Germ., t. 639. — Spach, Vég. Phan., XI,
p, 196.’ _ Prodr., XVI, p. 118.— Malb. 1. c. p. 273. — Boiss., Flor. Or.,
IV, p. H7o. — Masclf. Atl. Pl. Franç., t. 296. — G. Ilemp. et K. Wilh.,
1. c., t. 20. — Francb. et Sav., Enum. Pl. Jap ., I, p. 450. — Vulg. F m ,
Fouteau, Fayard. — Europe et Asie.
Le Hêtre est l'iiii des arbres les plus importants de l’Europe; il atteint
fréquemment 30 à 3ô™ de hauteur sur 3 à 4" de circonférence et quelquefois
ju sq u ’à 40", sur 5 à 6" de loiir (1). Sa cime est ovale conique, très fournie
de branches et de pousses effilées (Voir pbot, n" 108). L’écorce gris-
verdàlre chez les jeunes pousses et les jeunes arbres, devient grise cendrée
en vieillissant et reste lisse, mince. Le iût renflé à la base et sous les
branches semble cylindrique et reste le plus souvent nu, dépourvu de
gourmands. Feuilles simples, ovales-entières ou ondulées, ciliées sur les
bords. Bourgeons Iiisiformes, pointus, formés de nombreuses écailles et
distiques. Chatons mâles, longs, pendants, globuleux, rouge pourpre.
Fleurs femelles par 1-3 (généralement 2), dans le même involucre. Involucre
fructifère capsuliforme, ligneux, chargé d’épines molles, provenant
des extrémités libres des bractées soudées qui l’ont formé. Faîne trigone,
brun-roiige.
L’aire géographique du Hêtre est très étendue ; sa limite nord suit sensiblement
une ligne p a rlan t du 87” en Ecosse, aboutissant sous le 6ü» aux
environs de Christiania en Norvège, pour de là aboutir aux environs de
Dantzig, passer à l’est de Varsovie, puis en Bessarabie, arriver dans le
Caucase sur les bords de la Mer Caspienne et sans doute beaucoup plus
à l’est, puisqu’on le retrouve dans 1 Afghanistan, probablement dans tout
le N. de la Chine pour se retrouver au Japon. Quant à sa limite équatoriale
elle ne dépasse pas le midi de l’Europe et encore ne le Irouve-t-on
au fur et à mesure que l’on s’avance vers le sud que su r les montagnes les
plus élevées telles que le Ventoux, les Alpes, les Pyrénées et l’Etna, où il
rencontre les conditions do fraîcheur et de climat convenant à son tempérament.
En effet, tandis que dans le nord c’est un arbre de plaine ne
dépassant pas ISU’" en Ecosse, 260 en Norvège, il parvient à 1380 dans les
Vosges, à 1890 dans le Jura, 1610 sur le M' Genis, 1650 sur le Ventoux
et à 2160 sur le versant nord de l’Etna (2).
Dans son aire, le Hêtre forme souvent des massifs purs d’une grande
(1) M. Gadeau d e K erv ille c it e e t figu r e dans son tra ité « L e s v i e u x a r b r e s d e
la N o rm a n d i e » , fa sc . 1, un Hêtre (H. d e Montigny), m esu r an t 8” ,20 à 1“ du soIjISbi^SI
d e h a u teu r e t â g é de 630 à 900 a n s .
(2) Quant à l ’a n c ien n e té p a léon to lo g iq u e du Hêtre, e lle r em on te ra it, su iv a n t M. de Sa-
p o r la , â la c ra ie Cénom an ien n e p our le type boréal ou ancien e l vers la fin du Mioc
èn e p our le typ e du F. s y lv a t ic a .