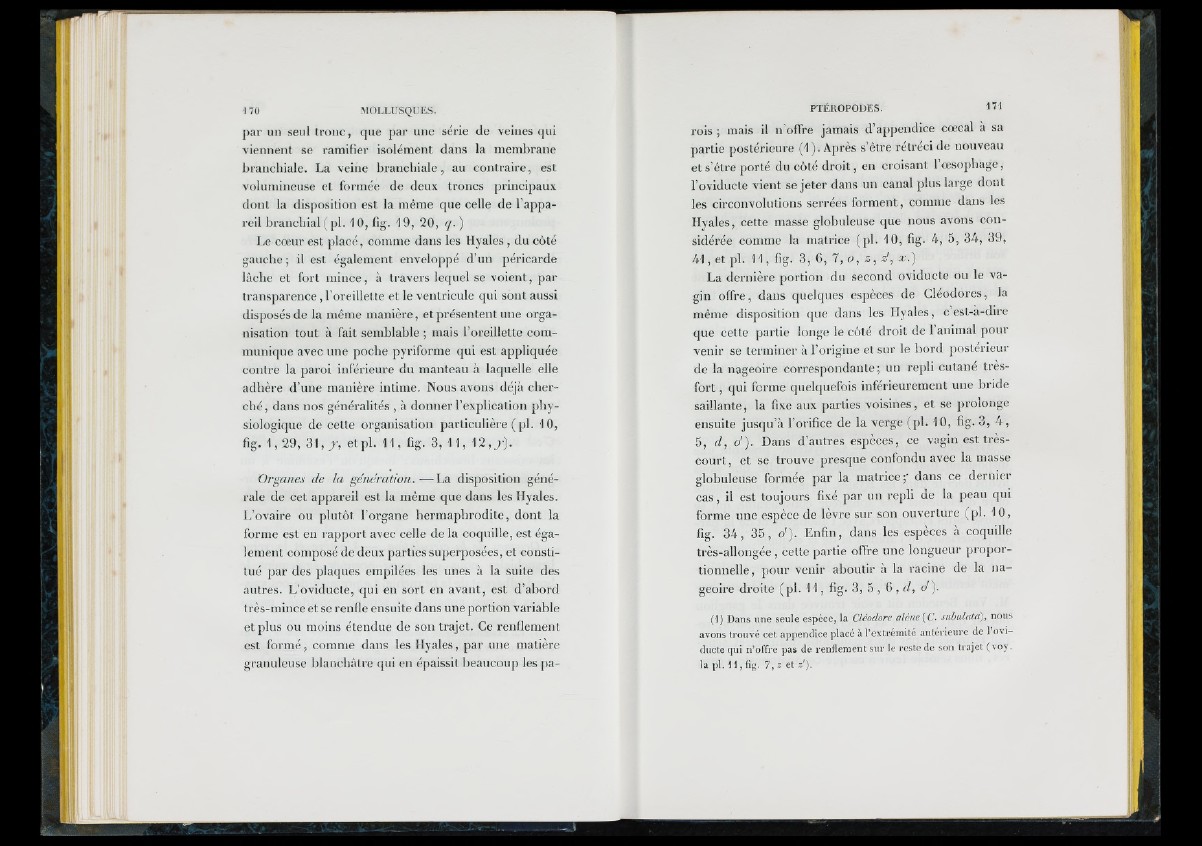
j>ar uu seul troue, que jiar une série de veines <|ui
viennent se ramifier isolément dans la membrane
brancbiale. La veine brancbiale, au contraire, est
volumineuse et formée de deux troues principaux
donl la disjiosition est la même que celle de l’appareil
brancbial (pl. 10, fig. 19, 20, q .)
Le coeur est [ilacé, comme dans les llyales , du côté
gauche ; il est également enveloppé d’un péricarde
lâche el fort mince, à travers lequel se voient, par
Iransparence, l’oreillette el le ventricule qui sont aussi
disjiosés de la même manière, et jirésenlent une organisation
tout à fait semblable ; mais l’oreillette communique
avec une pocbe pyriforme qui est appliquée
contre la jiaroi inférieure du manteau à laquelle elle
adhère d’une manière intime. Nous avons déjà cherché,
dans nos généralités , à donner l’exjilicalion physiologique
de celle organisation particulière ( pl. 10,
fig. 1, 29, 31, 7 , etjil. 11, fig. 3, 11, 12, j ) .
Organes de la génération. —-'La disposition générale
de cet appareil est la même que dans les Hyales.
L’ovaire ou plutôt l’organe hermaphrodite, dont la
forme est eu rapport avec celle de la coquille, est également
composé de deux parties superposées, et constitué
Jiar des plaques empilées les unes à la suite des
autres. L'oviducle, qui en sort en avant, est d’abord
très-mince et se renfle ensuite dans une portion variable
et plus ou moins étendue de son trajet. Ce renflement
est formé, comme dans les Hyales, par une matière
granuleuse blanchâtre qui en épaissit beaucoiqi les jiarois
; mais il n’offre jamais d’ajipendice coe'cal a sa
parlie postérieure (1). Après s’être rétréci de nouveau
et s’être jiorlé du côté droit, en croisant l’oesopbage,
l’oviducte vient se jeter dans uu canal jilus large dont
les circonvolutions serrées forment, comme dans les
Hyales, celte masse globuleuse que nous avons considérée
comme la matrice (pl. 10, %. 4, 5, 34, 39,
41, et pl. 11, fig. 3, 6, 7 , 0 , z, z', x. )
La dernière portion du second oviducte ou le vagin
offre, dans quelques espèces de Cléodores, la
même disposition (jue dans les Hyales, c’esl-a-dire
que cette partie longe le côté droit de l’animal pour
venir se lerminer à l’origine et sur le bord jiostérieur
de la nageoire correspondante; un rejili cutané très-
fort , qui forme quelquefois inférieuremeul une bride
saillante, la fixe aux parties voisines, et se prolonge
ensuite jusqu’à l’orifice de la verge (pl. 10, fig. 3, 4 ,
5, d, d) . Dans d’autres espèces, ce vagin est très-
court, et se trouve presque confondu avec la masse
globuleuse formée par la matrice;' dans ce dernier
cas, il est toujours fixé par im repli de la peau qui
forme une espèce de lèvre sur son ouverture (pl. 10,
fig. 3 4 , 3 5 , d) . Enfin, dans les espèces à coquille
très-allongée , celte partie offre une longueur proportionnelle,
jionr venir aboutir à la racine de la nageoire
droite (pl. 11, fig. 3, 5 , , d, d).
(t) Dans une seule espi-ce, la Cléodore alêne [C. suhidatn), nous
avons trouvé cet appendice ptacé à l’extrémité antérieure de l’ovi-
dticte qui n’offre pas de renflement sur le reste de son trajet (voy.
la pl. ■H , iig- 7, s et s').