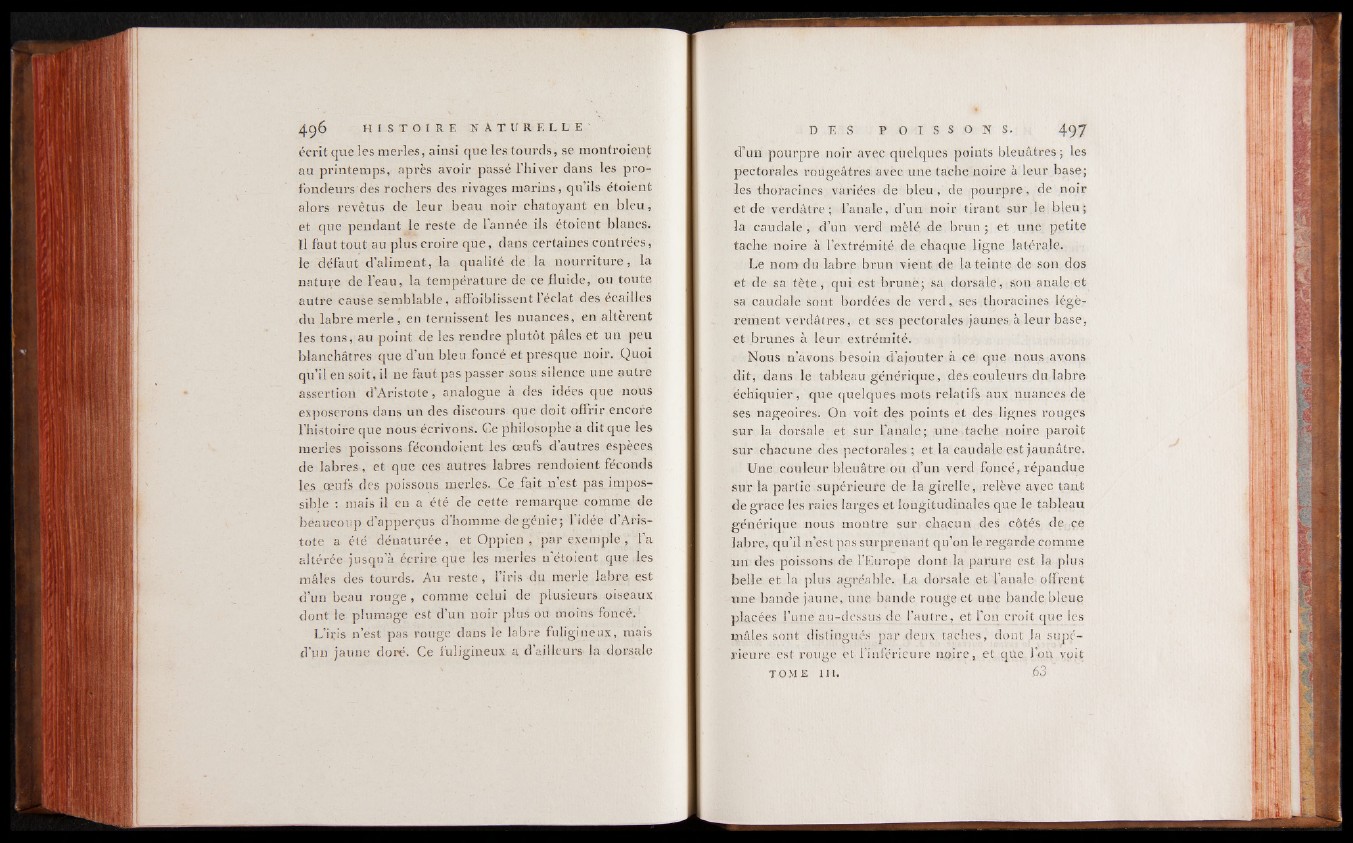
4 9 6 H I S T O I R E N A T U R E L L E
écrit que les merles, ainsi que lestourds, se montroient
au printemps, après avoir passé l’hiver dans les profondeurs
des rochers des rivages marins, qu’ils étoient
alors rèvêtus de leur beau noir chatoyant en bleu,
et que pendant le reste de l’année ils étoient blancs.
Il faut tout au plus croire que, dans certaines contrées,
le défaut d’aliment, la qualité de la nourriture, la
nature de l’eau, la température de ce fluide, ou toute
autre cause semblable, afFoiblissent l’éclat des écailles
du labrémerle, en ternissent les nuances, en altèrent
les tons, au point de les rendre plutôt pâles et un peu
blanchâtres que d’un bleu foncé et presque noir. Quoi
qu’il en soit, il ne faut pas passer sous silence une autre
assertion d’Aristote, analogue à des idées que nous
exposerons dans un des discours que doit offrir encore
l’histoire que nous écrivons. Ce philosophe a dit que les
merles poissons fécondoient les oeufs d’autres espèces
de labres, et que ces autres labres rendoient féconds
les oeufs des poissons merles. Ce f^i.t n’est pas impossible
: mais il en a été de cette remarque comme de
beaucoup d’apperçus d'homme de génie; l’idée d’Aristote
a été dénaturée, et Oppien , par exemple,' l’a
altérée jusqu’à écrire que les merles n’étoient que les
mâles des tourds. Au reste, l’iris du merle labre, est
d’un beau rouge, comme celui de plusieurs oiseaux
dont le plumage est d’un noir plus ou moins foncé.1
L’iris n’est pas rouge dans le labre fuligineux, mais
d’un jaune doré. Ce fuligineux a d’ailleurs' la dorsale
D E S P O I S S O N S . 4 9 7
d’un pourpre noir avec quelques points bleuâtres; les
pectorales rougeâtres avec une tache noire à leur base;
les thoracines variées de bleu, de pourpre, de noir
et de verdâtre; l ’anale, d’un noir tirant sur le bleu;
la caudale, d’un verd mêlé de brun ; et une petite
tache noire à l’extrémité de chaque ligne latérale.
Le nom du labre brun vient de la teinte de son dos
et de sa tête , qui est brune; sa dorsale, sou anale et
sa caudale sont bordées de verd, ses thoracines légèrement
verdâtres, et ses pectorales jaunes à leur base,
et brunes à leur extrémité.
Nous n’avons besoin d’ajouter à ce que nous axmns
dit, dans le tableau générique., des couleurs du labre
échiquier, que quelques mots relatifs aux nuances de
ses nageoires. On voit des points et des lignes rouges
sur la dorsale et sur l’anale; une tache noire paroît
sur chacune des pectorales ; et la caudale est jaunâtre.
Une, couleur bleuâtre ou d’un verd foncé, répandue
sur la partie supérieure de la girelle, relève avec tant
de grâce les raies larges et longitudinales que le tableau
générique nous montre sur chacun des côtés de ce
labre, qu’il n’est pas surprenant qu’on le regarde comme
un des poissons de l’Europe dont la parure est la plus
belle et la plus agréable. La dorsale et l’anale offrent
une bande jaune, une bande rouge et une bande bleue
placées l’une au-dessus de l’autre, et l’on croit que les
mâles sont distingués par deux taches, dont la supérieure
est rouge et l’inférieure noire, et que l’on voit
t o m e l i t . 63