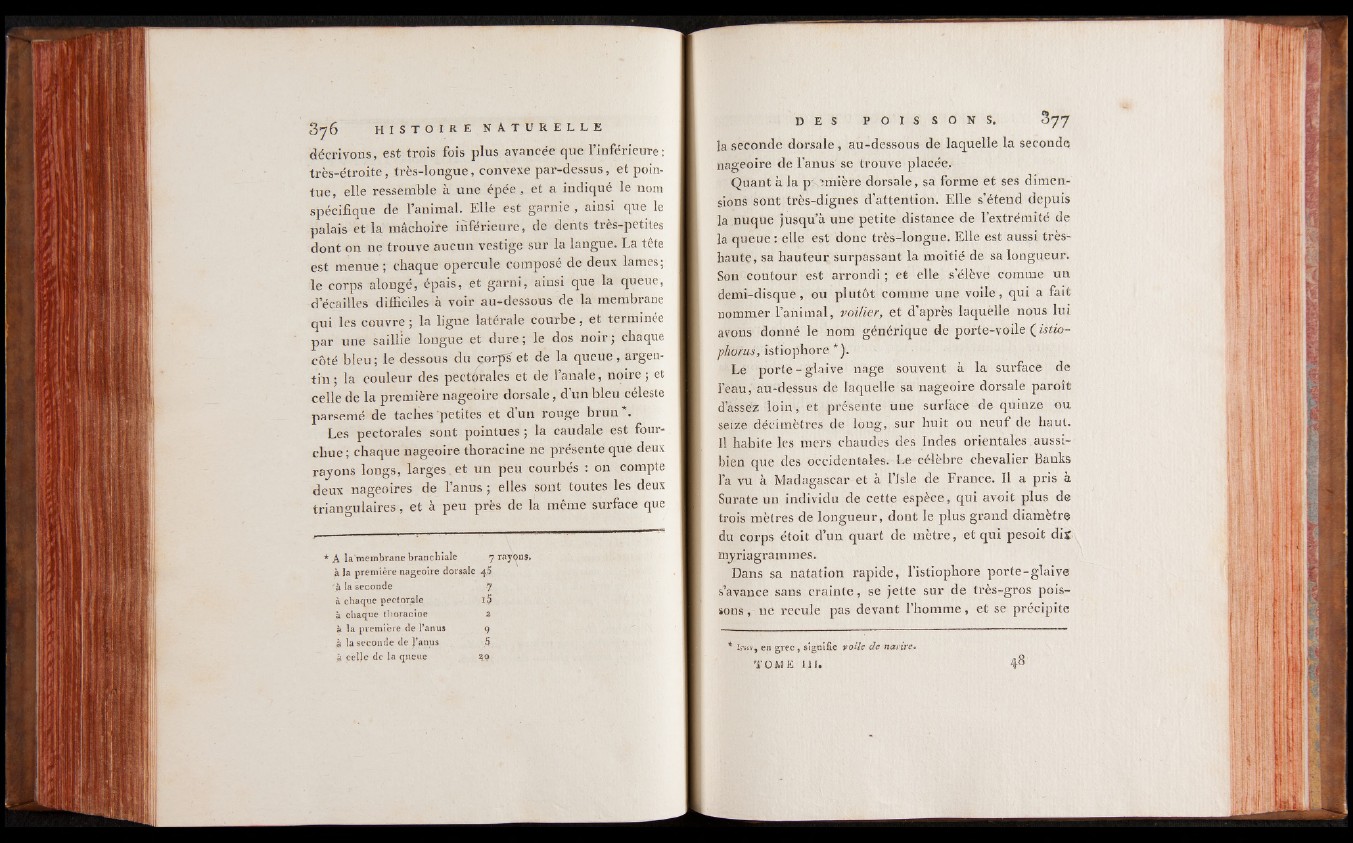
décrivons, est trois fois plus avancée que l’inférieure:
très-étroite, très-longue, convexe par-dessus, et pointue,
elle ressemble à une épée, et a indiqué le nom
spécifique de l’animal. Elle est garnie , ainsi que le
palais et la mâclioife inférieure, de dents très-petites
dont on ne trouve aucun vestige sur la langue. La tete
est menue ; chaque opercule composé de deux lames;
le corps alongé, épais, et garni, ainsi que la queue,
d’écailles difliciles à voir au-dessous de la membrane
qui les couvre ; la ligne latérale courbe, et terminée
par une saillie longue et dure ; le dos noir ; chaque
côté bleu ; le dessous du çorps et de la queue , argentin;
la couleur des pectôrales et de l’anale, noire; et
celle de la première nageoire dorsale, d un bleu celeste
parsemé de taches petites et d’un rouge brun*.
Les pectorales sont pointues ; la caudale est fourchue;
chaque nageoire thoracine ne présente que deux
rayons longs, larges et un peu courbés : on compte
deux nageoires de l’anus ; elles sont toutes les deux
triangulaires, et à peu près de la même surface que
A la membrane branchiale 7
à la première nageoire dorsale 4S
'à. la seconde 7
à chaque pectorale i 5
à chaque thoracine 2
à la première de l’anus 9
à la seconde de l’anus ß
à celle de la queue 39
D E S PP OO II SS S SOONNSS .. 3 7 7
la seconde dorsale , au-dessous de laquelle la seconde
nageoire de l’anus se trouve placée.
Quant à la ptomière dorsale, sa forme et ses dimensions
sont très-dignes d’attention. Elle s’étend depuis
la nuque jusqu’à une petite distance de l’extrémité de
la queue : elle est donc très-longue. Elle est aussi très-
haute, sa hauteur surpassant la moitié de sa longueur.
Son contour est arrondi ; et elle s’élève comme un
demi-disque, ou plutôt comme une voile, qui a fait
nommer l’animal, voilier, et d’après laquèlle nous lui
avons donné le nom générique de porte-voile (istio-
phorus, istiophore *).
Le porte-glaive nage souvent à la surface de
l’eau, au-dessus de laquelle sa nageoire dorsale paroît
d’assez loin, et présente une surlàce de quinze ou
seize décimètres de long, sur huit ou neuf de haut.
bien que des occidentales. Le célèbre chevalier Banks
l’a vu à Madagascar et à l’Isle de France. Il a pris à
Surate un individu de cette espèce, qui avoit plus de
trois mètres de longueur, dont le plus grand diamètre
du corps étoit d’un quart de mètre, et qui pesoit diï
myriagrammes.
Dans sa natation rapide, l’istiophore porte-glaive
s’avance sans crainte, se jette sur de très-gros poissons,
ne recule pas devant l’homme, et se précipite
* Ir*6v, en grec, signifie voile de navire*