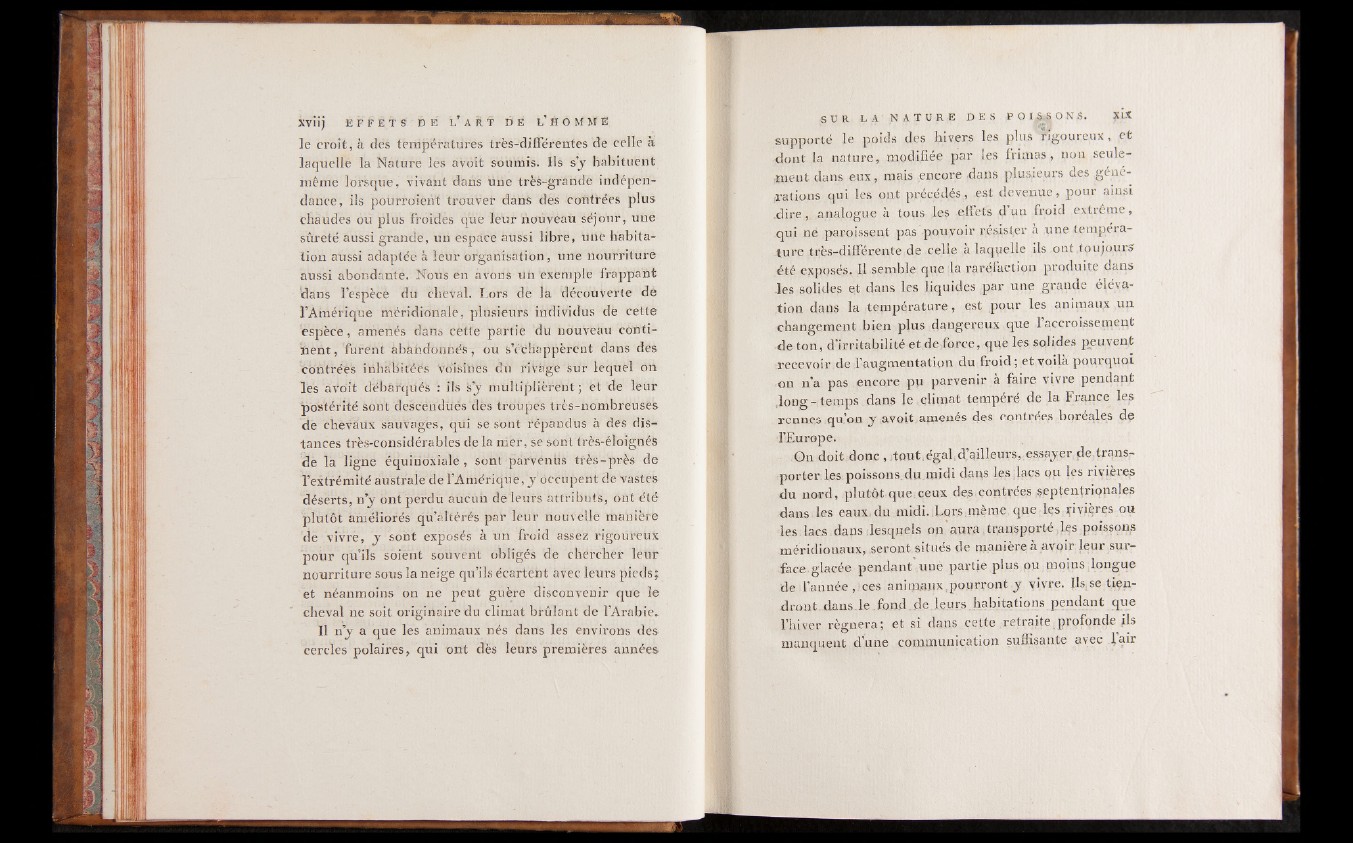
X v iij E F F E T S DE 1.’ ART D É l ’ HOMME
le croit, à des températures très-différentes de celle à
laquelle la Nature les avôit soumis. Ils s’j habituent
même lorsque, vivant dans une très-grande indépendance,
ils pourroieiit trouver dans des contrées plus
chaudes ou plus froides que leur nouveau séjour, une
sûreté aussi grande, un espace aussi libre, une habitation
aussi adaptée à leur organisation, une nourriture
aussi abondante. Nous en avons uh exemple frappant
dans l’espèce du cheval. Lors de la découverte de
l’Amérique méridionale, plusieurs individus de cette
espèce, amenés dans cette partie du nouveau continent,
furent abandonnés, ou s’échappèrent dans des
contré'eis inhabitéés Voisines du rivage sur lequel on
lès àvôit débarqués : ils s’j multiplièrent ; et de leur
postérité sont descéndués dés troupes très-nombreuses
de chevaux sauvages, qui se sont répandus à des distances
très-considérables delà mer, se sonttrès-éloignés
de la ligne équinoxiale, sont parvenus très-près de
l’extrémité australe de l’Amérique,y occupent de vastes
désérts, n y ont perdu aucun de leurs attributs, ont été
plutôt améliorés qu’altérés par leur nouvelle manière
de vivre, y sont exposés à un froid assez rigoureux
pour qu’ils soient souvent obligés de chercher leur
nourriture sous la neige qu’ils écartent aVec leurs pieds;,
et néanmoins on ne peut guère disconvenir que le
cheval ne soit originaire du climat brûlant de l’Arabie»
Il n j a que les animaux nés dans les environs des.
cercles polaires, qui ont dès leurs premières années
SUR LA' NATURE DES P O I S ƒ O NS.
supporté le poids des hivers les plus rigoureux, et
dont la nature, modifiée par les frimas, non seulement
dans eux, mais encore dans plusieurs des générations
qui les ont précédés) est devenue, pour ainsi
.dire, analogue à tous les effets dun froid extreme,
qui né paroissent pas pouvoir résister à une température
très-différente de celle à laquelle ils ont toujours
été exposés. Il semble que fa raréfaction produite dans
-les solides e,t dans les liquides par une grande élévation
dans la température, est pour les animaux un
changement bien plus dangereux que l’accroissement
de ton, d’irritabilité et deforce, que les solides peuvent
recevoir de l’augmentation du froid; et voilà pourquoi
on n’a pas encore pu parvenir à faire vivre pendant
.long- temps dans le climat tempéré de la France les
rennes qu’on y avoit.amenés des contrées boréales de
l’Europe.
On doit.donc, itout,égal,d’qilleurs, essayer dedrqns-
porter les poissons.du.midi daqs les lacs qp les rivières
du nord, plutôt que.ceux de,s contrées septentrionales
dans les eaux,du midi.,Lors.même que Iqs,Rivières ou
les : lacs. daps desquels on aura .transporté les poissons
méridionaux, seront situés de manière à avoir leur surface
ofacée pendant unè partie plus pu moins longue
de l’année ,i ces animaux,pourront .y vivre. IlSjSe tien-
dront. dans.le .fond.de.leurs. habitations pendant que
l’hiver régnera; et si dans cette retraite:profonde jls
manquent d’une communication suffisante avec 1 air