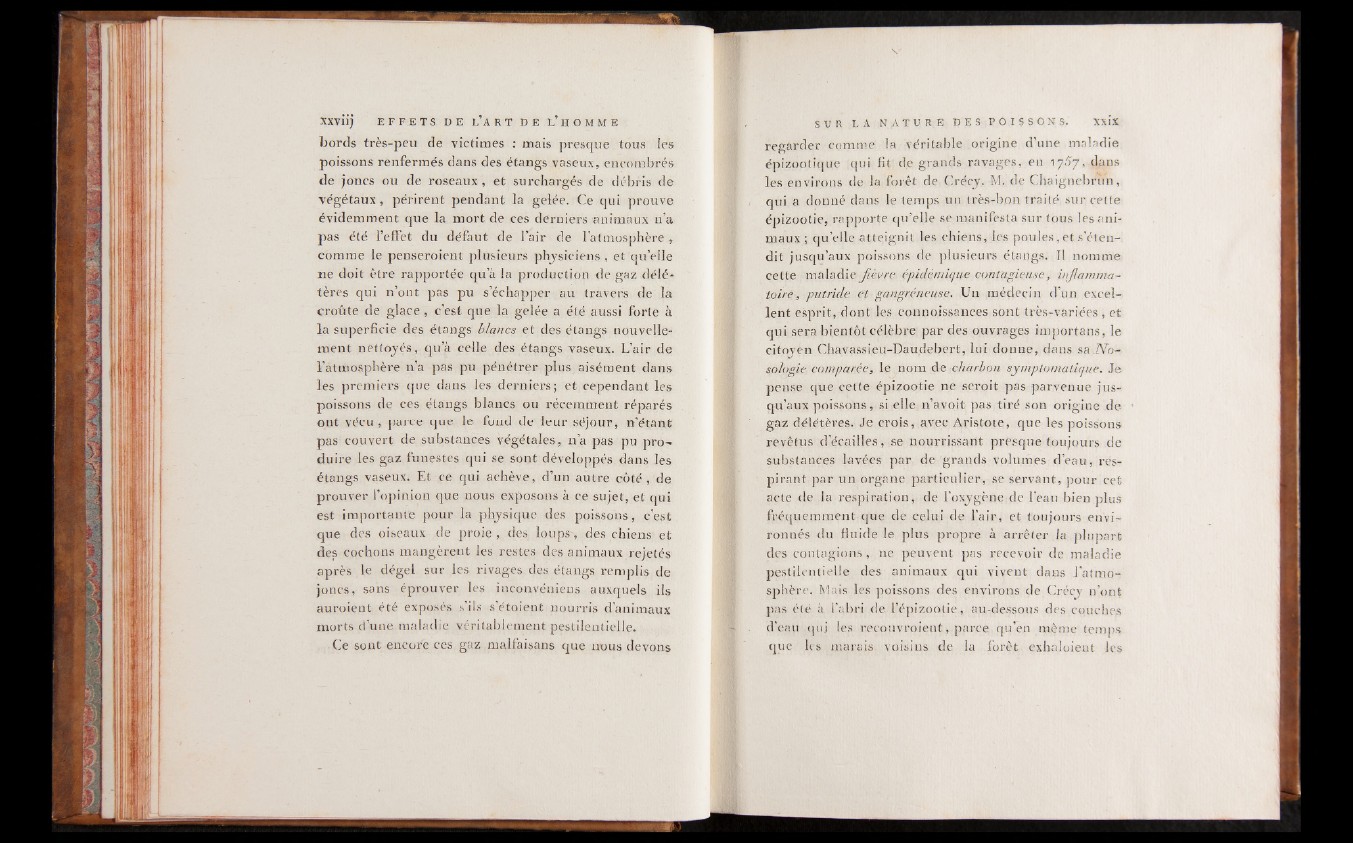
XXVÜj E F F E T S D E l ’A R T D E ^ H O M M E
bords très-peu de victimes : mais presque tous les
poissons renfermés dans des étangs vaseux, encombrés
de joncs ou de roseaux, et surchargés de débris de
végétaux, périrent pendant la gelée. Ce qui prouve
évidemment que la mort de ces derniers animaux n’a
pas été l’effet du défaut de l’air de l’atmosphère ,
comme le penseroient plusieurs phjsiciens , et qu’elle
ne doit être rapportée qu’à la production de gaz délétères
qui n’ont pas pu s’échapper au travers de la
croûte de glace, c’est que la gelée a été aussi forte à
la superficie des étangs blancs et des étangs nouvellement
nettoyés, qu’à celle des étangs vaseux. L’air de
l’atmosphère n’a pas pu pénétrer plus aisément dans
les premiers que dans les derniers; et cependant les
poissons de ces étangs blancs ou récemment réparés
ont vécu, parce que le fond de leur séjour, n’étant
pas couvert de substances végétales, n’a pas pu produire
les gaz funestes qui se sont développés dans les
étangs vaseux. Et ce qui achève, d’un autre côté, de
prouver l’opinion que nous exposons à ce sujet, et qui
est importante pour la physique des poissons, c’est
que des oiseaux de proie , des loups-, des chiens et
des cochons mangèrent les restes des animaux rejetés
après le dégel sur les rivages des étangs remplis de
joncs, sans éprouver les inconvéniens auxquels ils
auroient été exposés s’ils s’étoient nourris d’animaux
morts d’une maladie véritablement pestilentielle.
Ce sont encore ces gaz malfaisans que nous devons
SUR LA NATURE DES POISSONS. ' XXÎX
regarder comme la véritable origine d’une maladie
épizootique qui fit de grands ravages, en 1757, dans
les environs de la forêt de Crécy. M. de Chaignebrûn,
qui a donné dans le temps un très-bon traité sur cette
épizootie, rapporte qu’elle se manifesta sur tous les animaux;
qu’elle atteignit les chiens, les poules, et s’étendit
jusqu’aux poissons de plusieurs étangs. Il nomme
cette maladie fièvre épidémique contagieuse, inflammatoire,
putride et gangréneuse. Un médecin d’un excellent
esprit, dont les connoissances sont très-variées , et
qui sera bientôt célèbre par des ouvrages importans, le
citoyen Chavassieu-Daudebert, lui donne, dans sa ./Vo-
sologie comparée, le nom de charbon symptomatique. Je
pense que cette épizootie ne seroit pas parvenue jusqu’aux
poissons, si elle n’avoit pas tiré son origine de
gaz délétères. Je crois, avec Aristote, que les poissons
revêtus d’écailles, se nourrissant presque toujours de
substances lavées par de grands volumes d’eau, respirant
par un organe particulier, se servant, pour cet
acte de la respiration, de l’oxygène de l’eau bien plus
fréquemment que de celui de l’air, et toujours environnés
du fluide le plus propre à arrêter la plupart
des contagions, ne peuvent pas recevoir de maladie
pestilentielle des animaux qui vivent dans l’atmosphère.
Mais les poissons des environs de Crécy n’ont
pas été à l’abri de l’épizootie, au-dessous des couches
d’eau qui les recouvroient, parce qu’en même temps
que les marais voisins de la forêt exhaloient les