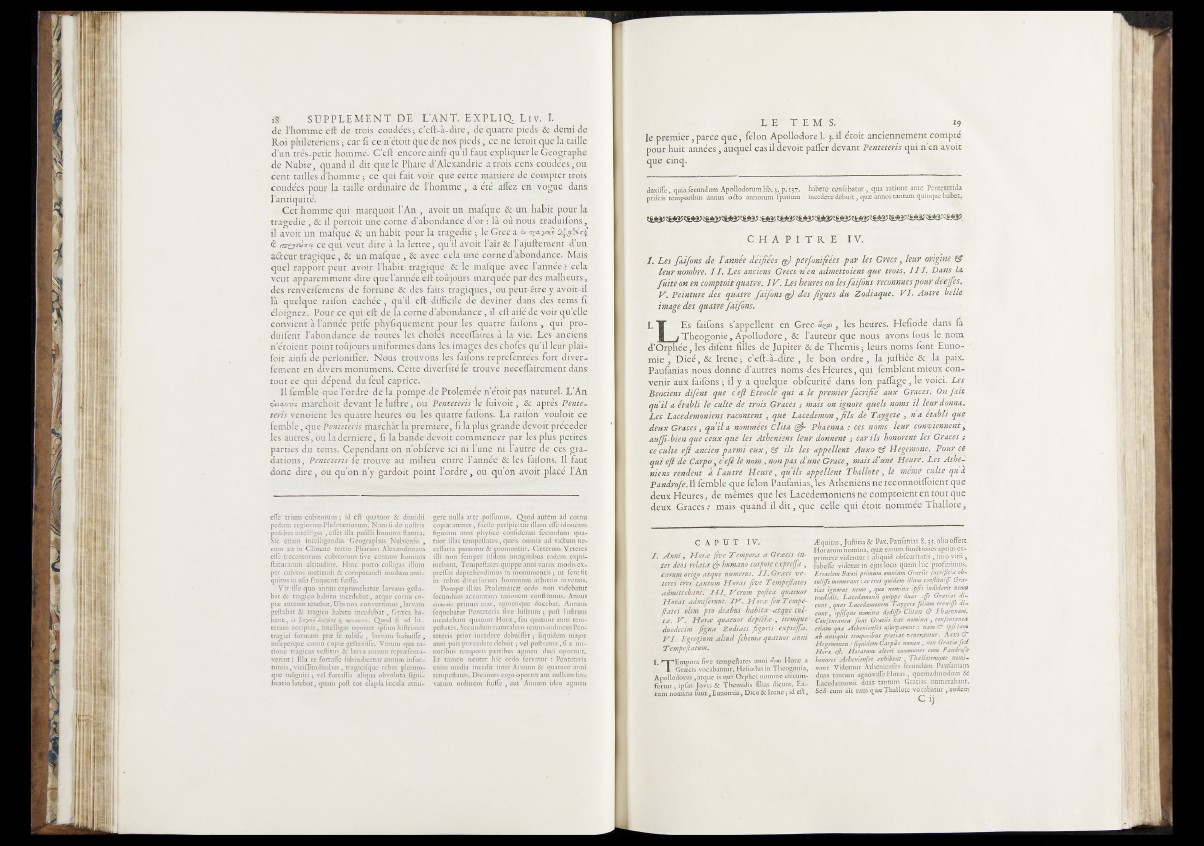
m SUP P L EMENT DE L’A N T. EXPL IQ^L i v . L
de l’homme eft de trois coudées; c’eft-à-dire, de quatre pieds & demi de
Roi phileteriens ; car fi ce n’étoit que de nos pieds, ce ne ieroit que la taille
d’un très-petit homme. C’eft encore ainfi qu’il faut expliquer le Géographe
de Nubie , quand il dit que le Phare d’Alexandrie a trois cens coudées, ou
cent tailles d’homme ; ce qui fait voir que cette maniéré de compter trois
coudées pour la taille ordinaire de l’homme , a été allez en vogue dans
l’antiquité.
Cet homme qui marquoit l’An , avoit un mafque & un habit pour la
tragédie , & il portoit une corne d’abondance d’or : là où nous traduifons ,
il avoit un malque & un habit pour la tragédie ; le Grec a 4» Tfayiiôi
<c asçymira ce qui veut dire à la lettre, qu’il avoit l’air & l’ajuftement d’un
acteur tragique, & un mafque , & avec cela une corne d’abondance. Mais
quel rapport peut avoir l’habit tragique & le mafque avec 1 année ; cela
veut apparemment dire que l’année eft toujours marquée par des malheurs,
des renverfèmens de fortune &c des faits tragiques, ou peut-être y avoit-il
là quelque railbn cachée, qu’il eft difficile de deviner dans des tems fi
éloignez. Pour ce qui eft de la corne d’abondance , il eft aife de voir qu’elle
convient à l’année prife phyfiquement pour les quatre faifons , qui pro-
duifent l’abondance de toutes les chofesT neceffaires -à la vie. Les anciens
n’étoient point toujours uniformes dans les images des chofes qu’il leur plai-
foit ainfi de perfonifier. Nous trouvons les faifons reprefente'es fort diver-
fement en divers monumens. Cette diverfité fe trouve neceffairement dans
tout ce qui dépend du feul caprice.
Il femble que l’ordre de la pompe de Ptolemee n’étoitpas naturel, L’An
mihdhIî marchoit devant le luftre, ou Penteteris le fuivoit, & après P e n te -
te ris venoienc les quatre heures ou les quatre faifons. La raifon vouloir ce
femble, que Penteteris marchât la première, fi la plus grande devoit précéder
les autres, ou la derniere, fi la bande devoit commencer par les plus petites
parties du tems. Cependant on n’obferve ici ni l’une ni l’autre de cés gradations,
Penteteris le trouve au milieu entre l’année & les faifons. U faut
donc dire, ou qu’on n’y gardoit point l’ordre, ou qu’on avoit placé l’An
efie rrium cubitorum ; id eft quatuor 8c dimidii
pedum regiorum Philetæriorum. Nam fi de noftris
pedibus inteiiigas , eflèt ilia pufilli hominis ftatura.
Sic etiam intelligendus Geographus Nubienfis ,
cum ait in Climate tertio Pharum Alexandrinam
elle trecentorum cubitorum five centum hominis
ftaturarum altitudine. Hinc porro colligas ilium
per cubitos metiendi & computandi modum antiquitus
in ufu frequenti fui fie.
Vir ille quo annus exprimebatur larvam gefta-
bat & tragico habitu incedebat, atque cornu copia*
aureum tenebat. Ubi nos convertimus, larvam
geftabat & tragico habitu incedebat, Græca ha-
bent, 'fci.y/S <S)o.%Îit4 £) 'tspoaà'Tra;. Quod fi ad lit-
teram accipias, inteiiigas oportet ipfum hiftrionis
tragici formam præ fe tulifiè , larvam habuifte,
inluperque cornu copiæ geftavifie. Vcrum qua ra-
tione tragicus veftitus 8c larva annum repræfenta-
verint ? Ilia re fortafie fubindicetur annum infor-
tuniis, vicifiitudinibus, tragicifque rebus plerum-
ue infigniri $ vel fortaflis aliqua obvoluta figni-
catio latebat, quam poft tot elapfa fiecula attingere
nulla arte poflumus. Quod autcm ad cornu
copiæ attinet, facile perfpicitür illam effè idoneam
figuram anni phyfice confiderati fecundum quatuor
illas tempeftates, queis omnia ad vi6bum ne-
ceflaria parantur 8c promuntur. Cæterum Veteres
illi non femper iifdem imaginibus eadem expri-
mebant. Tempeftates quippe anni variis modisex-
prefias deprehendimus in monumentis ; ut fere fit
in rebus diverforum hominum àrbitrio inventis.
Pompæ illius Ptolemaïcæ ordo non videbatur
fecundum accuratam rationem conftitutus. Annus
cmhuj'to< primus erat, agmenque ducebat. Annum
fequebatur Penteteris five luftrum ; poft luftrum
incedebant quatuor Horæ, feu quatuor anni tempeftates.
Secundum naturalem rerum ordinem Penteteris
prior incedere debuiftet ; fiquidem major
anni pars præcedere debuit ; vel poftrema, fi a mi-
noribus temporis partibus agmen duci oportuit.
Et tamen neuter hic ordo fervatur : Penteteris
enim media incedit inter Annum 8c quatuor anni
tempeftates. Dicamus ergo oportetaut nullum fer-
vatum ordinem fuifiè , aut Annum ideo agmen
le premier, parce que, félon Apollodore L 3. il etoit anciennement compte
pour huit années, auquel cas il devoit paffer devant Penteteris qui n’en avoit
que cinq.
duxilTe, quia fecundum ApoilodorumlibCj.p. 137. habere cenfebatur , qua ratione ance Pentecerida
prifcis temporibus annus odto anr.oruns fpàtium incedere debuic, quæ annos tantum quinque habec,
C H A P I T R E IV.
/. Les Jaifons de l ’année déifiées fg) perfonifiées p a r les Grecs, leur origine Eÿ
le u r nombre. I I . L e s anciens Grecs r i en a dmettaient que trois. I I I . Dans la.
fu i t e on en comptoit quatre. I V . Les heures ou le sfa ifo n s reconnues p o u r déejfes.
V . Pe in tu re des quatre fa ifo n s ç f des fighes d u Z o d ia q u e. V I . A u tre belle
image des quatre fa ifo n s .
I. T Es faifons s’appellent en Grec «gju, les heures. Hefiode dans fa
| t Theogonie, Apollodore, & l’auteur que nous avons fous le nom
d’Orphée, les difent filles de Jupiter & de Thémis ; leurs noms font Euno-
mie , Dicé, & Irene; c’eft-à-dire , le bon ordre, la juftice & la paix.'
Paufanias nous donne d’autres noms des Heures, qui femblent mieux convenir
aux faifons ; il y a quelque obfcurité dans fon paffage, le voici. Les
Beociens d ife n t que c e ft Eteocle q u i a le prem ier fa c r ifié a u x Grâces. On f a i t
q u ’i l a éta b li le culte de trois Grâces j mais on ignore quels noms i l leur donna.
L e s Lacedemoniens r a c o n te n t, que Lac e dem o n , f i l s de Taygete , n a éta b li que
d e u x Grâces, q u ’i l a nommées C lita ( f r phaenna : ces noms le u r co n v ien n en t,
aujfi-bien que ceux que les Athéniens leu r d o n n e n t, car ils honorent les Grâces
ce culte eft ancien p a rm i e u x , ils les appellent A u xo & Hegemone. Po u r ce
q u i eft de Carpo, c eft le nom , non p a s d ’une Grâce, mais d ’une Heure. L e s Ath éniens
rendent ü l ’autre H e u r e , q u ’ils appellent T h a llo te , le même culte quà,
Pa.ndrofe.Vt femble que félon Paufanias, les Athéniens ne reconnoiffoient que
deux Heures, de mêmes que les Lacedemoniens ne comptoient en tout que
deux Grâces ; mais quand il d it, que celle qui étoit nommée Thallote,
C A P U T IV.
/ . Anni y Horæ five Tempora a Gratis inter
deos relata & humano corpore expreß'a,
earum origo atque numerus. IJ. Græci ve-
teres tfes^tantum Uoras five Tempefiates
admittebantl''IJJ.V'erum poftea quatuor
Uoras a dmiferuutTlJ^^Ho roe fieu T empefiates
olim pro de abus habita^ Atque cul-
ta. V . Uora quatuor dcpiïla , itemqiie
duodecim figna Zodiaci figuris exprèjfia.
y i . Egregium aliud fichema quatuor anni
Tempefiatum.
I. ^T^Empora five tempeftates anni «V‘ Horæ a
J. Græcis vocabantur. Hefiodus in Theogonia,
Apollodorus , atque is qui Orphei nomme circum-
fertur, ipfas Jovis 8c Themidis filias dicunt. Earum
nomina lunt, Eunomia, Dice 8c Irene j id eft,
Æquitas, Juftitia 8c Pax. Paufanias S. 35. alia offert
Horarum nomina, quæ earum fimôtiones aptius ex-
primere videntur : aliquid obfcuritatis , imo vim ,
fubefie videturin ejus loco quem hic proferimus.
Etcoclcm Boeoti primmn omnium Gratiis facrificia ob~
tulipe memorant : actres c/aidem ilium conflituijfc Grattas
ignorât nemo , cjua nomina ipfis indiderit nemo
tradidit. Lacedamonii quippe duas cffe Gratias dicunt
, quas haced&monem Taygeta filium erexifle dicunt
, ipfifque nomina dedifle Clitan 0 “ Phaennam.
Confentanea funt Gratiis hac nomina confentanea
etiam qua Athenienfes ufurparunt : nam & ipfi jam
ab ami qui s temporibus gratias vénérant ur, Auxo &
Hegemonen : fiquidem Carpus nomen, non Gratia fed
Hora efl. Horarum alteri communes cum Pandrofo
honores Athenienfes exhibent , Thallotemque noms-
, nant Videntur Athenienfes fecundum Paufaniam
duas tantum agnovifle Horas, quemadmodum 8C
Lacedæmonii duas tantum Gratias numerabanc,
Sed cum ait earn quæ Thallote vocabatur , eodem
m