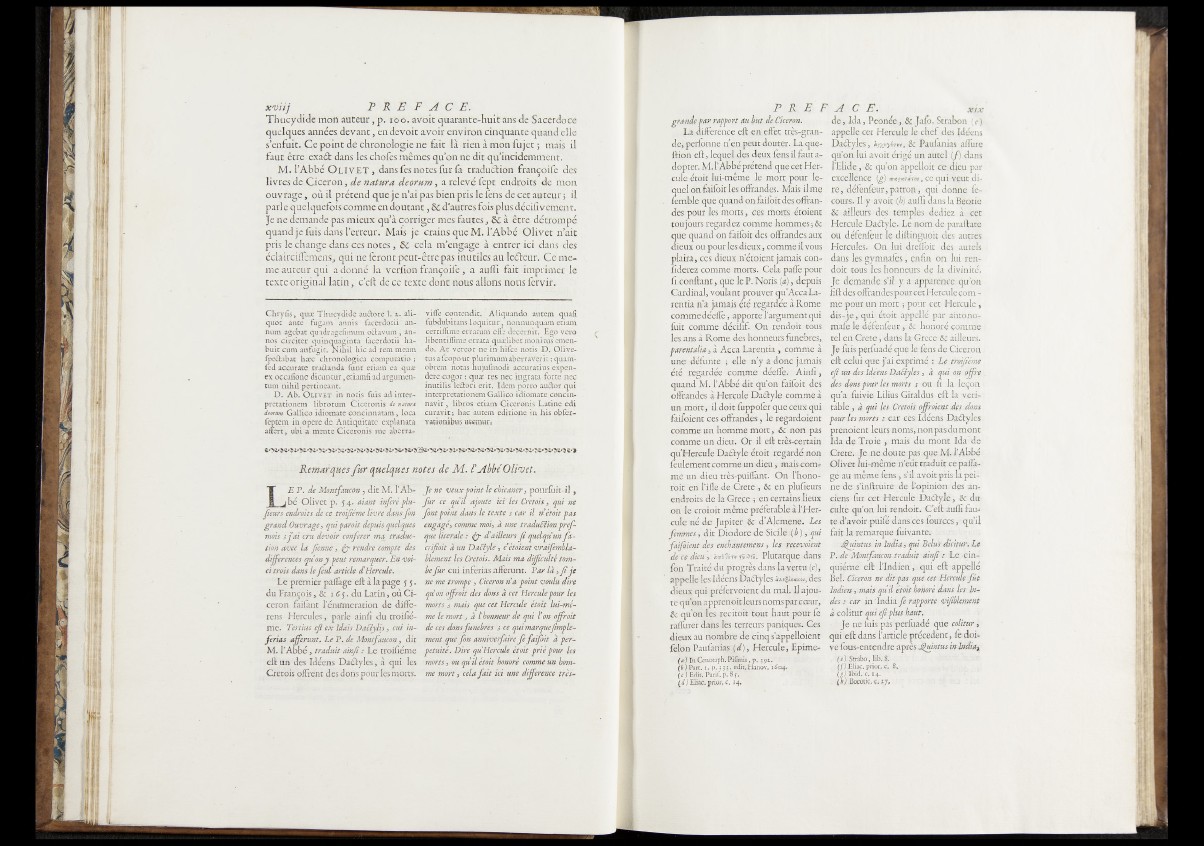
xviij P R E F A C E .
Thucydide mon auteur, p. ioo. avoit quarante-huit ans de Sacerdoce
quelques années devant, en devoit avoir environ cinquante quand elle
s’enfuit. Ce point dé chronologie ne fait là rien à mon fujet ; mais il
faut être exaél dans les chofes mêmes qu’on ne dit qu’incidemment.
M. l’Abbé OLIVET, dans fes notes fur fa traduction françoife des
livres de Cicéron, de natura deorum, a relevé fept endroits de mon
ouvrage, où il prétend que je n'ai pas bien pris le fens de cet auteur -, il
parle quelquefois comme en doutant, &C d’autres fois plus décilivement.
Je ne demande pas mieux qu’à corriger mes fautes, ôè à être détrompé
quand je fuis dans l’erreur. Mais je crains que M. l’Abbé Olivet n’ait
pris le change dans ces notes, & cela m’engage à entrer ici dans des
éclairciffemens, qui ne feront peut-être pas inutiles au lecteur. Ce meme
auteur qui a donné la verlion françoife, a auffi fait imprimer le
texte original latin, c’eft de ce texte dont nous allons nous fervir.
Chryfis, quæ Thucydide aucfcore 1. z. aliquot
ante fugam ännis lacer do di annum
agebat qu idragelimum odtavum , anno
s circiter quinquaginta facerdotii ha-
buit cum aufugit. Nihil hie ad rem meam
fpe&abat hæc chronologies computatio ;
fed accurate tra£tanda funt etiam ea quæ
ex occafione dicuntur, etiamli ad argumentum
nihil pertineant.
D. Ab. Ol iv e t in notis fuis ad inter-
pretationem librorum Ciceronis de natura
deorum Gallico idiomate concinnatam, loca
fepcern in opéré de Antiquitate explanata
affert, ubi a mente Ciceronis me aberravilTe
contendit. Aliquando autem quali
fubdubitans loquitur, rionnunquam etiam
certiffime erratum elfe decernit. Ego vero
libentiflime errata quælibet monitusemen-
do. At vereor ne in hifee notis D, Olive-
tus a fcopout plurimumaber raver it : quam-
obrem notas hujufmodi accuratius expen-
dere cogor : quæ res nec ingrata forte nec
inutilis le£tori erit. Idem porro audor qui
interpretationem Gallico idiomate concin-
n av it, libros etiam Ciceronis Latine edi
curavit ; hac. autem editione in his obfer-
vationibus utemur.
Remarques fu r quelques notes de A l. I’ Abbe' Olivet.
1 E P. de Montfaucon, d it M. l’Ab-
bé Olivet p. 5 4 . niant inféré plu-
feurs endroits de ce troiféme livre dans fon
grand Ouvrage, qui paroit depuis quelques
mois s j ai cru devoir conférer ma traduction
avec la fienne, <fy rendre compte des
différences quony peut remarquer. En voici
trois dans le feul article d’Hercule.
Le premier pafîàge eft à la page j 5 .
d u François, & 1 6 5 . du L a tin , où Cicéron
faifànt l’énumération de diffe-
rens Hercules, parle ainfi du troifie-
me. Tertius efi ex ldais DaBylis, cui in-
ferias afferunt, Le P. de Montfaucon, dit
M. l’A b b é , traduit ainfi : Le troifiéme
eft un des Idéens Daétyles, à qui les
Cretois offrent des dons pour les morts.
Je ne veux point le chicaner, p o u rlû it-il,
Jur ce qu’il ajoute ici les Cretois, qui ne
font point dans le texte 3 car il n e t oit pas
engage, comme moi, d une traduction pref-
que literale : j y d’ailleurs f i quelqu’un fa -
crifioit d un Dattyle, côtoient vraifembla-
blement les Cretois. Mais ma difficulté tombe
fu r cui inferias afferunt. Par la s f i je
ne me trompe, Cicéron ri a point voulu dire
qu’on ojfroit des dons d cet Hercule pour les
morts 3 mais que cet Hercule étoit lui-même
le mort, à l’honneur de qui l’on ojfroit
de ces dons funèbres 5 ce qui marquefimple-
ment que fon anniverfaire fe faifoit d perpétuité.
Dire qu Hercule étoit prié pour les
morts, ou qu’il étoit honoré comme un homme
mort, cela fa it ici une différence très-
P R E 1
grande par rapport (tu but de Cicéron.
Là différence eft en effet très-grande,
perfonne n’en peut douter. Laque-
ftion eft, lequel des deux fens il faut a-
dopter. M, l’Abbé prétend que cet Hercule
étoit lui-même le mort pour lequel
on faifoit les offrandes. Mais il me
fomble que quand qn faifoit des offrandes
pour les morts, ces morts étoient
toujours regardez comme hommes ; &
que quand on faifoit des offrandes, aux
dieux ou pour les dieux, comme il vous
plaira, ces dieux n ’étoiçnt jamais con-
fiderez comme morts. Cela paffe pour
fi confiant, que le P. Noris (a), depuis
Cardinal, voulant prouver qu'AccaLa-
rentia n ’a jamais été regardée à Rome
comme déeffè, apporte l’argument qui
fuit comme décifif. O n rendoit tous
les ans à Rome des honneurs funèbres,.
parentalia, à Açca La ren tia, comme a
une défunte ; elle n’y a donc jamais
été regardée comme déeffè. A in fi,
quand M. l’Abbé d it qu’on faifoit des
offrandes à Hercule Daétyle comme à
un m o rt, il doit fuppofor que ceux qui
faifoient ces offrandes, le regardoiçnt
comme un homme m o rt, & n on pas
comme un dieu. Or il eft très-certain
qu Hercule Daétyle étoit regardé non
feulement comme un d ieu , mais comm
e un dieu très-puiffant.' On l’hono-
roit en l’ifle de Crete , & en plufieurs
endroits de la Greçe ; en certains lieux
o n le croioft même préférable à l’Hercule
né de Jupiter & d’Alçmene. Les
femmes, dit Diodore de -Sicile (b ), qui
faifoient des enchantement, les reçevoient
de ce dieu ', 7$ ($9 Plutarque dans
fon Traité du progrès dans Javçrtu (rfi
appelle les Idéens Daétyles des
dieux qui prélervoient du mal. Il ajoute
qu on apprenoit leurs noms par coeur,
& q u o n les recitoit tout haut pour fe
raffurer dans les terreurs paniques. Ces
dieux au nombre de cinq s’appelloient
félon Paufanias (d ), Hercule, Epimefa)
In Cenotaph. Pifànis, p. 391.
(b) Part. 1. p. 3 33. edit.Hanov. 1604.
(c) Edit. Pavil. p. 8 y.
(d) Eliac. pripr. ç. 14,
A C E . x ix
d e , Id a , Peonée, èi Jafo, Strabon (e)
appelle cet Hercule le che f des Idéens
Daétyles, «?znywt, & Paufanias affure
qu’on lui avoit érigé un autel (ƒ) dans
l’E lid e , & qu’on appelloit ce dieu par
excellence (g) çe qui veut dir
e , défenfeur, p a tro n , qui donne fe-
cours. Il y avoir (/>) auffi dans la Beotie
& ailleurs des. temples dediez à cet
Hercule Daétyle. Le nom de paraftate
ou défenfeur le diftinguoit des autres
Hercules. On lui dreff’oit des autels
dans les gymnafes, enfin on lui rendoit
to u s. les honneurs de la divinité.
J e demande s’il y a apparence qu’on
fift des offrandes pour cet Hercule çom -
me pour u n mort ; pour cet Hercule ,
dis- j e , qui étoit appellé par ahtono-
mafe le défenfeur, & honoré comme
tel en C re te , dans la Grece & ailleurs.
J e fuis perfuadé que le fens de Cicéron
eft celui que j’ai exprimé ; Le tro.ifiéme
efi un des idéens D afyles, d qui on offre .
des dons pour les morts s ou fi la leçon
qu’a fuivie Lilius Giraldus eft la véritable
, d qui les Cretois offroient dçs dons
pour les morts car cès, Idéens Daétyles
prenoient leurs noms, non pas du mo n t
Ida dfi .Trpie , mais du mont. Ida de
Crete, J e ne doute pas que M- l’Abbé
Olivet lui-même n ’eût traduit ce pafla-
gé au même fens, s’il, ayoit pris la peine
de s’inftruire de lfopinion des an ciens
fur cec Hercule D a éty le, & du
culte qu’on lui rendoit. C’eft auffi faute
d ’avoir puife dans ces;fources, qu’il
fait la remarque fuiyante.
fiuintus in India, qui Belüs dicitur. Le
P. de Montfaucon traduit ainfi : Le cinquième
eft l’In d ie n , qui eft appellé
Bel. Cicéron ne dit pas que cet Hercule fu t
Indien, mais qu’il étoit honoré dans les Indes
s car in India fe rapporte vifiblement
d çolitur qui efi plus haut.
Je fie fuis pas perfttadé que çolitur,
qui eft dans l’article précèdent, fo doive
fous-entçndre après Jtjuintus in Indiat.
. (e) Straboj lib. 8.
(ƒ) Eliac. priojr. c, 8.
(g) Ibid, c, 14.
(b) Eoeotiç, ç. 2.7,